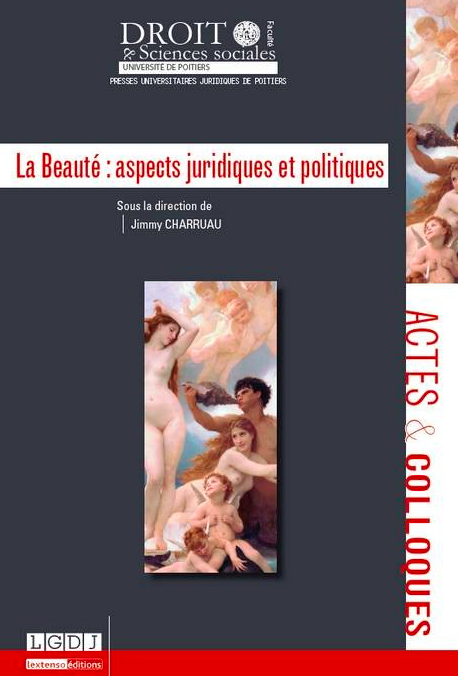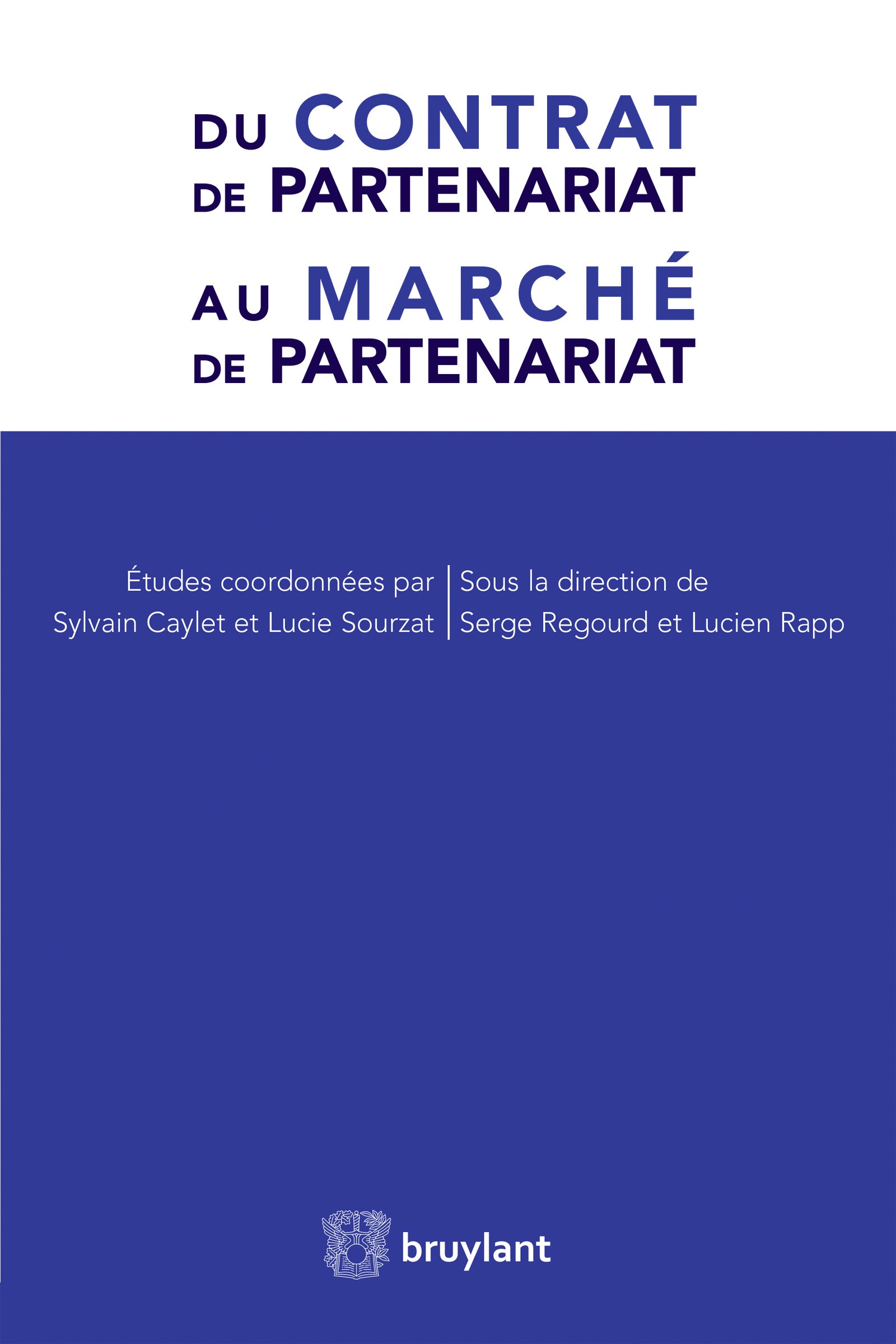par Jimmy Charruau
Doctorant en droit public, A.T.E.R. à l’Université d’Angers

La Beauté :
aspects juridiques et politiques[1]
Art. 127.
De l’application de rencontre Tinder par laquelle le « match » opère entre deux personnes sur simple découverte de leurs photos, en passant par Photoshop, Instagram, et même Instabeauty pour parfaire son image, jusqu’aux réseaux sociaux Twitter et Facebook où l’encart « photo de profil » permet d’apparaître sous son meilleur jour, sans oublier Snapchat qui approvisionne ses utilisateurs en clichés éphémères ; nombreux sont les outils – ici connectés – qui alimentent en flux continu notre « société du paraître »[2].
Pleinement intégrée dans notre quotidien, l’idée de Beauté s’illustre pourtant difficilement dans le discours juridique et politique. Trois explications liminaires – sans prétendre à l’exhaustivité – peuvent être formulées. Peut-être cette réticence vient-elle d’une supposée sacralité de la notion : ne parle-t-on pas de « la » Beauté ? De cette unicité, marquée tant par l’emploi du singulier que par l’usage de la majuscule, pourraient en effet naître quelques appréhensions, concentrées en la peur de briser un Tout. Peut-être cette réserve trouve-t-elle autrement son origine dans un certain malaise, une conscience mal assumée d’avoir tous les jours, et envers tous, recours au jugement esthétique ; surtout dans notre société qui érige l’égalité en valeur cardinale. A contrario, c’est peut-être l’apparente futilité de la Beauté qui l’éloigne des études juridiques et politiques. Certains se sont certes prêtés au jeu de l’analyse, mais toujours au prix d’un glissement sémantique : la Beauté, manifestation aérienne, s’est condensée pour devenir Esthétique, science rationnelle. Quelques études ont ainsi porté sur l’esthétisme en droit de l’urbanisme[3], en droit de l’environnement[4], ou sur les relations entre droit et art[5]. Mais, comme pour teinter la notion d’une objectivité qu’a priori elle ignore, tous ces travaux ne l’ont abordée qu’au travers de réalités matérielles, apparemment plus rassurantes : objets, œuvres, architecture, espaces, etc. Associée à l’Homme – beauté comme « beauté humaine » –, elle appartiendrait en revanche au champ – vaste – de l’impensé juridique. Puisant sa substance dans les diverses dimensions sensorielles, la notion serait beaucoup trop instable pour prétendre fonder des analyses cohérentes, systémiques, dégagées de l’immédiateté des perceptions. Cette volatilité échapperait à la rigueur du Droit et à l’analyse de la Science politique.
Parions pourtant que la question de la Beauté ne manquera pas de se poser plus intensément, et les réponses continueront de manquer si le terrain n’est pas davantage exploré : dans le domaine de la bioéthique par exemple, la sélection des donneurs de sperme – qui a d’ailleurs commencé, la plus importante banque de sperme au monde refusant désormais les roux[6] – mais aussi celle des donneuses d’ovocytes et des mères porteuses, apportera de plus en plus son lot d’incertitudes. Cette (potentielle) dérive eugéniste ne prouve-t-elle pas que l’étude de la Beauté doit être prise au sérieux ? Car si son lyrisme, contribuant très largement à son imprégnation dans la société, et le flou congénital qu’elle charrie, l’empêchent de s’élever au rang de norme de droit positif, ils ne lui interdisent pas d’exercer sur l’ordonnancement juridique et politique – tant au niveau de son élaboration que de son fonctionnement – une influence certaine, diffuse. Bien que n’ayant pas la force immédiate des règles de droit, la Beauté inspire donc leur contenu ; jusqu’à leur dépérissement ?
Assurément, interroger ainsi certains aspects de « cette étrange idée du beau »[7], en gratter son vernis, et nous prenons le risque – assumé – qu’elle perde en éclat. Aujourd’hui, en effet, à la question platonicienne « qu’est-ce que la Beauté ? », les réponses divergent ; et ces incertitudes la nourrissent. Cet ouvrage, issu d’un colloque des doctorants organisé en 2015 à l’Université d’Angers, n’a donc eu qu’une ambition, s’il pouvait y prétendre : celle d’entraîner encore des questions, par l’évocation particulière de certains « aspects juridiques et politiques » contemporains, que nous proposons d’aborder en deux temps : l’instrumentalisation de la Beauté (I), potentiellement excessive, laisse place à sa rationalisation par le droit (II).
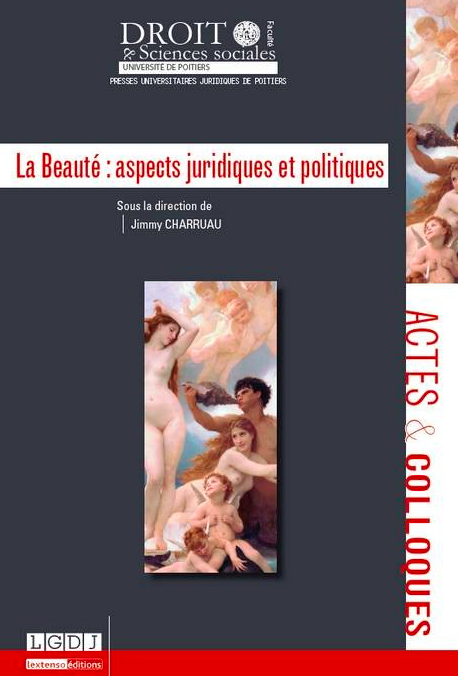
I – L’instrumentalisation de la Beauté
« Googlisez » la Beauté et vous constaterez qu’elle est aujourd’hui essentiellement associée au corps : maquillage, coiffure, soins du visage, relooking, etc. C’est chose vraie au sein de la sphère du pouvoir qui agite ce nouveau totem : volontairement, par les acteurs politiques qui en jouent au cours de leur carrière ; ou plus diffusément, par l’établissement d’une norme sociale qui en exigerait sa promotion (B). De façon plus originale, les organisations internationales (l’ONU en tête), comme les collectivités territoriales, n’hésitent pas non plus à mobiliser cette donnée. En libérant sa puissance attractive, la Beauté apporte en effet à ce paysage institutionnel, dont la magie n’opère parfois plus, des bienfaits parfois longtemps désirés (A).
A – Beauté institutionnalisée
Insaisissable, la Beauté est paradoxalement l’objet de phénomènes structurants. Quel meilleur exemple que le concours de beauté qui, par la sélection opérée, vient institutionnaliser les « canons esthétiques » du moment ? Au fond, le sujet semblait attendu : interroger les concours de Miss à l’occasion d’une étude portant sur la Beauté, paraît naturel. Il fallait pourtant, cherchant à s’aventurer hors des sentiers battus, aborder la problématique sous un angle différent. Originale car inhumaine, la beauté animale et son instrumentalisation pouvaient ainsi être interrogées. Un rapide tour du monde en mesure l’intérêt : du très convoité Crufts, plus grand concours de chiens au monde, aux plus insolites concours chinois pour poissons rouges et poules, en passant par l’inattendu concours de beauté pour chèvres en Lituanie, les exemples de compétition – d’un genre inhabituel, il faut le reconnaître – ne manquent pas ! La laideur se célèbre d’ailleurs tout autant : né avec une colonne vertébrale très courte, Quasi Modo a été élu chien le plus laid du monde en 2015 en Californie ; de quoi s’interroger, dans une perspective internationaliste, sur la dignité animale (Joseph Reeves, « Les concours de beauté pour animaux »).
Si la Beauté est ainsi l’objet d’une institutionnalisation particulière, il arrive parfois qu’elle s’intègre au fonctionnement d’institutions déjà établies, comme pour les enrichir d’une teneur singulière, régénérée. La beauté, qu’elle soit matérielle ou « humaine », pénètre les lieux de pouvoir. Le système onusien l’illustre parfaitement, tant par ses œuvres d’art (Le Phénix renaissant de ses cendres, trônant au Siège des Nations Unies) que par les célébrités, à la plastique de rêve, qu’elle mobilise (Angelina Jolie, ambassadrice des Nations Unies puis Envoyée spéciale, ou encore Leonardo DiCaprio). Pour quel statut juridique (Maëva Szlovik, « L’utilisation de la beauté par les organisations onusiennes ») ?
Ce processus d’instrumentalisation de la Beauté par le vecteur institutionnel trouve son écho sur le plan interne : en la fondant dans la matérialité de leurs politiques, les pouvoirs publics impulsent une dynamique esthétique nouvelle. Cherchant à développer leur attractivité, les collectivités locales mettent en place un véritable marketing territorial participant au dessin renouvelé de leur paysage urbain. De 1971 à 1977, une émission de télévision ne faisait-elle pas état d’une France défigurée ? Plus radical, l’hebdomadaire Télérama publiait en 2010 un dossier intitulé « Halte à la France moche ! ». Depuis, des efforts ont été entrepris ; en témoigne le programme de végétalisation de la mairie de Paris sur la mandature 2014-2020 en vue, notamment, de faire évoluer l’esthétique de l’architecture parisienne. Par cette métamorphose urbaine, les pouvoirs publics adressent un message politique à visée sociale, celui de rapprocher les citoyens du processus décisionnel : ou quand le beau convoque l’utile (Agathe Vitour, « Du design territorial au design des politiques publiques : du « dessin » au « dessein » de la ville »).
B – Beauté politisée
Politisée ? La Beauté l’est, assurément. Elle l’est d’ailleurs depuis longtemps, sous un angle – ici envisagé – assez particulier. Car la Beauté, en effet, ne se confine pas au visuel. La fonction politique, en mobilisant l’art oratoire et ses belles formules, active cette beauté invisible. Souvenons-nous du « Je vous ai compris » du général de Gaulle en 1958, du « Ich bin ein Berliner » de John Fitzgerald Kennedy en 1963, du « I have a dream » de Martin Luther King la même année, ou encore, plus récemment, du « Yes we can » de Barack Obama en 2008. Nul ne l’ignore : la beauté du verbe soulage l’effort de persuasion, arme indispensable en politique. Seulement, qu’est-ce qu’un beau discours ? N’est-il fait que de « beaux mots », savamment choisis ? Doit-il s’appuyer sur un texte écrit, travaillé, ciselé, pensé à dessein ou, au contraire, laisser place à l’instantané, en faisant la part belle à l’improvisation ? L’histoire parlementaire française offre quelques éléments de réponse (Matthieu Le Verge, « Beauté oratoire et discours écrits sous la Restauration : une coexistence impossible ? ») ?
Retour « à la normale » : la beauté politique passe surtout par le visuel. Parce qu’elle est historiquement envisagée en tant que qualité féminine[8], la beauté des femmes politiques devait d’abord être interrogée. S’agit-il de dire qu’elles se caractérisent essentiellement par leur genre ? Ceci, formulé autrement : est-ce un privilège qui leur permettrait d’accéder plus facilement au panthéon politique ou, au contraire, un inconvénient qui les isolerait davantage de cet espace androcentré, par marginalisation et procès en incompétence ? Évitons toute fausse naïveté car jusqu’à présent, les qualités politiques ne se pensent souvent que par occultation du féminin. Si bien que lorsqu’en 2008, Carla Bruni déclara qu’elle trouvait « Ségolène Royal très belle »[9], peut-être se rendait-elle compte du génie politique de cette phrase en ce qu’elle phagocytait les ambitions de l’ex-rivale de son mari… L’appel à la beauté est ici, manifestement, expression d’une stratégie politicienne (Nicolas Mary, « « Sexy Ségo ». Le traitement de Ségolène Royal dans Voici »).
Mais, si elle a longtemps été confondue avec les femmes, comme pour assurer une position masculine confortablement dominatrice, cette qualité – forcément minorée ! – s’est, par la reconnaissance contemporaine de l’égalité des sexes et de leurs conditions, détachée de ce statut subalterne pour endosser la même respectabilité que les qualités traditionnellement associées aux hommes. Généralement moins questionnée, la beauté masculine ne se cache plus : les revues de mode spécialisées se multiplient (GQ Magazine, Lui Magazine, Dandy Magazine, etc.), les instituts de beauté aussi, et le concours de Mister France émerge, certes timidement. Interroger l’apparence de celui qui assure la fonction suprême, jusqu’ici toujours masculine, présente donc un intérêt certain (François Hourmant, « La beauté du Prince. Esthétique du pouvoir et masculinité politique en régime de visibilité »). L’actualité conforte l’entreprise : alors que François Hollande subit les critiques les plus acerbes pour ses costumes trop grands et ses cravates portées de travers, Jacques Chirac devient « icône de la mode » par la commercialisation d’une ligne de tee-shirts à son effigie. Retour abracadabrantesque !
S’il existe ainsi des domaines dans lesquels la ressource esthétique emporte la mobilisation, le droit, dans une démarche éthique, intervient de plus en plus pour en limiter son intensité, potentiellement dévastatrice.
II – La rationalisation de la Beauté
Cette entreprise de modération interroge les limites de « l’expérience de la beauté »[10], tenaillée qu’elle est par l’instabilité du terrain sur lequel elle repose, fait d’immédiateté émotionnelle et de finalité parfois douloureuse pour les personnes victimes de ses critiques. C’est ici saisir l’utilité du processus de rationalisation qui, en rendant la prise en compte de la Beauté conforme à la raison, fait surgir le réflexif dans l’affectif : s’il n’empêche pas d’éprouver certaines émotions, il pose quelques interdictions. Ainsi, tant le législateur, par la loi, que les magistrats, par leurs décisions, et les acteurs privés, par le contrat, peuvent encadrer – ou non ! – le recours à la Beauté. La question de l’existence d’un seuil dans la prise en compte de ce critère irrigue donc les raisonnements de cette partie : souvent encadrée (A), la prise en compte de la Beauté est parfois, plus fermement, censurée (B).
A – Beauté encadrée
C’est par un biais politiste – le constat d’une surmédiatisation contemporaine des First Ladies –, qu’il s’est agi d’examiner, en mobilisant le droit des finances publiques, le coût pour la République de l’apparence des Premières dames (Marie-Pierre Mpiga Voua Ofounda, « L’apparence des Premières dames : un coût pour la République »). Le sujet ne manque pas d’alimenter les débats : M. Guillaume Larrivé interrogea ainsi en 2013 M. le Premier ministre sur le coût, pour les finances de l’État, des collaborateurs affectés au service de Valérie Trierweiler[11]. Ailleurs, aux États-Unis, les tribulations esthétiques des ex-Premières dames alimentent encore les tabloïdes, surtout lorsque celles-ci prétendent à la magistrature suprême : Hillary Clinton aurait ainsi dépensé, un jour de campagne, 600 dollars dans un salon de coiffure. La problématique de l’encadrement se pose donc ici avec acuité : jusqu’où ces dépenses esthétiques peuvent-elles aller ? Existe-t-il un arsenal juridique capable de les contrôler ?
Peut-être par un excès d’évidence, tant la notion de Beauté y invite naturellement, il est un domaine d’analyse que cette étude n’avait pas encore exploré : l’art, réserve intarissable du beau. Insérer cette problématique dans un titre qui évoque la contrainte peut surprendre : l’art et l’idée de Beauté qu’il charrie peuvent-ils être encadrés ? L’entreprise étonne d’autant plus qu’à chaque époque, correspond son idéal de Beauté. De La Bella de Titien vers 1536, idéal personnifié de Beauté, à la Venus d’Alexandrie d’Yves Klein en 1962, d’un bleu unique, en passant par l’Urinoir de Marcel Duchamp en 1917, raillant habilement les conventions esthétiques, les artistes n’ont cessé de redéfinir le sens de cette notion, sans totalement en consommer la rupture. Intuitive, la Beauté raconte, au fond, l’œuvre et son dépassement, à la fois signifiant (composante matérielle) et signifié (composante conceptuelle). Seulement, pour recevoir la protection que le droit permet, la Beauté doit emprunter des chemins davantage balisés. Car le régime juridique du droit d’auteur ne protège pas n’importe quelle beauté ; le champ serait insaisissable. Dans cette quête d’esthétique, le juge a son rôle à jouer, avec le risque bien perçu qu’il n’exprime par trop sa propre conception du beau (Alexandre Portron, « Le beau dans la protection du droit d’auteur »).
Le volet privatiste ne saurait se refermer sans avoir exploré l’une de ses composantes fondamentales : le droit du travail. La notion de Beauté y est en effet appréhendée, sous une forme particulière, rationalisée – ou presque – : la problématique de l’apparence et la liberté individuelle qui s’y attache. Où s’arrête en ce sens la liberté vestimentaire des salariés ? Les pics de chaleur enregistrés tous les étés relancent chaque année la question de la liberté de se vêtir : un salarié peut-il venir travailler en short ? La SNCF n’est pas en reste, qui a cru bon d’élaborer un « guide beauté » à destination de ses agents, allant jusqu’à préconiser de recourir à des crèmes hydratantes pour les mains ! L’employeur, gourou de la mode ? Constatons à tout le moins qu’il façonne parfois une certaine beauté. Malgré tout, cette prise en compte se trouve encadrée par le droit : les exigences de l’employeur devront obligatoirement être justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. Tout est donc affaire d’équilibre, en fonction de la spécificité du métier exercé – pensons aux contrats de mannequinat (Eroan Rubagotti, « La prise en compte de l’apparence en droit du travail »).
B – Beauté censurée
Un pas supplémentaire est ici franchi : alors qu’ont été précédemment analysées les limites apportées à la liberté de se vêtir en droit du travail, la question des discriminations liées à l’apparence physique fait ici surface. L’actualité en ce domaine ne manque pas. Il n’est qu’à rappeler le cas Abercrombie & Fitch, célèbre enseigne américaine de prêt-à-porter, épinglée dans de nombreuses affaires : refus de commercialiser les grandes tailles de vêtement pour les femmes et invention de la taille XXXS, recommandations formulées par le Défenseur des droits en novembre 2014 pour des faits de discriminations à raison de l’apparence physique lors du processus de recrutement[12] alors qu’elle avait été condamnée en 2005 aux États-Unis à payer 50 millions de dollars pour des cas similaires[13], etc. Ces abus discriminatoires interrogent : jusqu’où l’exigence de « belle apparence » peut-elle aller ? Quel(s) lien(s) le critère juridique de l’apparence physique tisse-t-il d’ailleurs avec la notion de Beauté ? Comment ce motif discriminatoire, introduit dans l’ordonnancement juridique français par la loi du 16 novembre 2001, s’inscrit-il dans le paysage – déjà fourni – du droit des discriminations ? Qu’apporte-t-il à cette lutte ? La question n’est pas anodine car le législateur français a – encore ! – fait preuve de zèle : aucun autre État, sauf la Belgique, ne prévoit ce critère (Jimmy Charruau, « L’apparence physique, critère perturbateur du droit des discriminations »).
Toujours d’actualité, la question des concours de mini-miss achève ce tour d’horizon. Encore une fois, la prise en compte de la beauté – considérée ici comme abusive car juvénile – est censurée par le législateur depuis la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prohibant les concours de beauté pour les enfants de moins de 13 ans. Au fond, au cœur de cet article, s’entrevoit la problématique – récurrente – de la dignité de la personne humaine : cette célébration de la beauté féminine dès le plus jeune âge, parce qu’elle participe au matraquage de normes de beauté pour la plupart inatteignables, conduit à l’autodévalorisation de l’individu. Que la loi s’intitule « égalité réelle entre les femmes et les hommes » ne surprend donc pas : elle tend en effet à lutter contre une logique sexiste avilissante. Au-delà de ce combat – pas toujours unanime, convenons-en –, l’interdiction de ces concours puise peut-être sa justification dans une peur – légitime mais controversée – de faire naître ou d’attiser, par cette mise en scène des corps ou, plus généralement, au regard du phénomène contemporain d’hypersexualisation, une attirance condamnable chez certains adultes envers ces jeunes enfants. En mars 2015, la marque American Apparel s’est ainsi trouvée au cœur d’une polémique après avoir publié sur son site une photographie d’une mannequin, au visage jugé trop infantile pour porter des vêtements aussi dénudés (Julie Jaunatre, « L’interdiction législative des concours de mini-miss »).
Ah ! la beauté… Une nébuleuse dans le ciel du Droit. Mais un champ d’études réel. Toujours superficielle, cette notion ? Trompeuses apparences.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Art. 127.
[1] Jimmy Charruau (dir.), La Beauté : aspects juridiques et politiques, Poitiers, LGDJ – Presses Universitaires Juridiques de l’Université de Poitiers, coll. « Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers », 2016, 208 pages.
[2] V. Jean-François Amadieu, La société du paraître. Les beaux, les jeunes… et les autres, Paris, Odile Jacob, 2016, 256 pages. Le professeur Amadieu a aimablement accepté de faire la préface de notre ouvrage, ici présenté. Les professeurs Félicien Lemaire et Hervé Rihal ont quant à eux respectivement rédigé l’introduction et la conclusion.
[3] Jacqueline Morand-Deviller, « Esthétique et droit de l’urbanisme », in Mélanges René Chapus : droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, p. 429.
[4] Jessica Makowiak, Esthétique et droit, Paris, L.G.D.J., coll. « Thèses », 2004, 416 pages.
[5] V. le numéro « Droit et esthétique », Archives de philosophie du droit, tome 40, 1996, 533 pages.
[6] Richard Orange, « Sperm bank turns down redheads », telegraph.co.uk, 16 septembre 2011, [En ligne]. URL : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/denmark/8768598/Sperm-bank-turns-down-redheads.html?t.
[7] François Jullien, Cette étrange idée du beau, Paris, Grasset, 2010, 266 pages.
[8] Alain Rey indique en effet que « Bellus, en langue classique, a surtout qualifié des femmes et des enfants avec la valeur de « mignon, joli, charmant, adorable », ne s’appliquant aux adultes que par ironie » (Dictionnaire historique de la langue française, volume 1, Paris, Le Robert, 1992, p. 199).
[9] Reportage « Carla Bruni en toute liberté » sur M6 le 19 décembre 2008.
[10] Fabienne Brugère, L’expérience de la beauté. Essai sur la banalisation du beau au XVIIIème siècle, Paris, Vrin, 2006, 206 pages.
[11] Assemblée nationale, 14ème législature, question n°20735 de M. Guillaume Larrivé, JO, 12 mars 2013, p. 2694 ; réponse publiée au JO, 30 avril 2013, p. 4710.
[12] Défenseur des droits, décision MLD-2014-147, 3 novembre 2014.
[13] United States District Court Northern District of California, Gonzalez v. Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Consent Decree du 11 avril 2005, aff. n°03-2817 SI, 044730 et 0447.