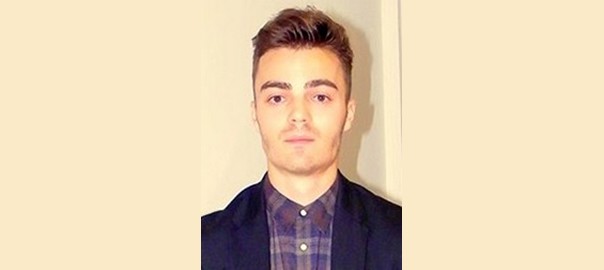par M. Nicolas KADA,
Professeur de droit public
Directeur du CRJ (Université Grenoble Alpes) et du GRALE (GIS CNRS)
Art. 83. Les relations entre le public et l’administration sont régies, depuis le 1er janvier 2016, par un code dont les dispositions ont été publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015. On ne peut a priori que s’en réjouir tant les règles relatives aux relations entre le public et les administrations étaient jusqu’alors éparpillées dans différents textes ou relevaient d’une jurisprudence parfois instable ou difficile d’accès. Certes, il existait déjà un code de justice administrative relatif à l’organisation des juridictions et aux procédures en matière de contentieux avec l’administration. Mais rien en ce qui concerne les relations « ordinaires », par définition les plus fréquentes, entre l’administration et son public. Les dispositions de ce code entendent donc regrouper l’ensemble des règles régissant les rapports du public, c’est-à-dire toute personne physique (y compris un agent d’une administration) et toute personne morale de droit privé, avec l’administration. Par administration, le législateur entend les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.
Mais à trop vouloir simplifier, ne risque-t-on pas de caricaturer ? Le public et l’administration forment-ils réellement deux ensembles homogènes qui ne méritent de ce fait aucune sous-division ? Si l’interrogation est légitime en ce qui concerne le public, elle l’est tout autant pour l’administration. Quoi de commun entre une autorité administrative indépendante et une direction départementale d’une préfecture ? Entre une administration centrale d’un ministère et un opérateur public ? Entre un hôpital et une collectivité territoriale ? C’est d’ailleurs sur ce dernier point que l’exercice de codification trouve sans doute ses principales limites : du fait de leurs tailles, de leur proximité avec les usagers, de leurs contraintes structurelles et de leur rapport au droit, les collectivités territoriales devaient-elles être traitées comme toute autre administration ? En réalité, la négation volontaire des problématiques propres au local par le CRPA n’est qu’une apparence : celles-ci ressurgissent en effet très rapidement au titre des exceptions.
La négation du local
Le souci de la généralisation, caractéristique naturelle de tout code, est ici poussé à son paroxysme… au risque de sembler nier toutes les spécificités de l’administration décentralisée dans sa relation avec le public, s’inscrivant dans un contexte plus général de rapprochement entre tous les services publics.
Une volonté de généralisation
L’ensemble des règles qui régissent les relations entre le public et les administrations a donc été rassemblé à l’automne 2015 en un seul code, réalisé pour l’essentiel à droit constant dans un souci louable d’accessibilité. Composé de deux textes, de nature législative et réglementaire, ce nouveau code entend en effet encadrer l’ensemble des relations potentielles entre les usagers et toutes les administrations publiques, qu’elles relèvent de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Ce code rassemble les principales dispositions de portée générale qui ont trait aux droits des administrés, tels que le droit à communication des documents administratifs, la motivation des décisions individuelles et les grands principes régissant les relations entre le public et l’administration issus de la loi du 12 avril 2000. Mais il inclut également les réformes les plus récentes telles que le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation ou le droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. En outre, il accorde une protection législative à quelques principes issus de la jurisprudence administrative afin de garantir aux usagers un meilleur accès au droit. C’est d’ailleurs pour cela que c’est le premier code qui adopte une numérotation continue des dispositions de nature législative et réglementaire.
Le plan du CRPA est censé suivre les « différentes étapes du dialogue administratif » comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi : le livre Ier est ainsi relatif aux échanges du public et de l’administration, le livre II a trait aux actes unilatéraux pris par l’administration, le livre III présente des dispositions relatives à l’accès aux documents administratifs, le livre IV se penche sur le règlement des différends avec l’administration… alors que le livre V regroupe étrangement les dispositions relatives à l’outre-mer, constituant une première exception au refus affiché de prendre en compte les spécificités locales. Car le code a pour ambition, au nom de la simplification, de gommer toute différence entre administrations, répondant par là même à un souhait émis dès 2011 par le Conseil d’Etat dans son rapport public annuel intitulé « Consulter autrement, participer effectivement » : celui de ne pas opérer de distinction entre Etat et collectivités territoriales.
Un contexte favorable
Les dernières réformes administratives œuvrent toutes dans cette même direction : la création des maisons de services au public en constitue une excellente illustration. Ces nouveaux pôles ont été créés par la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 et leurs modalités de création ont été précisées par le décret n°2016-403 du 4 avril 2016. Précédemment dénommés « relais de service public » puis « maisons de services publics », ces pôles entendent proposer aux usagers des guichets polyvalents, labellisés par l’État, en zone rurale et urbaine, et dont l’objet est de fournir des services de proximité et de qualité. Ces services sont assurés par l’État, les collectivités territoriales ou des entreprises privées de service public, telles que la Poste ou d’autres opérateurs de réseaux.
Si la structure porteuse est généralement une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l’objectif demeure néanmoins de rassembler, par l’effet de la mutualisation de moyens, plusieurs services relevant de différentes collectivités et organismes chargés d’une mission de service public.
Dans ces maisons de services aux publics, les usagers (particuliers ou entreprises) sont accueillis par des animateurs-médiateurs qui les orientent dans leurs relations avec l’administration prise dans son sens le plus général qui soit, afin de surmonter justement les hésitations ou confusions inévitablement présentes parmi les usagers. De la même manière, le mot « public » pris de manière générique souligne bien le caractère général des usagers visés, tant personnes physiques que morales.
Pour chacune de ces maisons de services au public, une convention-cadre est conclue par les administrations participantes : ce texte définit les services rendus aux usagers, le périmètre où l’activité s’exerce, les missions et prestations délivrées selon un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics. C’est d’ailleurs ce schéma qui doit préciser pour une durée de six ans le programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans des zones qui présentent un déficit en termes d’accessibilité. Le gouvernement prévoit de créer 1 000 maisons de services au public d’ici 2017, en transformant notamment des bureaux de Poste peu fréquentés.
Cet exemple ne fait qu’illustrer la constance d’une volonté de rapprochement entre services déconcentrés de l’Etat et collectivités décentralisées, depuis les lois sur la transparence administrative de 1978 et 1979 ou la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Mais peut-être ne faut-il pas attendre autre chose du législateur, au nom du respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ? Fût-il allé plus loin dans la distinction qu’on lui en aurait sans doute fait le reproche… Retenir ce qui est commun à tous les publics et à toutes les administrations est ainsi la démarche la plus simplificatrice qui soit : à ce titre, le CRPA n’en constitue qu’une nouvelle illustration, même si les spécificités locales n’en sont pas pour autant totalement absentes.
L’exception du local
Entré en vigueur le 1er janvier 2016 (à l’exception des règles relatives au retrait et à l’abrogation des actes administratifs applicables seulement depuis le 1er juin 2016), le CRPA doit néanmoins composer avec la réalité… et donc avec la diversité et les spécificités de l’administration décentralisée.
Une prise en compte des spécificités de l’administration locale
La secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat, Clotilde Valter, avait ainsi assuré que le CRPA ferait l’objet d’une « large diffusion qui permettra au public comme à l’administration de se l’approprier ». Le texte de loi a en outre habilité le gouvernement à prendre par ordonnance certaines mesures de simplification administrative, tout en envisageant des mesures de concertation… avec les représentants des usagers certes, mais aussi des collectivités territoriales. Preuve s’il en est que le législateur a conscience de la nécessité impérieuse de les ménager et de prendre en compte leurs spécificités. Lors du débat au Parlement, certains députés ont ainsi appelé à tenir compte « des capacités des agents publics et de ceux des collectivités territoriales » dans la mise en œuvre de la réforme. Sans doute entrevoyaient-ils en effet déjà les effets concrets des futures ordonnances sur le fonctionnement interne des collectivités, tant en ce qui concerne leur organisation que leur système d’information.
L’entrée en vigueur de la réforme pour les administrations locales a ainsi immédiatement mis en évidence quelques interrogations et incertitudes, plus ou moins levées au fil du temps. Les collectivités territoriales se sont en effet très vite questionnées sur leur capacité à adapter rapidement leurs pratiques et à réorganiser la gestion des demandes. S’est par exemple posée de manière très pragmatique la question des moyens matériels à leur disposition, de surcroît dans un contexte général de réforme territoriale et de baisse des dotations de l’Etat. Les collectivités décentralisées doivent ainsi prendre en compte les dispositions des articles L.242-1 et suivants du Code, entrées en vigueur le 1er juin 2016, relatives à l’abrogation ou au retrait d’un acte créateur de droit désormais permis que sous certaines conditions, en raison de sa seule illégalité et dans un délai de 4 mois. Il existe néanmoins une spécificité concernant les permis de construire en tant que décisions créatrices de droits. L’article L.424-5 du code de l’urbanisme ne permet leur retrait que s’ils sont illégaux et dans un délai de trois mois à compter de leur délivrance.
L’administration est de manière générale tenue de mettre en place des téléservices, et d’en informer le public. Elle doit rendre accessibles les modalités d’utilisation de ces téléservices, qui s’imposent aux usagers. Toutes ces dispositions sont détaillées dans le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. Au-delà de ces principes généraux, les articles L.112-8 et suivants du CRPA, créés par l’ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015, ont introduit un nouveau droit ouvert aux usagers relatif à la saisine de l’administration et ses échanges par voie électronique. Déjà applicable depuis le 7 novembre 2015 pour les services de l’État et leurs établissements publics administratifs, cette réforme mais n’entre en vigueur pour les collectivités territoriales que le 7 novembre 2016. Ce n’est en effet qu’à compter de cette date que toute personne pourra adresser à une administration décentralisée une demande, une déclaration ou un document par voie électronique. L’administration pourra alors répondre elle aussi par voie électronique, sauf si le demandeur le refuse expressément.
De même, en ce qui concerne les accusés de réception par voie électronique, une circulaire du premier ministre, à destination des administrations de l’État, mentionne un délai de réponse d’un jour ouvré pour donner acte de la réception, et de sept jours ouvrés pour traiter la demande. Mais cette circulaire ne s’applique pas aux collectivités territoriales et les articles L.112-2 et suivants du CRPA ne mentionnent pas de délais. Ils précisent juste que l’accusé de réception doit être délivré. Le CRPA n’apporte donc pas de précisions pour les collectivités territoriales. Dans son article L112-1, le code dispose seulement que « les conditions et délais d’émission de l’accusé de réception et de l’accusé d’enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Pour l’instant, le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concerne que les services de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.
La loi du silence
Parfois qualifiée – abusivement – de « révolution », une des principales dispositions du CRPA prévoit que « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation », et non plus rejet. Cet article L.231-1 du CRPA ne fait en réalité que reprendre les dispositions de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, qui s’appliquaient déjà depuis le 12 novembre 2014 à toutes les demandes adressées aux administrations de l’État et depuis le 12 novembre 2015 à toutes celles adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés de service public administratif. Ce principe admet bien évidemment des exceptions, qui sont d’ailleurs nombreuses.
Le cas particulier des décisions relevant du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales est ainsi exclu, pour l’instant, du champ d’application du principe de silence valant acceptation. Il en va ainsi, par exemple, de la politique d’attribution de logements. Le pragmatisme l’a donc emporté, mais cela n’est pas véritablement une surprise puisque la ministre Marylise Lebranchu affirmait dès les premiers débats parlementaires : « une ordonnance fixera les procédures concernées et celles qui ne le seront pas, étant entendu que nous nous concerterons avec les associations d’élus pour ce qui est des décisions relevant des collectivités ».
Outre les exceptions légales à l’application de ce principe, auxquelles les collectivités territoriales ont évidemment droit, il existe également des exceptions réglementaires tant pour les administrations d’Etat (une quarantaine de décrets publiés à cet effet) que pour les administrations décentralisées. Ainsi, en matière de défense et sécurité intérieure, le décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 s’applique autant aux services de l’Etat qu’aux collectivités territoriales et définit divers cas de dérogations au principe s’agissant des demandes d’accès aux documents et informations détenus par l’administration et de réutilisation de ces données, dérogations liées notamment à des raisons de défense et de sécurité intérieure.
Cependant, en ce qui concerne les seules administrations décentralisées, le nombre de décrets dérogatoires est beaucoup plus réduit. Aujourd’hui quatre décrets définissent les exceptions applicables aux administrations locales puisqu’on ne recense que :
- le décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d’agents publics territoriaux ainsi qu’aux demandes s’inscrivant dans des procédures d’accès à un emploi public territorial;
- le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 qui liste de nombreuses exceptions dans des domaines d’intervention très variés des collectivités territoriales puisqu’elles vont des demandes de place au sein d’un port de plaisance public aux demandes de crémation ;
- le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 qui identifie des exceptions au principe pour «des motifs tenant à l’objet de la décision ou de bonne administration » : par exemple des demandes de communication d’archives publiques à une collectivité territoriale ou demandes de délivrance d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, en site classé ou en instance de classement ;
- le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 qui recense de nouvelles exceptions, telles que les demandes d’inscription d’un enfant à la cantine scolaire.
Si la publication relativement tardive de ces décrets a évidemment nourri des inquiétudes et critiques au sein des collectivités territoriales, elle démontre tout de même le souci d’appréhender toute la spécificité de l’administration au niveau local et de ses rapports aux usagers.
Il apparaît finalement que l’entrée en vigueur du code a engendré quelques distinctions subtiles en termes d’application entre les administrations d’Etat et les collectivités décentralisées : par exemple, les possibilités pour les « organes collégiaux des autorités administratives » de délibérer ou de rendre leur avis à distance ont été élargies mais le Parlement a toutefois tenu à exclure explicitement les organes délibérants des collectivités territoriales de cette possibilité de délibérer à distance. La réforme a en outre entraîné une technicisation accrue des services de gestion des demandes des administrations locales, invités à modifier sensiblement leurs modes opératoires. Grand oubliée du CRPA, du moins en apparence, la nécessité de prendre en compte les spécificités locales revient donc en force dans la phase de mise en œuvre.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 02 « Les relations entre le public & l’administration » (dir. Saunier, Crouzatier-Durand & Espagno) ; Art. 83.