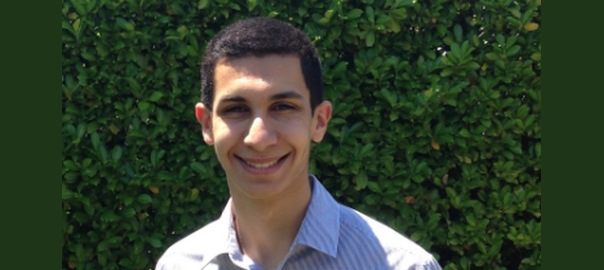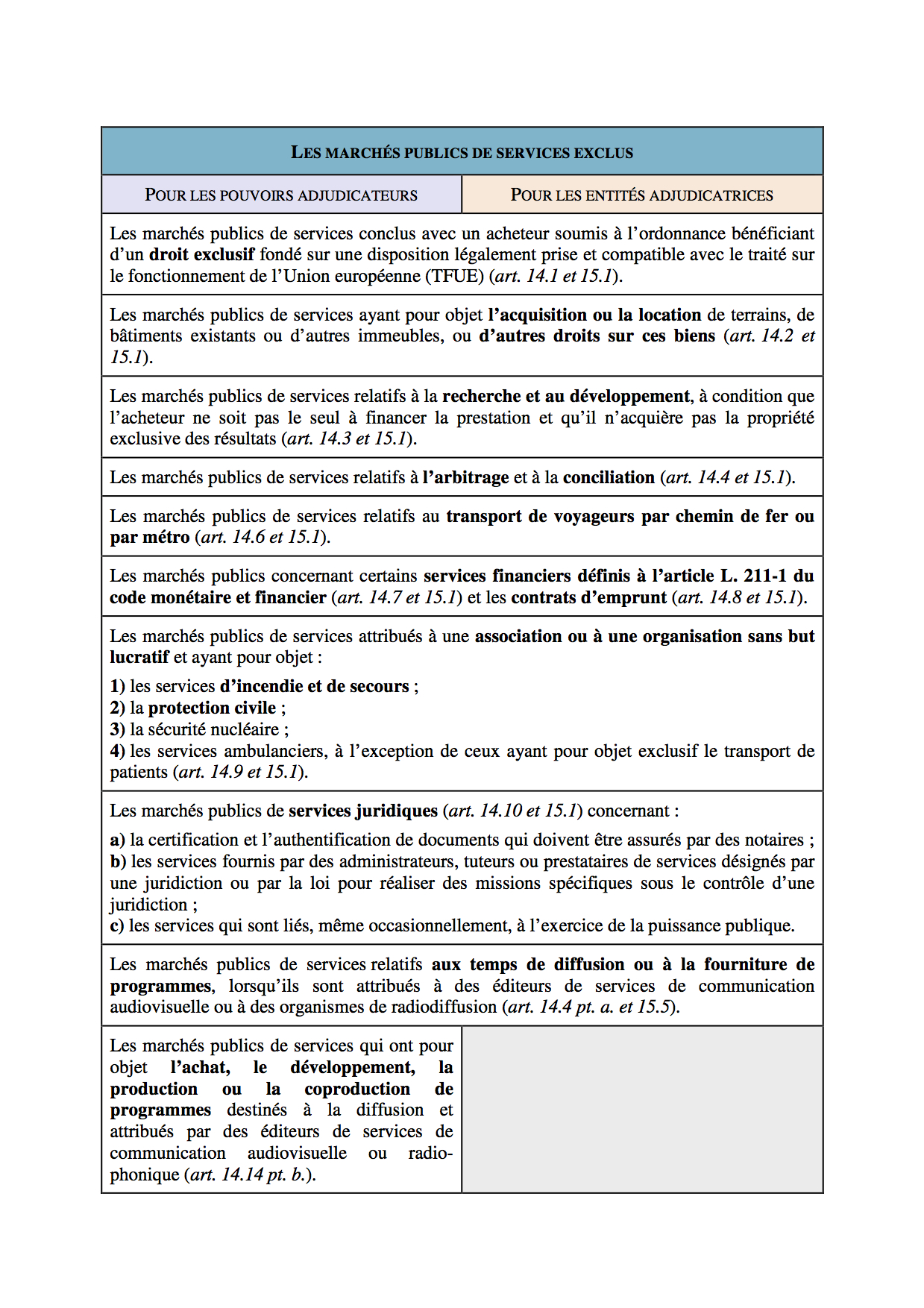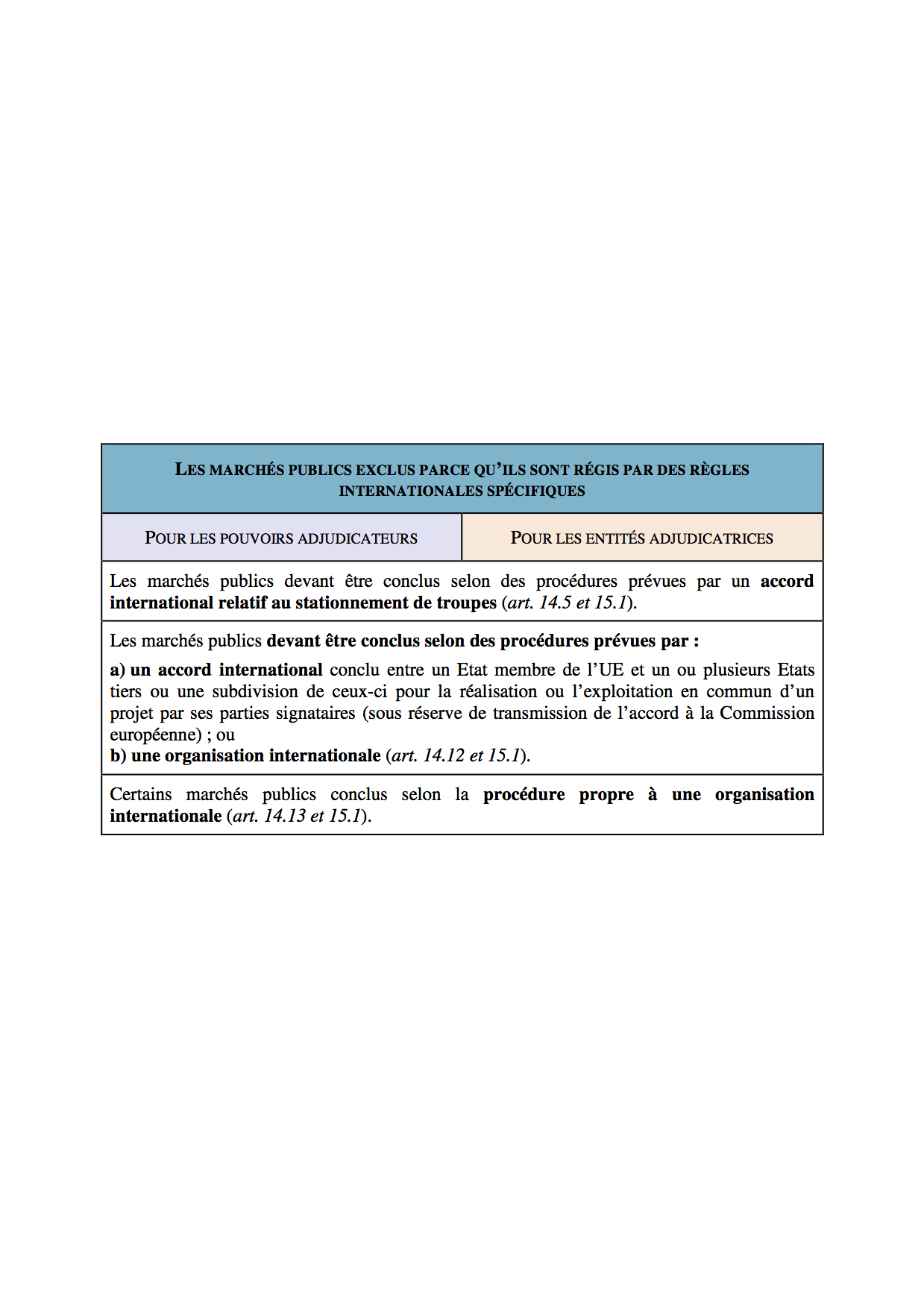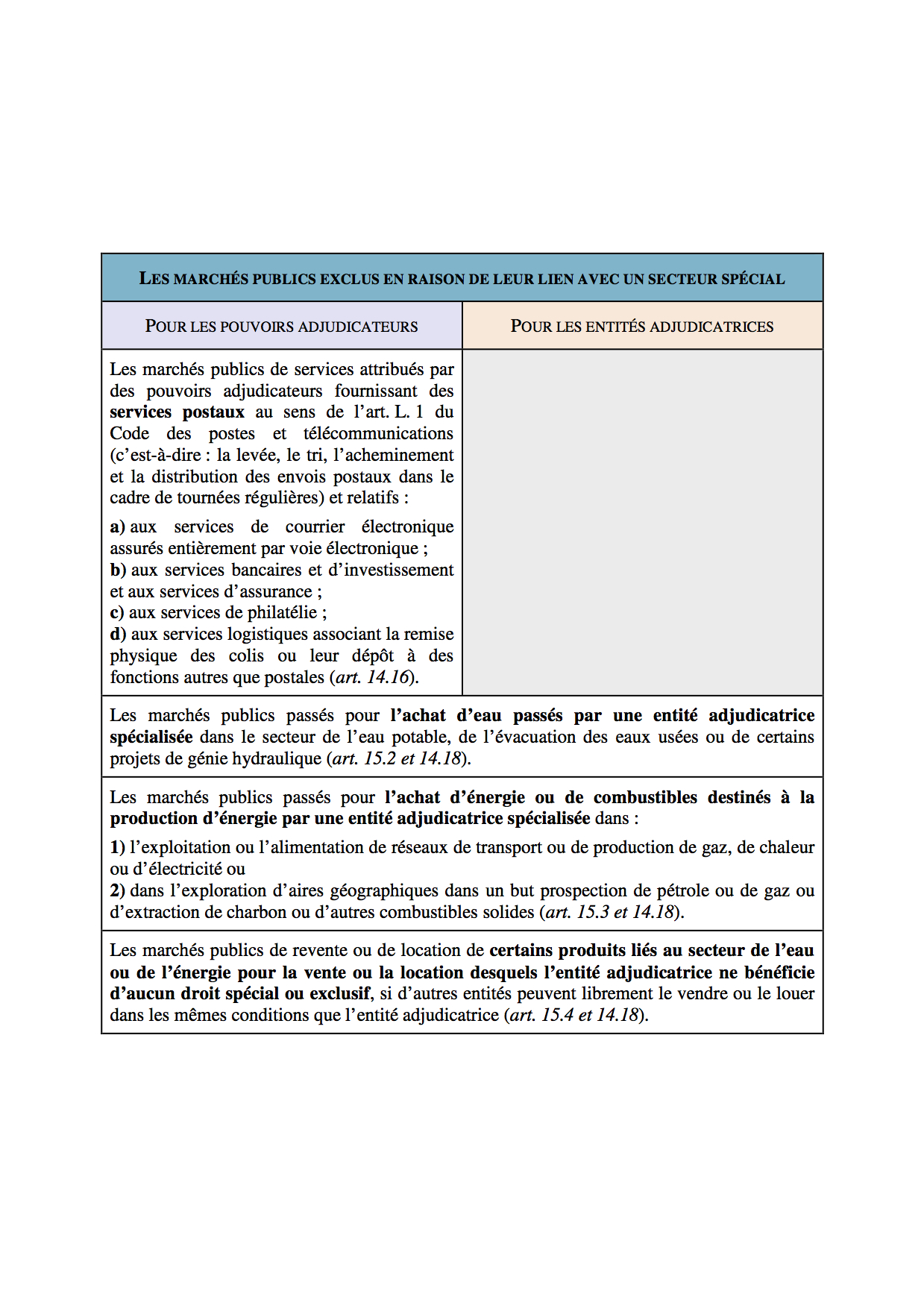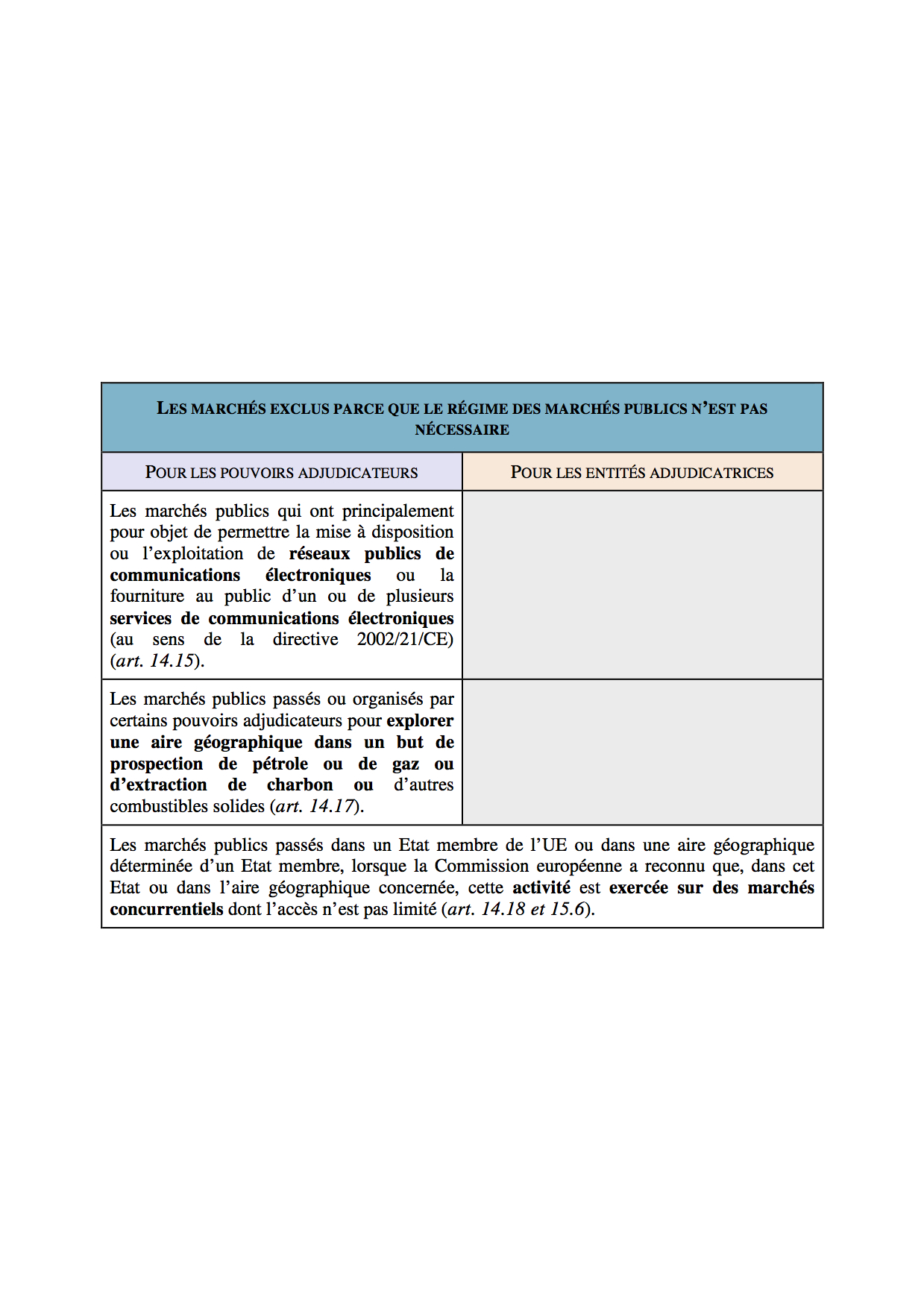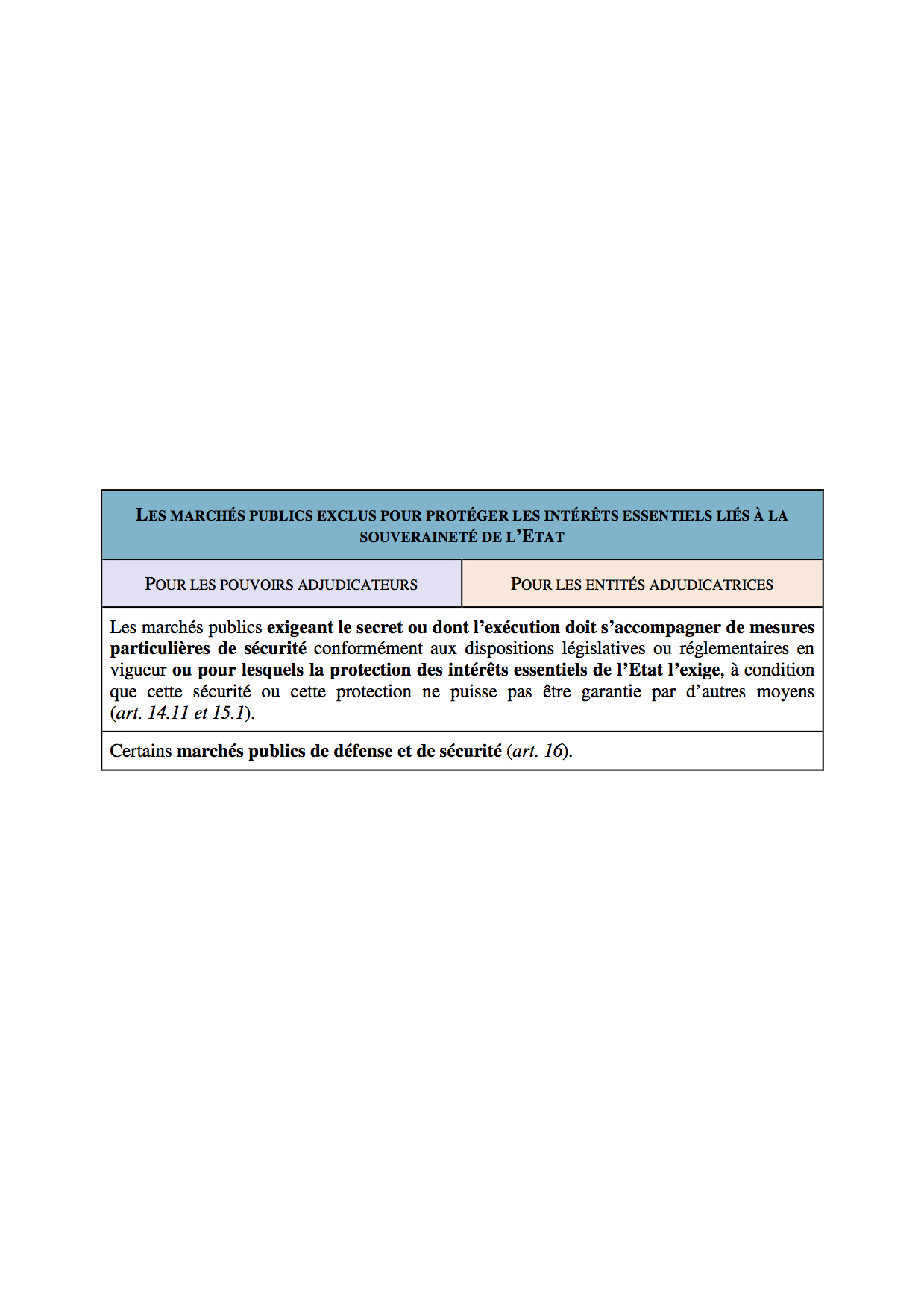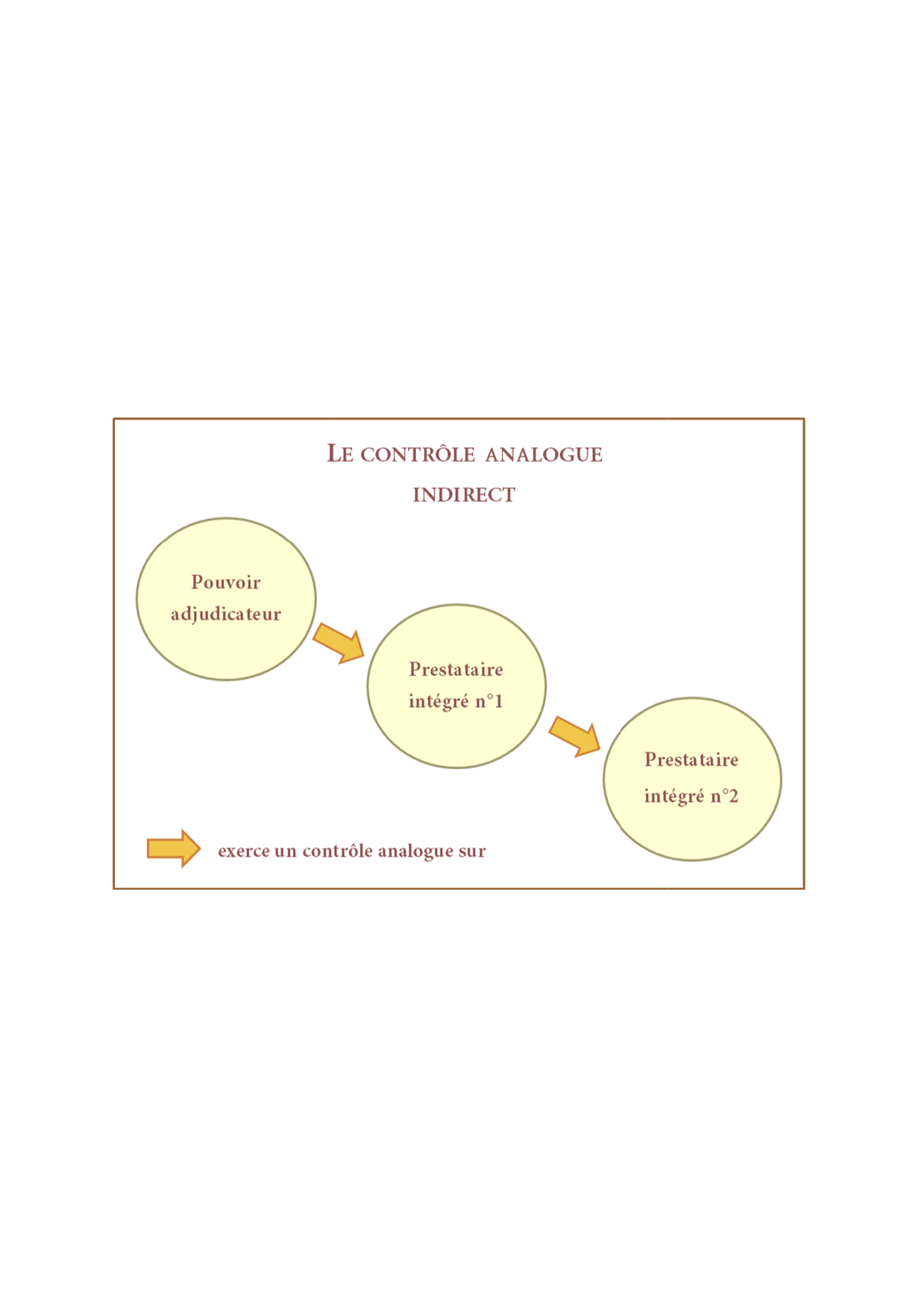par M. Clemmy FRIEDRICH
Docteur en droit public
Université Toulouse 1 Capitole – EA 4657 – Institut Maurice Hauriou (IMH)
Art. 212. Alors que s’organisait le présent dossier, le droit administratif a de nouveau été saisi à travers le prisme concurrentiel. L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques subordonne désormais la délivrance des titres d’occupation du domaine public qu’impliquent l’exercice d’une activité économique, à une obligation de publicité et, le cas échéant, à une procédure garantissant l’impartialité et la transparence de la sélection des candidatures. Le gouvernement avait été habilité à prendre une pareille ordonnance par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Sapin II, art. 34). Cette loi (art. 38) a également confié au gouvernement la tâche d’adopter un code de la commande publique à droit constant. La direction des affaires juridiques (Daj) de Bercy a présenté la méthode de travail envisagée et annoncé sa conclusion pour l’automne 2018 (lettre n° 227 du 9 mars 2017) (cf. C. Frackowiak, « De la transposition à la codification : ‘‘Cent fois sur le métier…’’ », in BJCP 2016, p. 177).
De surcroît, ladite loi a ratifié l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (art. 39) et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (art. 40). Un projet de loi de ratification avait bien été déposé devant le Sénat pour l’ordonnance « marchés publics » (21 octobre 2015), puis un nouveau pour l’ordonnance « contrats de concession » (18 mai 2016). Cependant, la chambre haute n’a eu que le temps d’examiner en commission le premier des deux projets en y apportant, ce faisant, quelques amendements (cf. le rapport du sénateur Reichardt, 16 mars 2016). Alors que l’Assemblée nationale discutait – en première lecture – du projet de loi qui devint la loi « Sapin II », le gouvernement lui a soumis deux amendements (23 mai 2016) tendant à ratifier les ordonnances précitées. In fine, les ratifications ne sont intervenues qu’avec une modification de l’ordonnance « marchés publics » (à l’initiative du Sénat qui a repris les conclusions du rapport précité). C’est pour en tenir compte qu’a été adopté le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique, afin – notamment – de modifier :
– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
– et le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.
En outre, l’ordonnance « marchés publics » a été complétée par le décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux, pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Les deux ordonnances « marchés publics » et « contrats de concession » marquent profondément le droit de la commande publique. Cela étant, elles touchent une législation qui depuis une quinzaine d’années connaît une inflation normative et l’inflexion qu’elles dessinent pourrait ne pas suffire à y mettre un terme. Il n’empêche que ces ordonnances simplifient considérablement l’architecture générale de la commande publique en alignant le droit français sur le droit européen, autour d’une dichotomie opposant les marchés publics aux contrats de concession.
Par ailleurs, l’un des principaux apports de l’ordonnance « marchés publics » est sûrement celui qui consiste à fusionner les différents textes qui, jusqu’alors, recouvraient l’ensemble de ces marchés :
– le code des marchés publics,
– l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (ces contrats s’analysant désormais comme des marchés de partenariat),
– l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces textes ont été abrogés et, avec eux, le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics (JORF des 12 et 13 novembre, p. 12880). C’est sur le fondement de ce décret-loi que le Conseil d’Etat avait reconnu la possibilité, pour le gouvernement, de réglementer les marchés publics des collectivités territoriales (CE ass., 29 avril 1981, Ordre des architectes, n° 12851 & CE ass., 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039). Avec son abrogation, le parlement recouvre sa compétence qu’il tient des dispositions de l’article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi détermine les principes fondamentaux (…) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » (cf. CC, 13 août 2015, n° 2015-257 L).
En revanche, les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics relèvent toujours, en principe, du domaine réglementaire (CC, 22 août 2002, n° 2002-460 DC, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure ; CE ass., 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039 ; CC, 13 août 2015, n° 2015-257 L). Aux termes des jurisprudences constitutionnelle et administrative, ce ne sont à proprement parler que « les conditions de passation des marchés et contrats passés par l’Etat » qui ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, sans qu’il faille distinguer entre contrats administratifs et contrats privés. Aussi la question reste-t-elle ouverte s’agissant du régime de leur exécution et de leur fin (P. Delvolvé, « Constitution et contrats publics », in Mouvement du droit public : du droit administratif au droit constitutionnel, du droit français aux autres droits. Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2004, p. 469). Cela étant, les dispositions de l’ordonnance « marchés publics » ont acquis une valeur législative depuis leur ratification par la loi « Sapin II ». Dès lors, le gouvernement ne pourrait modifier celles des dispositions pour lesquelles il demeure compétent sans, au préalable, obtenir du Conseil constitutionnel leur délégalisation.
Outre la transposition de trois directives européennes du 26 février 2014 (2014/23, 24 et 25/UE), la volonté du gouvernement a donc été celle de « simplifier l’architecture de la commande publique en unifiant les règles applicables aux différents acheteurs au sein d’un corpus juridique unique » (cf. l’étude d’impact accompagnant la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, dont l’article 42 a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance en matière de marchés publics). La commande publique repose désormais sur des textes qui en renforcent la cohérence et la performativité. Elle ne se réduit plus seulement à une notion doctrinale ou à des principes prétoriens ; elle prend appui sur une textualité dont la valeur (législative) et l’ordonnancement en rehausse le prestige. C’est une promotion qui accrédite rétrospectivement son efficacité à pallier les critiques dirigées contre la théorie des contrats administratifs.
La commande publique n’a pas encore sa théorie qui en permettrait la consécration, mais elle supplante déjà la théorie des contrats administratifs dans le vocabulaire des juristes. Il suffit de parcourir les revues juridiques pour s’en convaincre.
Tout en conservant dans ses arrêts l’expression de « contrat administratif », le Conseil d’Etat explicite sa jurisprudence en recourant plus volontiers à celle de « commande publique ». L’illustre par exemple une conférence de presse qu’il a organisée peu après l’arrêt Département du Tarn-et-Garonne en vue de préciser la portée du cycle prétorien ouvert par l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (cf. l’allocution de J.-M. Sauvé : « Les mutations contemporaines du droit de la commande publique » (3 juin 2014) et le dossier correspondant : « Le juge administratif et la commande publique »). Aussi son vice-président expose-t-il une opinion largement partagée lorsqu’il estime que la commande publique participe d’une entreprise doctrinale qui permettrait de conférer à une théorie générale des contrats publics une unité qui, aujourd’hui, n’est guère que contentieuse. La codification à venir, suggérée par le Conseil d’Etat à de nombreuses reprises, n’en serait qu’une étape :
« Si l’affirmation des principes constitutionnels et européens de la commande publique, applicables à l’ensemble des contrats publics, ont apporté une première pierre à l’édifice rénové et unifié d’une ‘‘théorie générale’’, d’autres chantiers, importants et de longue haleine, doivent encore être approfondis, dans le sillage de celui engagé par le projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises, avant l’adoption d’un code des contrats publics ou de la commande publique » (J.-M. Sauvé, « L’actualité du contentieux des contrats publics », allocution présentée lors des quatrièmes états-généraux du droit administratif, 23 juin 2014).
Dans le même sens, la commission supérieure de codification avait appelé de ses vœux qu’une telle codification soit employée à « faire ressortir les principes organisateur [de la commande publique] et fixer les délinéaments d’une théorie juridique des contrats publics » (rapport d’activité, 2011, p. 21).
Au sein de la doctrine publiciste, la théorie des contrats administratifs a de moins en moins d’audience. Elle ne conserverait une pertinence qu’au sein des facultés en continuant à trouver place parmi les canons de la pédagogie universitaire. Le conditionnel s’impose néanmoins à cet égard puisque plusieurs auteurs lui donnent encore leur adhésion – tel par exemple le professeur Plessix selon qui :
« Toute théorie est le produit de la généralisation d’une expérience singulièrement vécue. Le juriste est comme le sculpteur : il a besoin d’un modèle ; la théorie générale des obligations en droit civil a été elle-même construite sur un modèle dominant (la vente), et c’est précisément pour avoir délaissé la vie des affaires, le salariat ou le consumérisme que des rameaux spécialisés (droit commercial, droit du travail, droit de la consommation) ont dû se détacher du tronc commun, sans que les nouvelles branches ne fassent plier l’arbre. La théorie générale des contrats administratifs paraît donc avoir un avenir, pourvu que l’on cesse de lui demander d’être à la fois modèle théorique infaillible et guide pratique complet ; c’est déjà beaucoup qu’elle conserve sa vertu théorique de savoir fondamental et sa vertu pratique de droit commun » (Droit administratif général, Paris, LexisNexis, 2016, p. 1126).
Il n’en reste pas moins que les novations introduites par les ordonnances « marchés publics » et « contrats de concession » dévitalisent une théorie des contrats administratifs dont la vocation ne semble plus qu’être résiduelle. Peut-être celle-ci se cristallisera-t-elle autour d’un « régime d’ordre public des contrats administratifs » (F. Llorens & P. Soler-Couteaux, Contrats et marchés publics 2017, n° 5, repère 5). D’un certain point de vue, elle apparaît comme un illustre ancêtre qu’on n’évoque plus que par déférence ou, sinon, pour imputer une origine généalogique aux mutations contemporaines touchant les contrats publics. Il pourrait s’agir d’une théorie honoraire en quelque sorte.
Né dans le giron de la théorie des contrats administratifs, le droit de la commande publique est un théâtre où s’y expérimente une nouvelle manière d’appréhender les contrats de l’administration et, ce faisant, de les articuler au droit administratif. On n’en traite pas sans mobiliser les implicites sous-jacents aux représentations doctrinales que chacun des auteurs portent sur le droit administratif. Sous couvert de rationalisation et de simplification du droit, les ordonnances précitées consomment une évolution qui ne le doit pas seulement au droit européen. En usant de la « commande publique » comme référent, elles entérinent des inclinations doctrinales qui acculturent l’action publique au marché. La grammaire du droit administratif se renouvelle pour épouser un déterminant économique (cf. en ce sens les travaux du professeur Caillosse, notamment cet article : « Personnes publiques et concurrence : quels enjeux théoriques ? », AJDA 2016, p. 761). Le credo consensuel de la modernisation – et, avec lui, l’idée sous-jacente d’une obsolescence de notre droit administratif classique – sert la promotion de la commande publique dont le propre est de mettre ces contrats en accord avec une efficience économique de l’action publique.
Nos propos ne sont pas de ceux qui regrettent une théorie dont le classicisme peut paraître – à certains égards – décati. Quoiqu’elle fasse encore sentir son empreinte sur la culture administrativiste, la théorie des contrats administratifs ne sera jamais – à terme – qu’une page de la doctrine. Gardons-nous cependant de l’étiqueter trop vite comme une pièce archéologique. Aujourd’hui, personne ne s’est familiarisé au droit administratif autrement que par son biais. Toujours présente à nos esprits, elle oriente encore notre manière de penser les contrats de l’administration. Si le droit de la commande publique se présente comme une alternative possible à cette théorie, les mutations dont il est question dans ce dossier thématique sont l’occasion de porter cette interrogation : d’autres horizons doctrinaux ne sont-ils pas envisageables ou ne doivent-ils pas être envisagés, ne fût-ce que pour ne pas tomber d’un impérialisme doctrinal à un autre ?
Le déclin qui semble emporter la théorie des contrats administratifs serait malheureux si son hégémonie ne devait le céder qu’à celle d’une autre théorie. En effet, les bouleversements dont nous sommes contemporains peuvent n’être pas seulement facteurs d’incertitude. L’indétermination qui nous saisit est une opportunité pour discuter des présupposés auxquels la théorie des contrats administratifs nous a familiarisés. A cette fin, l’histoire du droit administratif peut être mobilisée avec profit. Non pour nous ramener vers d’anciennes formules qui, elles aussi, ont fait leur temps. Mais plutôt pour restituer la contingence de cette théorie qui ne s’est jamais imposée qu’en supplantant d’autres manières de comprendre les contrats de l’administration. Moins que le produit univoque d’un progrès auquel auraient adhéré les administrativistes, sa genèse coïncide avec une intense concurrence doctrinale. Son succès n’est peut-être pas indifférent au fait que ses initiateurs ont accompagné sa promotion d’un récit historique destiné à occulter la contingence des choix doctrinaux dont elle procède et ceux qu’elle supplante. Déclasser certaines évidences, c’est les ramener dans l’arène de la contradiction, quitte à les consacrer de nouveau – mais, le cas échéant, avec une conscience actualisée.
En ce sens, nous souhaiterions présenter trois questions qu’il ne s’agira pas tant de clore en leur assignant à chacune des réponses, que d’en expliciter les termes. Notre préoccupation est de contribuer à élargir le champ des possibles doctrinaux afin qu’il ne coïncide pas avec une théorie unique qui s’imposerait d’autant plus qu’elle serait accréditée par le droit positif. Il n’y a d’adhésion qu’au prix d’un choix qui nous fait controverser et douter.
– soyons iconoclaste : peut-on envisager une théorie des contrats de l’administration où le contrat n’en serait pas le fondement ?
– soyons sceptique : s’interroger sur la nature du contrat administratif, n’est-ce pas poser la question en des termes biaisés ?
– soyons prospectif : les contrats administratifs ne pourraient-ils pas être envisagés autrement qu’à travers un droit des contrats administratifs ?
I) D’une théorie à une autre… le contrat est-il condamné à en demeurer la pierre angulaire ?
De quoi parle-t-on s’agissant de la théorie des contrats administratifs ?
Toutes générations confondues, ceux qui aujourd’hui se prononcent sur les contrats de l’administration y ont été familiarisés par le biais de la théorie des contrats administratifs. Celle-ci a été canonisée avec le Traité théorique et pratique des contrats administratifs d’André de Laubadère (1956), mais sa consécration est aussi et surtout académique. La réforme de l’enseignement du droit réalisée en 1954 a conduit à l’assimiler à la didactique du droit administratif en en faisant un chapitre des programmes de licence (cf. notre thèse : Histoire doctrinale d’une mise en discours : des contrats de l’administration au contrat administratif (1800-1960), 2016, th. dactyl., p. 840).
Les manuels universitaires ont entériné cette promotion. A commencer par le Droit administratif de Marcel Waline (dans sa septième édition de 1957) qui fut la première publication à paraître immédiatement après ladite réforme. Les contrats administratifs y sont envisagés sous un point de vue inédit que nous avons conservé depuis. Cela n’est pas si surprenant : son auteur fut parmi les trois publicistes (avec G. Vedel et L. Trotabas) à avoir participé aux travaux préparatoires de cette réforme. D’autres le suivront en ce sens : Jean Rivero (1960), André de Laubadère (1962), Georges Peiser (1967), Francis-Paul Bénoit (1968), Charles Debbasch (1968), Georges Vedel (1968, 4e éd. de son manuel), etc.
Depuis lors, les contrats administratifs sont invariablement pris ensemble, dans le creuset d’une théorie qui leur confère une homogénéité autour de deux axes :
– les principes qui leur sont communs transcendent les singularités de chacun et permettent de leur assigner une même origine : ils sont tous des contrats,
– la singularité qui les distingue des contrats privés permet de les aligner dans le fil de la summa divisio : ils sont tous autonomes du droit privé.
Cette entreprise doctrinale qu’a initiée Gaston Jèze, est de celles qui – dans l’Entre-deux-guerres – ont favorisé des interactions entre le droit public et le droit privé. Si, auparavant, les administrativistes n’ont jamais ignoré le contrat, celui-ci n’en restait moins cantonné à la marge du droit administratif. Au contraire, la théorie des contrats administratifs, qui est une théorie du contrat, a acculturé ce concept privatiste au droit administratif. C’est en ce sens que le professeur parisien Achille Mestre écrivait – avec un a priori favorable à cette inclination doctrinale :
« Le contrat constitue l’institution essentielle du droit civil, qui est demeurée longtemps si étrangère au droit public que l’expression même de ‘‘contrat administratif’’, combattue par nombre d’auteurs, n’est passée qu’assez récemment dans la langue juridique courante » (Note sur l’arrêt Bureau international de l’édition musico-mécanique (CE, 21 janvier 1938), in Sirey 1940. 3. 9).
Cette administrativisation du contrat est un corolaire de la privatisation latente du droit administratif que le doyen aixois, Louis Trotabas, présentait sous une plume critique :
« En même temps que la période de conquête du droit administratif prenait fin [aux tournants des années 1920], l’influence du droit privé apparaissait dans ses propres frontières et s’y développait. L’idée lointaine de collaboration des particuliers au service public a permis de jeter des ponts entre le monde administratif et la vie privée » (« La gestion des services publics : gestion publique ou gestion privée ? », in L’Etat moderne 1938, n° 11, p. 210).
Voilà de quoi la théorie des contrats administratifs est le faux-nez.
Au demeurant, sa pérennisation n’a pas clos les interrogations sur le fait de savoir si cette théorie était un facteur de privatisation du droit administratif (cf. par ex. : F. Chauvin, « Vers la privatisation du droit des contrats de l’administration ? Limites et paradoxes d’une évolution contrastée », in Mélanges en l’honneur de Henry Blaise, Paris, Economica, 1995, p. 95).
Il ne s’agit pas de lui adresser des critiques à cet égard, mais d’en discerner les ressorts doctrinaux : savoir l’acculturation du contrat au droit administratif. Georges Péquignot mis à part, tous les administrativistes ayant consacré des développements substantiels au contrat administratif ont insisté sur sa parenté originelle avec le contrat. A ce point que cette hypothèse doctrinale est un lieu commun de notre culture administrativiste. L’essentiel des critiques dirigées contre la théorie des contrats administratifs ne l’ont jamais remise en cause et c’est sur d’autres aspects qu’elles ont porté.
Ce contrat originel est un point de fuite au regard duquel les contrats administratifs sont mis en perspective. Quoiqu’il soit placé en dehors de la positivité du droit, il oriente la compréhension que nous avons de ces contrats.
Le contrat : point de fuite de la théorie des contrats administratifs
Si le droit de la commande publique est – incontestablement – le vecteur d’une novation, il ne nous semble pas être subversif de la théorie des contrats administratifs. Certes, la typologie qui s’organise autour de la commande publique implique de profonds bouleversements que nous ne saurions négliger. La summa divisio entre les marchés publics et les contrats de concession en est la principale illustration, qui aligne ces concepts sur le droit européen, en simplifie les lignes et en précise les rapports qui les unissent dans le creuset de la commande publique. Pourtant, les évolutions du droit positif depuis les années 1990 ont presque toutes été interprétées sous un jour qui dénote la prégnance de la théorie des contrats administratifs. Nonobstant les critiques qui lui ont été adressées, nous avons toujours le souci d’une définition générique susceptible d’embrasser un ensemble cohérent de contrats et d’ordonner leur hétérogénéité suivant une typologie qui rende compte des régimes juridiques spécifiques à chacun. Il s’agit tout à la fois d’organiser des catégories entre lesquelles se distribuent leurs singularités, et d’abstraire des caractères originaux qui soulignent leur autonomie vis-à-vis du droit privé.
Qu’on suppose aux contrats administratifs une nature irréductible aux contrats privés ou bien qu’on les présente comme une espèce d’un genre commun à tous les contrats, ils ne cessent d’être conçus à partir d’un artefact originel. C’est en ce sens que plusieurs des ouvrages consacrés au droit des contrats administratifs s’ouvrent sur des développements liminaires consacrés au contrat : tel le traité d’André de Laubadère à la réédition duquel ont contribué les professeurs Delvolvé et Moderne (1983) ou le manuel du professeur Richer (1991). Il en va de même pour les ouvrages des professeurs Ubaud-Bergereon (2015) et Hœpffner (2016) bien que leurs approches s’enrichissent d’autres problématiques. Point d’entrée obligé, le contrat oriente l’intelligence de la matière. Il accrédite l’idée d’une théorie des contrats administratifs et justifie le plan qui en découle.
Selon d’aucuns, la théorie générale du contrat résulte de la science du droit ; sa positivité serait un mythe entretenu par la doctrine privatiste (cf. E. Savaux, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, Paris, LGDJ, 1997). De même, nous dirions (sans beaucoup d’originalité) que la théorie des contrats administratifs postule les présupposés sur lesquels elle fonde sa propre justification. Leur hétérogénéité pourrait amener à conclure – à l’instar du professeur Drago – qu’il y a trop de dissemblances pour les appréhender au travers du même prisme. C’est que cette théorie ne les subsume qu’en esquissant un contrat administratif dont la définition générique s’appuie sur une généalogie prestigieuse qui l’unit au contrat et l’apparente au contrat privé. Ainsi, le contrat administratif pourrait être présenté comme une clef de voûte si haut placée qu’on ne l’apercevrait qu’à peine du sol ; notre regard ne la distinguerait qu’en la devinant à la pesanteur massive des colonnes qui s’élèvent ensemble vers elle.
De surcroît, le contrat administratif se renforce de son opposition avec l’acte administratif unilatéral : tous deux convergent vers une théorie des actes juridiques de l’administration. Cette dichotomie sert une fonctionnalité – ne fût-ce que pédagogique – qui fait du contrat un concept (quasi) nécessaire pour notre droit administratif.
Certes, l’opposition entre les actes unilatéraux et les contrats s’atténue en droit privé et certains administrativistes s’en sont fait l’écho. Cela étant, au lieu d’ouvrir des perspectives doctrinales qui conduiraient à comprendre différemment les actes de l’administration, la centralité du contrat – en droit administratif – n’en est que plus accusée. En paraissant converger, contrat administratif et contrat privé font admettre l’idée d’une identité commune. La réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 renforce ce sentiment en consacrant notamment (cf. P.-Y. Gahdoun & M. Ubaud-Bergeron, « Regards publicistes sur la réforme du droit des contrats », in BJCP 2016, p. 317) :
– l’exception d’inexécution (art. 1219 du code civil) et l’exception d’inexécution anticipée (art. 1220 cod. civ.),
– la substitution unilatérale du débiteur défaillant (art. 1222 cod. civ.),
– la réduction unilatérale du prix en cas d’exécution partielle (art. 1223 cod. civ.),
– la résolution unilatérale aux risques et périls du créancier lorsque le débiteur ne s’exécute pas (art. 1226 cod. civ.).
Un tel mouvement permet d’argumenter en faveur d’une réduction de la summa divisio et de souligner la parenté qui rapprocherait tendanciellement tous les contrats. La singularité des contrats administratifs aurait été outrée au moment de leur théorisation afin de mieux justifier l’autonomie du droit administratif dont ils sont un vecteur (cf. F. Brenet, « La théorie du contrat administratif. Evolutions récentes », in AJDA 2003, p. 919). L’évolution concordante des droits privé et public des contrats attesterait, en droit administratif, de la fonction structurante du contrat (pour une illustration récente : C. Gilles, « La réforme du Code civil et les contrats publics : vers la consécration d’un droit commun des contrats ? », in Contrats et marchés publics 2017, n° 2, étude 2).
Le contrat contre vents et marées
Les ordonnances dont procède la réforme de la commande publique accompagnent assez bien cette évolution puisqu’elles organisent une typologie des contrats de la commande publique – partagée entre les marchés publics et les contrats de concession. En outre, celle-ci repose sur une définition textuelle qui ancre lesdits contrats dans une réalité positive (cf. les art. L. 551-1, 551-5 et 551-13 du code de justice administrative, issus de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique). Ne s’agirait-il pas d’une nouvelle mise en ordre dont la cohérence postule, pareille à la théorie des contrats administratifs, une originalité propre à structurer les contrats publics ? L’inédit dont ces ordonnances sont le vecteur se déploie toujours autour du contrat. La commande publique emprunte des prémisses analogues à ceux de ladite théorie, si bien que le contrat en modèle toujours la rationalité.
« Si l’on se résout à parler des contrats de la ‘‘commande publique’’ pour couvrir à la fois les marchés publics et les concessions, (…) ce n’est pas seulement pour la commodité d’une formule englobante, c’est aussi par discipline et finalement par raison » (P. Delvolvé, « Les contrats de la ‘‘commande publique’’ », in RFDA 2016, p. 200).
La commande publique propose une nouvelle partition dont la logique ne tient plus à l’originalité du régime d’exécution des contrats administratifs mais au régime de leur passation. En s’articulant à une problématique propre au contrat ut universi (la rencontre des volontés), elle continue à faire du droit des contrats administratifs une matière centrée sur le contrat.
L’opérationnalité de cette partition résulte de ce qu’elle organise ensemble les contrats administratifs en les situant dans son orbite. Cela ressort, par exemple, de la typologie proposée par le professeur Hœpffner dans son ouvrage sur le droit des contrats administratifs (2016). Elle y distingue, en effet, les contrats de la commande publique de ceux qui – dans un premier cercle concentrique – se situent à la marge de la commande publique, puis de ceux qui – dans un second cercle concentrique – sont exclus de la commande publique. Cette fonctionnalité doctrinale de la commande publique a été soulignée dès la fin des années 1990 : soit pour en montrer la cohérence avec l’évolution historique des pratiques contractuelles de l’administration (X. Besançon, Essai sur les contrats de travaux et de services publics : contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique, Paris, LGDJ, 1999 ; et du même auteur : « Typologie, contenu et droit comparé des contrats publics », in Revue du marché unique européen 1999, n° 3, p. 11) ; soit pour en démontrer la valeur à titre prospectif, en tant que la commande publique constituerait une véritable notion juridique susceptible d’assimiler les évolutions du droit positif (G. Kalflèche, Des marchés publics à la commande publique : l’évolution du droit de la commande publique, th. dactyl., 2004).
A la même époque, une partie de la doctrine s’est davantage essayée à promouvoir une théorie des contrats administratifs spéciaux. Pour d’aucuns, il s’agit de parfaire une théorie des contrats administratifs en vue de dégager, en droit administratif, une théorie des obligations qui puisse favoriser les correspondances avec le droit privé (cf. Y. Gaudemet, « Prolégomènes pour une théorie des obligations en droit administratif français », in Mélanges en l’honneur de Jean Gaudemet : Nonagesimo anno, Paris, PUF, 1999, p. 613). Ces réflexions coïncident avec un phénomène de spécialisation des contrats administratifs qui a suscité des interrogations sur ses implications à long terme : facteur d’enrichissement d’une théorie générale des contrats administratifs ou émancipation – à terme – d’une théorie spéciale des contrats administratifs ? Le professeur Brenet argumente en faveur de la première hypothèse (« Les contrats administratifs », in P. Gonod, F. Melleray & Ph. Yolka, Traité de droit administratif, Paris, Dalloz, 2011, t. 2, p. 263). Sous la plume de certains, la formalisation d’une théorie des contrats spéciaux s’est accompagnée d’une définition générique substituant au contrat administratif le contrat public. Il y est moins question de saisir l’originalité d’une technique contractuelle asservie à l’action administrative, que de rendre compte des modes contractuels employés par les personnes publiques (et les entités adjudicatrices) en soulignant l’unité qui y est sous-jacente (cf. L. Marcus, L’unité des contrats publics, Paris, Dalloz, 2010).
Suivant une perspective pas si différente, quelques auteurs agréent la théorie des contrats administratifs tout en y introduisant une summa divisio entre les contrats à objet économique et ceux à objet non-économique (Ph. Terneyre, « Existe-t-il encore une théorie générale des contrats administratifs », in CP-ACCP 2010, n° 100, p. 14 ; L. Vidal, « La classification des contrats administratifs économiques, les mots et les choses ou l’esquisse d’un programme », in Mélanges en l’honneur du professeur Laurent Richer. A propos des contrats des personnes publiques, Paris, LGDJ, 2013, p. 311).
En entrecoupant les problématiques abordées par ces derniers auteurs, la commande publique a suscité – à l’encontre de la théorie des contrats administratifs – des critiques d’un autre ordre, dénonçant au fond son impuissance à pouvoir s’accorder au droit européen des contrats publics. Non plus qu’une question tenant à sa cohérence intrinsèque, les défauts de cette théorie résulteraient de sa disharmonie avec le droit européen (cf. M. Amilhat, La notion de contrat administratif : l’influence du droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2014).
Qu’il s’agisse de repenser la théorie des contrats administratifs à l’aune du droit privé ou de la subvertir pour l’aligner sur le droit européen ; qu’il s’agisse de l’organiser autrement ou d’y substituer une autre théorie fondée sur le contrat public, ces doctrines ont en commun de conserver au contrat sa centralité. A l’instar de la théorie formalisée par Gaston Jèze, elles postulent un contrat dont les déclinaisons saisissent l’hétérogénéité du réel et dont le cadre agence, par superposition, les principes qu’il est question de valoriser : ici ce sont les corollaires de l’autonomie de la volonté, là c’est l’efficience économique de l’action publique. C’est pourquoi ces diverses doctrines nous paraissent se présenter comme des avatars de la théorie déclinante. Chacune à leur manière, elles entérinent son architecture théorique qui postule un singulier auquel se rapporte la pluralité des contrats. Il n’est pas impossible de supposer que, à terme, elles s’exposeront à des critiques pareilles à celles qui affectent la théorie des contrats administratifs et qui, en ce sens, souligneront :
– l’artificialité des principes sur lesquels repose la démonstration d’une théorie générale,
– l’hétérogénéité des contrats spéciaux auxquels correspondent des problématiques spécifiques.
Elargir le champ des possibles doctrinaux : le concours de la théorie de l’institution
Pourrait-il en être autrement (avant même d’apprécier si cela serait souhaitable) ? Sans convoquer de vieilles formules qui n’appartiennent désormais qu’à l’histoire, celle-ci est propre à démontrer que la théorisation des contrats administratifs est une entreprise doctrinale dont la pertinence ne peut être éprouvée qu’à l’aune de projets doctrinaux alternatifs. Il ne s’agit pas d’y trouver des exemples pour forcer l’avenir, mais de déployer des contrechamps qui nous permettent d’expliciter les présupposés que nous admettons implicitement en adhérant à la théorie des contrats administratifs. Car si nous la critiquons souvent, nous en conservons l’architecture qui détermine encore notre manière de penser les contrats de l’administration.
La théorisation des contrats administratifs, au cours de l’Entre-deux-guerres, n’est pas la consécration d’une réflexion doctrinale qui aurait été entamée dès les années 1900. La théorie qu’élabora Gaston Jèze – accompagné par d’autres comme Marcel Waline – ne fut qu’une manière de comprendre les bouleversements induits par la Première Guerre mondiale. C’est pourquoi il est malaisé d’en cerner la genèse sans avoir à l’esprit la théorie de l’institution avec laquelle elle fut en concurrence. Restituer les options doctrinales qu’a entérinées la théorisation des contrats administratifs, c’est expliciter ce à quoi elle nous a habitué.
Dans ses travaux consacrés à Maurice Hauriou, le professeur Sfez a écrit que celui-ci « n’a jamais été très inspiré par la théorie des contrats administratifs, à laquelle il consacre des passages dérisoires – en qualité et en quantité » (Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif français, Paris, LGDJ, 1966, p. 444). Pour autant, s’est-il désintéressé des contrats de l’administration ? Contemporain de Gaston Jèze, il a appréhendé à sa manière les mutations qui ont touché ces contrats. S’il n’a pas adhéré la théorie des contrats administratifs, c’est parce que celle-ci est venue borner des perspectives que le doyen toulousain souhaitait, au contraire, développer dans le fil de la théorie de l’institution (cf. notre thèse précitée, p. 723).
Cette divergence se fait spécialement sentir à propos de la théorie de l’imprévision. Dans la continuité des arrêts Thérond (1910) et Société des granits porphyroïdes des Vosges (1912), celle-ci reconnaît une originalité aux seuls contrats dont l’objet est d’associer les particuliers au fonctionnement des services publics plutôt que de les solliciter ponctuellement pour une prestation qui les cantonne à la marge desdits services. Ce sont des contrats frappés par l’idée de collaboration et de permanence. C’est en ce sens que, selon Maurice Hauriou, le contrat concessif est une marche vers l’institution. Appréhendé stricto sensu, il n’est qu’une hypothèse trop étriquée pour rendre compte de ces relations qui confèrent à l’interdépendance des contractants – c’est-à-dire à la solidarité de leurs intérêts respectifs – une portée juridique (et non pas seulement économique).
« Tout le contrat administratif est comme écrasé par l’importance de son objet ; le contrat a essayé d’embrasser dans ses clauses une institution vivante ; mais la tâche est au-dessus de ses forces, et l’institution déborde de tous les côtés » (Note sur l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux (CE, 30 mars 1916), in Notes d’arrêts sur décisions du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits, Paris, Editions la Mémoire du Droit, 2000, t. 3, p. 607).
C’est pourquoi cet auteur n’a pas estimé que cette théorie eût vocation à rester cantonnée au droit administratif. De son point de vue, l’imprévision n’est pas caractéristique de l’autonomie du droit administratif. Elle met en exergue une gestion pérenne organisée autour de l’idée de collaboration que favorise la confluence d’intérêts ; là où le contrat stricto sensu oppose ponctuellement des intérêts antagonistes avivés par l’idée de spéculation. Pour le dire autrement, il a pris prétexte de la théorie de l’imprévision pour dépasser le contrat et plier certains d’entre eux à l’institution. Il n’a pas tant soulevé une opposition entre des contrats administratifs et des contrats privés, qu’entre des contrats de prestation unique et des contrats de collaboration.
Gaston Jèze a poursuivi une démarche différente. Sa théorie des contrats administratifs a eu pour ambition de fixer la portée de la théorie de l’imprévision. Le contrat en est placé au centre : d’une part, pour circonscrire cette théorie aux seuls contrats administratifs et, d’autre part, pour retrancher de l’exécution du contrat les charges extracontractuelles résultant de l’imprévision. En même temps qu’elle justifie l’autonomie du droit administratif, sa théorie use du contrat pour borner les virtualités subversives de la théorie de l’imprévision. Le concours pécuniaire exigé de l’administration en dehors des termes du contrat est rattaché au service public qui en fonde la justification.
Cela ressort notamment de sa classification des contrats administratifs. Au lieu de distinguer, à titre principal, les contrats à exécution instantanée des contrats à exécutions successives (à l’instar de Maurice Hauriou), Gaston Jèze cantonne cette dichotomie à un rang secondaire. Il ne l’évoque que pour préciser la nature de certains contrats administratifs, tels par exemple les marchés de fournitures :
« Les marchés de fournitures continues ou multiples sont essentiellement des contrats de bonne foi, c’est-à-dire que les droits et obligations respectives doivent être interprétés de bonne foi, de manière équitable, et non pas seulement d’après la lettre du marché. Il y a une partie extracontractuelle considérable. Dans les marchés de fourniture unique ou isolée, pour connaître les droits et les obligations, il faudra s’attacher, avant tout, à ce qui a été formellement stipulé. La partie extracontractuelle est très minime ou même absente » (Les contrats administratifs, Paris, Giard, 1927, t. 1, p. 43).
Il y insiste seulement pour souligner les « différences d’ordre économique » qui permettent de « comprendre le régime juridique applicable » à certains contrats administratifs, tels les marchés de fournitures et de transport (ibid., t. 1, p. 49). Leur régime se précise en effet selon le degré d’intimité qui lie le contractant de l’administration au fonctionnement du service public.
Pour bien saisir l’originalité de la théorie formalisée par Gaston Jèze, il convient d’avoir à l’esprit qu’elle rompt avec les doctrines couramment admises pendant la Belle-Epoque. Jusqu’à la fin des années 1910, les administrativistes distinguaient, d’un côté, les contrats que nous appellerions de nature concessive et, de l’autre, les contrats à prestation unique (marchés de fournitures ou de transport). Ces deux catégories participaient de réflexions différentes, compte tenu du fait qu’ils soulevaient des problématiques spécifiques. Autrement dit, ces administrativistes ne se sont pas engagés dans une approche qui, en supposant une théorie commune aux contrats administratifs, les eût conduits à lier des réflexions auxquelles correspondaient des enjeux divergents.
En faisant du contrat un concept cardinal du droit administratif, Gaston Jèze atténua cette opposition pour la reléguer à un rang secondaire. Il proposa une théorie géométrique grâce à laquelle un contrat administratif générique pût rapporter le pluriel au singulier. C’est la méthode qui y est sous-jacente que le professeur nancéen Georges Renard critiqua vivement : saisie par le biais de la technique juridique, la science du droit administratif paraît tirée au cordeau.
« Le Droit, pour cette école, est la science des cadres. Son ordonnance n’a à répondre qu’aux exigences formelles de l’intellect. Il joue, vis-à-vis des autres sciences de l’homme et de la société, un rôle analogue à celui de la géométrie vis-à-vis des sciences physico-chimiques » (« Sur quelques orientations modernes de la science du Droit », in Revue des jeunes 1922, p. 159).
Est-on condamné à comprendre les contrats de l’administration avec la même théorie ?
La théorie des contrats administratifs n’a rien de naturelle. Pas plus (et ni moins) que celle qui lui fut concurrente, elle consacre une manière de comprendre les contrats de l’administration. Certes, la théorie de l’institution a été la principale alternative doctrinale à cette théorie, sinon la seule. Cela ne signifie pas qu’il n’y aurait que deux options envisageables. Cependant, le contraste qu’elle soulève avec la théorie des contrats administratifs permet d’expliciter les prémisses sur lesquelles celle-ci est fondée et force d’admettre qu’ils ne valent que pour autant qu’on les accepte.
Du reste, la théorie de l’institution n’est peut-être pas qu’une hypothèse historique (cf. notre article : « Communications électroniques et contrats : un détour par l’histoire et la notion d’institution », in Communications électroniques : objets juridiques au cœur de l’unité des droits, Le Mans, Editions l’Epitoge, 2012, p. 83).Pour sa part, le professeur Weber proposait d’en actualiser la valeur pour distinguer plusieurs catégories de contrats en tant que chacune « possèder[ait] [une] spécificité propre, inassimilable aux autres » (« La nature juridique des concessions administratives d’activités industrielles et commerciales (contribution à une théorie des contrats institutionnels) », in Aspects actuels du droit commercial français : commerce, sociétés, banque et opérations commerciales, procédures de règlement du passif : études dédiées à René Roblot, Paris, LGDJ, 1984, p. 62). A savoir :
– les « contrats institutionnels » (contrats de service public, de travaux publics ou d’ouvrage public),
– les « contrats de prestations à l’Administration » (marchés publics),
– les « contrats d’exploitation patrimoniale » (contrats domaniaux).
Dans une perspective pas si différente de celle-ci, le professeur Hubrecht proposait d’appréhender ensemble tous les contrats de service public qu’il définissait comme ceux « ayant pour objet d’organiser et de fixer les modalités de fonctionnement d’un service public » (Les contrats de service public, th. dactyl., 1980, p. 3). Avec le professeur Melleray, il soutenait que la partition introduite par le régime de passation n’est relative qu’à cette question. Elle oppose des contrats dont l’objet de chacun pourrait, au contraire, justifier un rapprochement (« L’évolution des catégories notionnelles de la commande publique. Retour sur les contrats de service public », in Contrats publics : mélanges en l’honneur du professeur Michel Guibal, Montpellier, Presses de la faculté de droit de Montpellier, 2006, t. 1, p. 809).
Ces propositions doctrinales ne cessent d’être stimulantes. Resteraient-elles à l’état de virtualité, elles n’en soulignent pas moins le fait qu’adhérer à une certaine approche de la matière, c’est toujours choisir. « Le meilleur moyen de comprendre et d’expliquer le droit positif, fonction première des universitaires, n’est certainement pas de le décrire de trop près mais bien davantage de l’observer avec un certain recul et un soupçon d’esprit critique » (ibid., p. 823).
La théorie actuelle des contrats administratifs (ou une autre élaborée sur le même canevas) n’enferme-t-elle pas les réflexions que nous pourrions développer sur chacun de ces contrats, étant supposé que l’unité qu’elle leur suppose dresse des frontières indicibles ? C’est ce qui a motivé certains contemporains à promouvoir une théorie des contrats administratifs spéciaux – tel le professeur Brenet (art. préc.). Ces interrogations n’en restent pas moins placées sous le couvert de la théorie générale des contrats administratifs. C’est d’ailleurs pour en surmonter les faiblesses et pour en valider la pertinence que ceux-là œuvrent en ce sens. Si une théorie des contrats administratifs spéciaux permet d’envisager plus librement la singularité de certains d’entre eux, elle ne cesse d’être une excroissance de la théorie générale des contrats administratifs.
Cela interroge sur la pesanteur qu’exerce cette théorie sur nos esprits, laquelle continue de déterminer notre manière de comprendre les contrats de l’administration. D’où la question de savoir si d’autres approches concurrentes seraient envisageables qui ne poseraient pas comme prémisse celle de réduire l’hétérogénéité de ces contrats à l’aune du concept unificateur de contrat. Ne fût-ce que pour actualiser notre adhésion à la théorie des contrats administratifs, cette question aiderait à expliciter les présupposés que celle-là mobilise et les perspectives dans lesquelles elle nous cantonne. En ce sens, la prospective du droit gagne à être accompagnée de son histoire.
II) « Le contrat administratif est-il un contrat ? » : la question est-elle bien posée ?
La nature du contrat administratif : la réponse ne précède-t-elle pas la question ?
Dans les propos qui précèdent, nous faisions cette remarque : si le contrat administratif invite à comprendre les contrats administratifs ensemble, on pourrait concevoir d’autres manières d’appréhender ces contrats. Notamment sous un prisme qui ne sacrifierait pas leur hétérogénéité et qui, bien au contraire, permettrait de les considérer spécifiquement, selon leurs problématiques respectives.
Sont-ils des contrats d’ailleurs ? Sont-ils tous des contrats ? La question est inutile si l’on s’élance aussitôt à répondre par l’affirmative ou la négative. Au tournant des années 1950, cette question s’est posée en des termes vifs. Georges Péquignot fut isolé – sinon le seul – à douter du caractère contractuel des contrats administratifs (cf. Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Perpignan, Imprimerie du Midi, 1945). Gaston Jèze, André de Laubadère, Jean L’Huillier et d’autres lui opposèrent la contradiction avec succès. Malgré une thèse qui fut remarquée par ses contemporains, Georges Péquignot n’a pas emporté l’adhésion.
Le précédant de peu, Achille Mestre fut de ceux qui travaillèrent le plus à souligner la contractualité des contrats administratifs (cf. notre thèse précitée, p. 824). Si de nos jours il n’est pas présenté comme un protagoniste de la théorisation des contrats administratifs, il en fut pourtant un acteur prépondérant. En dispensant à la faculté de Paris des cours que nous rangerions aujourd’hui sous l’expression de « droit public des affaires » (il en aurait été un précurseur selon le professeur Melleray), il manifesta un soin tout particulier à analyser la théorie des contrats administratifs « comme l’adaptation nécessaire au droit administratif d’une théorie générale du droit civil, la théorie des contrats » (Répétitions écrites de droit administratif [cours de contentieux administratif pour le diplôme d’études supérieures de droit privé], Paris, Les cours de droit, 1931, p. 9). C’est ce qui l’incita à réinterpréter le fameux arrêt Ministre des travaux publics c. Compagnie générale française des tramways (CE, 11 mars 1910) en un sens qui le mît en accord avec une appréhension contractualiste des contrats administratifs.
« Toute la jurisprudence dit, redit et proclame que la Concession est un Contrat, n’est qu’un Contrat. Sans doute, c’est un Contrat administratif soumis aux règles particulières du Droit administratif qui ne suppriment certes pas celles du Droit civil, mais les complètent, les assouplissent, les orientent. (…) Adaptée aux exigences de la vie administrative, la Concession demeure un Contrat » (« Préface », in P. Teste, Les services publics de distribution d’eau, de gaz et d’énergie électrique, Paris, Dalloz, 1940, p. xij-xiij).
Se demander si le contrat administratif est un contrat est une cause perdue. Il peut en aller différemment si, d’une part, on soulève cette interrogation en restituant le pluriel pour se la poser à propos de chaque contrat administratif et si, d’autre part, on n’oppose pas le contrat à l’acte unilatéral comme deux antagonistes en dehors desquels rien ne serait concevable. Comment pourrait-on discuter de cette question si la seule alternative consiste à imputer au contrat administratif une nature qui jure avec sa dénomination ? La réponse paraît admise avant même de pousser l’investigation plus en avant.
Là encore, il n’est pas dans notre propos d’affirmer que les contrats administratifs confineraient avec les actes unilatéraux, mais d’expliciter que la nature que nous leur reconnaissons détermine notre manière de les comprendre. C’est en ce sens que le professeur Morand-Deviller nous met en garde contre les « risques et dérives nés de ce fétichisme contractuel » (« Le commerce juridique. Consensualisme et convivialisme : il y a cent ans Maurice Hauriou », in Mélanges en l’honneur du professeur Laurent Richer…, op. cit., p. 226).
Le contrat administratif : une nature contractuelle admise plutôt que discutée
De nos jours, les contrats administratifs sont des contrats : c’est entendu. « Il n’y a guère à épiloguer à ce sujet : [les] définitions [des diverses espèces de contrats] ont une portée universelle. On peut seulement relever des particularités qu’elles peuvent rencontrer dans la sphère administrative » (P. Delvolvé, « Les nouvelles dispositions du code civil et le droit administratif », in RFDA 2016, p. 613). Dans le sillage des travaux des professeurs Drago et Llorens, le professeur Richer n’est pas moins éloquent : « La notion générale de contrat est et ne peut être que la même en droit public et en droit privé » (Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 1995 (1re éd.), p. 7).
Cette conception des choses donne appui aux travaux qui tendent à atténuer la différence opposant les contrats administratifs aux contrats privés de l’administration (cf. à ce titre la thèse du professeur Llorens : Contrat d’entreprise et marché de travaux publics : contribution à la comparaison entre contrat de droit privé et contrat administratif, Paris, LGDJ, 1981). Dans le sillage de la thèse du professeur Lamarque (Recherches sur l’application du droit privé aux services publics administratifs, Paris, LGDJ, 1960), certains auteurs préfèrent embrasser ensemble tous les contrats de l’administration, au motif que la singularité des contrats administratifs aurait été exagérée et que, du reste, les contrats privés de l’administration ne seraient jamais des contrats tout à fait identiques à ceux que passent les particuliers entre eux. Tous les contrats publics sont soumis à des règles de droit public qui tiennent à la qualité des personnes publiques qui y sont liées. Quoique dans des proportions variables, l’intérêt général est toujours prégnant dans les contrats publics. Ainsi se décline-t-il suivant une « échelle de contractualité de l’intérêt général » (G. Clamour, « Esquisse d’une théorie générale des contrats publics », in Contrats publics : mélanges en l’honneur du professeur Michel Guibal, op. cit., t. 2, p. 680). Dans le même ordre d’idées, le professeur Eckert proposait de comprendre la diversité des contrats de l’administration suivant une « échelle d’exorbitance » (« Droit administratif et droit civil », in Traité de droit administratif, op. cit., t. 1, p. 641). Il estimait à cet égard que :
« Une telle perspective (…) montre (…) qu’il n’y a pas tant une différence de nature, qu’une simple différence de degré entre les contrats de droit public et les contrats de droit privé de l’Administration. Le régime, fondé sur l’opération économique qu’ils réalisent et la part de prérogatives de puissance publique conservée par le contractant public, doit donc être fait de continuum et non de rupture » (« Les pouvoirs de l’Administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des contrats administratifs », in Contrats et marchés publics 2010, n° 1, étude 9).
D’autres avant lui ont avancé des expressions similaires : « échelle de contractualité » (Auby, 1979) ou « échelle de publicisation des contrats » (Llorens, 1981). Le professeur Brenet parle d’une « échelle d’administrativité » dans le dessein spécifique d’organiser une théorie des contrats administratifs spéciaux qui rende compte de l’hétérogénéité des contrats administratifs (« La théorie du contrat administratif. Evolutions récentes », in AJDA 2003, p. 91).
Ces locutions et les doctrines qu’elles explicitent ré-embrassent à certains égards celle d’un auteur qui fut un contradicteur original de Maurice Hauriou et qui, de nos jours, n’est plus qu’un nom secondaire parmi les publicistes de la première moitié du XIXe siècle : nous visons le professeur parisien René Jacquelin. Celui-ci défendait cette idée que les actes de l’administration se répartissaient suivant une gradation étirée « entre deux points extrêmes : la puissance publique et la patrimonialité » (Une conception d’ensemble du droit administratif, Paris, Giard & Brière, 1899, p. 18).
« On peut dire que l’État présente deux caractères, celui de puissance publique et celui de patrimonialité, mais il ne faut pas perdre de vue que ces deux caractères coexistent dans la même personne, et que dès lors il est inévitable que le premier fasse encore sentir son influence sur le second. [Dans tous les cas, le contrat] est un acte de patrimonialité, et il y a exagération à prétendre le régir par les mêmes règles que les actes d’autorité. L’erreur est aussi réelle que celle qui consiste en sens inverse à considérer les actes de gestion du domaine privé comme des manifestations d’une personnalité privée, et à les soumettre à toutes les règles du droit civil » (ibid., p. 19).
Le propos de cet auteur était de souligner tout à la fois la contigüité du droit administratif avec le droit civil et l’irréductible spécificité du droit administratif qui ne cesse d’aménager pour l’administration des singularités dans toutes les hypothèses où celle-ci recourt au droit privé.
Si, aujourd’hui, l’idée d’échelle est rapprochée de Léon Duguit qui en usa à propos de la domanialité, elle serait plutôt « redevable » envers René Jacquelin. La référence serait moins prestigieuse mais peut-être plus exacte. Sans doute, nos contemporains ne s’inspirent pas d’un auteur qui est peu lu. Cette concordance (fortuite) n’est pas moins pas intéressante car elle permet de les situer au regard de doctrines si différentes que furent celles de Jacquelin et Jèze. Ce n’est pas dire que ceux-là se rangeraient catégoriquement derrière l’un ou pour l’autre. Force est de reconnaître, cependant, que leur dessein est plutôt celui de corréler le droit administratif au droit civil (à l’instar de Jacquelin) que celui d’autonomiser le droit administratif du droit civil (à l’instar de Jèze). En penchant pour une conception du contrat administratif qui soit harmonieuse avec l’unité du droit (cf. B. Plessix, « La part de la doctrine dans la création du droit des contrats administratifs », in Revue de droit d’Assas 2011, n° 4, p. 46), la doctrine contemporaine marque une inclination doctrinale qui, par-dessus l’héritage fondateur de Gaston Jèze, nous semble plus en phase avec la doctrine d’un auteur de la Belle-Epoque qu’est René Jacquelin. Derrière les courbures de la pensée juridique (qui n’est pas un retour en arrière), se dessine la liberté des auteurs dont la réception des autorités doctrinales est souvent pleine d’équivoques fécondes.
L’approche dont il est question – prônée entre autres par les professeurs Llorens, Eckert, Clamour, etc. – est pertinente à maints égards. Elle attire l’attention sur des règles qui, souvent, sont négligées au seul motif qu’elles ne permettent pas de singulariser les contrats administratifs et de caractériser l’autonomie du droit administratif. Ce sont des règles qui tiennent à la manière d’engager le consentement de la personne publique contractante, aux voies d’exécution, au droit domanial, au droit budgétaire, etc.
Il n’en faut pas moins ajouter que le fait de se représenter les contrats administratifs selon une échelle graduée conduit à les placer sur un même plan. Cette doctrine postule qu’ils ont la même nature ou – pour éviter ce terme équivoque – qu’ils doivent être considérés sous le même prisme. Car autrement leur rapprochement n’aurait pas de sens. Le continuum sur lequel s’alignent les contrats administratifs entérine silencieusement leur nature contractuelle alors qu’une telle question pourrait se poser et faire douter pour certains d’entre eux. Elle leur présume une unité qui néglige, à certains égards, leur hétérogénéité. Elle pose un dénominateur commun qui incline à les comprendre suivant une perspective tournée vers le droit privé. Pour le professeur Auby par exemple, l’« échelle de la contractualité » dont il parle se présenterait comme un continuum « le long [duquel] se situer[aient] des opérations plus proches ou au contraire plus éloignées des modèles de droit privé » (« Le contrat administratif en droit français », in Journées de la Société de législation comparée 1979, p. 507). Ainsi la perspective est-elle orientée vers le contrat (de droit privé). C’est une chose implicitement entendue ou qui, plutôt, paraît nécessaire faute d’entendre une autre approche.
Soumettre le contrat administratif aux fonctionnalités prêtées au contrat
« La principale justification du contrat est fonctionnelle » (J. Morand-Deviller, art. préc.). Loin d’être neutre comme si elle résultait de la nature des choses, cette qualification renvoie aux principes sous-jacents au contrat (de droit privé) : la liberté contractuelle, la bonne foi, l’effet relatif des obligations et leur force obligatoire. « Quels sont ces principes fondamentaux du contrat administratif ? Ce sont d’abord ceux du contrat en général : autonomie de la volonté, liberté contractuelle, force juridique du contrat, conditions de formation, régime des nullités » (Y. Gaudemet, « La commande publique et le partenariat public-privé », in Revue du droit de l’immobilier 2003, p. 534). Les auteurs qui admettent pour les contrats privés et publics une généalogie commune, évoquent l’existence d’un fond commun à la culture juridique française pour mobiliser plus aisément l’acception privatiste du contrat lorsqu’ils appréhendent les contrats administratifs (cf. par ex. : J. Waline, « La théorie générale du contrat en droit civil et en droit administratif », in Le contrat au début du XXIe siècle : études offertes à Jacques Ghestin, Paris, LGDJ, 2001, p. 965). Il n’est pas dans notre intention de critiquer en soi cette approche. Nous souhaitons surtout souligner que cette représentation des choses, qui n’est pas neutre axiologiquement, renvoie à une certaine modélisation du contrat administratif. Discuter de la nature du contrat administratif indépendamment des conséquences opérationnelles qui en découlent, c’est voir la moitié des choses (ou le feindre). Du reste, personne n’en est vraiment dupe et nul de l’ignore. Aussi, l’enjeu consiste à discerner les fonctionnalités d’après lesquelles nous souhaiterions caractériser les contrats administratifs et, ce faisant, en quels termes.
Pour notre part, nous ne pensons pas qu’il y eût jamais eu un contrat qui aurait donné lieu, par la complexification des choses, à deux contrats différents – l’un privé et l’autre public. Jusque dans l’Entre-deux-guerres, le contrat est placé dans la mouvance du droit privé. En justifiant l’existence d’un contrat commun au droit privé et public, Gaston Jèze a eu le dessein d’acculturer le contrat au droit administratif, c’est-à-dire d’assimiler un concept privatiste tout en se déliant de l’acception étroite dans laquelle la doctrine privatiste l’enfermait. C’est une entreprise doctrinale qui fut en accord avec l’évolution du droit administratif de l’Entre-deux-guerres, marquée par une privatisation latente qui s’est opérée par le biais de la gestion privée.
« Aujourd’hui le service public n’est plus le ‘‘Sésame, ouvre-toi’’ de l’autonomie administrative : il faut que le service soit immédiatement en cause, qu’un contrat administratif soit en question, etc. » (L. Trotabas, art. préc., p. 212).
La gestion privée fut l’étendard d’une rationalisation des services publics, brandi dans le dessein de soulager les finances publiques. Le droit privé fut mobilisé comme « un moyen d’équilibre financier [des services publics], une recherche de profit ou d’économies » (ibid.).
« C’est une considération financière, une idée d’économies, qui détourne en effet du service public et explique toutes les conquêtes de l’idée de gestion privée dans le monde administratif. Derrière chacune des formules par lesquelles se manifeste cette conquête, ou par lesquelles elle essaie de s’affirmer, on retrouve toujours cette même idée : le service public est onéreux, la gestion privée est bénéficiaire » (ibid.).
Le contrat administratif n’est pas tant une citadelle conquise sur l’empire du droit privé, qu’un point de résistance situé à la marge du droit administratif et ceint de toute part par la théorie de la gestion privée. Celle-ci fut une avant-garde du droit privé sous des couleurs pernicieusement familière aux administrativistes.
Nous adhérons pleinement à la thèse du professeur Plessix suivant laquelle l’emprunt au droit privé est, à cet égard, de nature idéologique. L’histoire du contrat administratif a fait l’objet d’une réécriture qui oblitère son autonomie et apporte la démonstration d’une parenté originelle entre les contrats administratif et privé (L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2003, p. 713). A un autre point de vue, le professeur Ubaud-Bergeron estime pareillement que « la ‘‘privatisation’’ de l’action publique » renvoie à « une perception [qui] n’est pas infondée si l’on admet que la contractualisation revêt une part d’idéologie dans laquelle le recours au contrat est instrumentalisé en faveur d’une promotion libérale de l’Etat » (Droit des contrats administratifs, Paris, LexisNexis, 2015, p. 29).
En estimant que le contrat administratif n’est pas né contrat, l’histoire qu’en fait le professeur Gaudemet diffère de certains de ses contemporains tout en parvenant à la même conclusion : contrat administratif et contrat privé puisent aux mêmes fondements. Là où d’autres proposent de ré-embrasser un modèle qu’aurait écarté la théorie des contrats administratifs en consacrant leur autonomie vis-à-vis du droit privé, celui-là fait état d’une évolution doctrinale et prétorienne qui aurait cessé de concevoir le contrat administratif comme le reflet d’une procédure unilatérale pour l’analyser comme un contrat à part entière. Cet héritage se ferait encore sentir par la conception institutionnelle auquel il se prête. Mais qu’il s’agisse de renouer avec un ordre des choses un temps altéré ou qu’il s’agisse de consommer une mutation séculaire, ces hypothèses historiques sont toutes deux mobilisées à étayer une conception identique de ce qu’est le contrat administratif aujourd’hui, savoir un contrat pris sous les couleurs du droit administratif.
Notre propos n’est pas de dévaloriser les doctrines qui rapprochent tendanciellement les contrats administratifs des contrats privés. Bien au contraire, elles donnent l’occasion de souligner que la question qui porte sur la nature de ces contrats n’est pas de celle qui invite, pour y répondre, à observer le plus objectivement possible l’ordre des choses. Il ne s’agit pas de dire ce qui est, mais d’argumenter en faveur d’une certaine manière de les comprendre – étant admis que plusieurs sont envisageables et que chacune modélise différemment les contrats de l’administration. Les fonctionnalités que nous prêtons au contrat ne sont ou ne peuvent-elles pas être concurrencées par d’autres qui appelleraient à contourner l’hégémonie avec laquelle s’impose l’idéologie du contrat ?
Derrière la nature du contrat administratif : les mots pour en parler
Le droit de la commande publique, qui est l’un des principaux vecteurs de la publicisation des contrats, accentue encore la prégnance du contrat au sein du droit administratif. En déclarant administratifs tous les contrats de la commande publique passés par des personnes morales de droit public, les ordonnances « marchés publics » et « contrats de concession » renforcent cette idée que les contrats administratifs sont des contrats. En effet, cette qualification assimile – à l’instar de la loi dite Murcef du 11 décembre 2001 (art. 2) – des contrats qui, hier, étaient privés. Le motif tient à un souci d’économie juridictionnelle. Mais corrélativement, ce bloc de compétence « affaiblit considérablement la légitimité et la substance du droit administratif des contrats, dont on saisit de moins en moins bien les fondements » (M. Ubaud-Bergeron, « Le champ d’application organique des nouvelles dispositions » [dossier sur les contrats de la commande publique], in RFDA 2016, p. 218). Si le droit des contrats administratifs s’est constitué à partir du modèle de la concession de service public, il tend aujourd’hui à s’organiser à partir de celui du marché public dont les affinités avec les contrats privés et dont les lignes de partage sont mouvantes.
En présentant contrat administratif et contrat privé comme deux homologues, une telle parenté cautionne l’idée d’une contigüité entre l’un et l’autre. Leur dissemblance procède de motifs qui n’altèrent en rien leur commune origine. « Plus que l’expression d’une conception foncièrement originale du contrat administratif, ils sont le résultat inévitable et contingent de l’existence de deux juridictions autonomes l’une par rapport à l’autre » (F. Llorens, « Le droit des contrats administratifs est-il un droit essentiellement jurisprudentiel ? », in Mélanges offerts à Max Cluseau, Toulouse, Presses IEP, 1985, p. 396).
Toutefois, il est à craindre que, appréhendés à l’aide d’une grammaire identique, les contrats administratifs soient compris en des termes empruntés. Ce n’est pas surprenant si, en expliquant le désintérêt des publicistes pour la doctrine de l’autonomie de la volonté, le professeur Plessix conclut interrogatif : « Et si le contrat public n’était pas un vrai contrat ? » (« Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. Archéologie d’un silence », in Annuaire de l’Institut Michel Villey 2012, p. 206). Car l’enjeu n’est pas tant d’assigner à ces contrats un régime juridique spécifique, que de discuter des termes à employer pour en rendre compte.
La doctrine de l’autonomie de la volonté n’est guère présente dans les esprits qu’au titre des corollaires qu’on lui désigne : la liberté contractuelle notamment, désormais consacrée à l’article 1102 du code civil (cf. l’art. 2 de l’ordonnance précitée du 10 février 2016). Défendre la thèse suivant laquelle le contrat administratif est un contrat avant d’être administratif, c’est le placer en regard du droit privé afin de légitimer les emprunts qui pourraient y être faits. Le professeur Gaudemet a noté que cette approche n’a pas toujours été celle de la doctrine administrative, étant admis que le contrat administratif ne serait pas « né » contrat. Il signale la désuétude d’une conception qui, aujourd’hui, n’assigne toujours pas aux contrats administratifs les mêmes fondements que ceux des contrats privés, savoir la loi. Voir dans les marchés publics une matière qui trouverait ses fondements ailleurs, dans le pouvoir réglementaire, « c’est rester dans une optique dépassée – celle de l’Ancien Régime – qui réserverait à l’administration la détermination et la réglementation de ses moyens d’action, sans distinguer vraiment à cet égard entre le contrat et l’acte unilatéral » (« La commande publique et le partenariat public-privé », art. préc.).
L’idée d’un droit commun des contrats est essentiellement discutée par la doctrine publiciste. C’est une thématique dont les enjeux lui sont propres. La doctrine privatiste s’en désintéresse superbement et les recherches comparatives entre droit public et droit privé sont le seul fait des administrativistes. « S’il est classique, pour un publiciste, de s’interroger sur les emprunts du droit des contrats administratifs au droit privé des contrats, le travail en sens inverse n’a été que très rarement entrepris par les privatistes » (F. Chénédé, « Les emprunts du droit privé au droit public en matière contractuelle », in AJDA 2009, p. 923). La récente réforme du droit des contrats en donne une illustration supplémentaire. Outre le souci de la sécurité juridique tendant à rapprocher la lettre du code de l’esprit du droit, « le deuxième objectif poursuivi par l’ordonnance [fut] de renforcer l’attractivité du droit français, au plan politique, culturel, et économique » (Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016). L’écriture de cette ordonnance s’est plus inspirée des « codifications doctrinales européennes et internationales » que d’une comparaison en droit interne (H. Barbier, « Les grands mouvements du droit commun des contrats après l’ordonnance du 10 février 2016 », in RTD civ. 2016, p. 247).
Poser la question de savoir si le contrat administratif est un vrai contrat, c’est non pas – faute de mieux – lui reconnaître une nature unilatérale, mais se demander si certaines relations consensuelles des personnes publiques renvoient à des problématiques irréductibles au droit privé qui, le cas échéant, pourraient être comprises en des termes propres. C’est ainsi que, après d’autres, le professeur Fleury proposait d’écarter l’idée suivant laquelle les personnes publiques disposeraient d’une liberté contractuelle, pour préférer le concept de pouvoir discrétionnaire (« La liberté contractuelle des personnes publiques. Questions critiques à l’aune de quelques décisions récentes », in RFDA 2012, p. 231).
Peut-être serait-il plus facile d’œuvrer en ce sens si l’on ne considérait pas les contrats administratifs comme un ensemble monolithique.
Cesser de penser les contrats administratifs au singulier : une illustration par la doctrine publiciste de la Belle-Epoque
L’histoire de la théorie du contrat administratif est loin d’être celle d’un progrès scientifique qui aurait expérimenté, éprouvé puis certifié une méthode d’analyse propre à discerner la vraie nature des contrats administratifs. La première moitié du XXe siècle attire l’attention sur des doctrines diverses – parfois concurrentes – qui attestent de la richesse des approches qui peuvent être envisagées pour appréhender les contrats de l’administration. En outre, elle montre qu’ils n’ont jamais été conçus autrement qu’au travers des problématiques qui ont pu intéresser les administrativistes d’une époque (cf. notre thèse précitée, p. 497). La théorisation des contrats administratifs dans les années 1920 marque une rupture dont le contraste avec les doctrines précédentes aide à nous représenter l’horizon des possibles vers lequel projeter nos réflexions. Avant la Première Guerre mondiale, une part des administrativistes a tenu le contrat en suspicion. Parmi ceux-là se rangeait Gaston Jèze qui, en rééditant son traité en 1914, exprima mieux qu’aucun autre cette indisposition des publicistes.
« Il conviendrait maintenant, pour exprimer [les] idées nouvelles [de la science du droit public], de renoncer à la terminologie courante. (…) La terminologie usitée a été empruntée tout entière au droit privé. (…) Maintenant que l’on est de plus en plus convaincu qu’à des problèmes entièrement différents de ceux du droit civil correspondent et doivent correspondre des théories différentes de celles du droit privé, il conviendrait d’adopter une terminologie moins défectueuse. Il faudrait renoncer à [l’]expression de contrat administratif, (…) puisqu’il est bien entendu que le prétendu contrat administratif ou de droit public diffère essentiellement du contrat de droit privé. Cette terminologie vicieuse est pleine d’inconvénients. Les mots ont une puissance. Ils évoquent des idées. Dans l’esprit du juriste, le mot contrat (…) évoque, par lui seul, une série de conséquences ; or, il ne faut pas les appliquer à l’acte juridique improprement qualifié contrat administratif ou de droit public » (« De l’utilité pratique des études théoriques de jurisprudence pour l’élaboration et le développement de la science du droit public. Rôle du théoricien dans l’examen des arrêts des tribunaux », in RDP 1914, p. 318-321).
Pour comprendre cette méfiance de la doctrine publiciste de la Belle-Epoque, il faut avoir à l’esprit deux choses :
– l’expression « contrat administratif » est jusqu’alors cantonnée au contentieux administratif ; elle aide à déterminer le juge à la compétence duquel ressortissent les contrats de l’administration. C’est en ce sens que Léon Duguit la comprend : le contrat administratif n’est pas plus différent du contrat civil que ne l’est, au regard de celui-ci, le contrat commercial ; ils ne se différencient les uns des autres qu’à propos du juge compétent pour connaître de leur contentieux. Ce point de vue, qui n’est pas propre à cet auteur, est partagé par plusieurs de ses contemporains.
– l’expression « contrat administratif » ne renvoie pas à une catégorie de contrats à laquelle s’articulerait un régime juridique autonome du droit privé. En d’autres termes, il n’y a pas une réflexion sur les contrats administratifs, mais des réflexions spécifiques à certains contrats et autonomes les unes des autres. Les marchés administratifs (notamment de fournitures) ont été confinés à la marge du droit administratif tant leur profil les rapprochait du droit privé. Ils n’ont pas beaucoup focalisé l’attention des administrativistes. Les concessions (et les marchés que nous appellerions « de service ») ont suscité, au contraire, de nombreuses réflexions qui, souvent, se sont articulées à d’autres sur la domanialité, la police ou la responsabilité administratives. Ces conventions ont d’autant plus retenu l’attention que les doctrines portées à en souligner l’originalité s’accordaient à démontrer l’autonomie du droit public.
Ces deux remarques peuvent aider à comprendre pourquoi le contrat n’a pas beaucoup été mobilisé par les administrativistes de la Belle-Epoque. D’une part, ces derniers éludèrent – parmi les contrats l’administration – ceux qui présentaient de profondes similitudes avec les contrats du code civil. Ils en traitèrent dans les ouvrages didactiques sans, néanmoins, s’y attarder. D’autre part, ils s’attachèrent à appréhender les concessions – et les contrats s’y apparentant – en des termes qui fussent sans analogie avec le droit privé. Le jeune professeur nancéen, Louis Rolland, en donne une belle illustration :
« Le concessionnaire ne contracte pas vraiment avec l’Etat. (…) Il est l’auxiliaire de l’administration. C’est un particulier qui collabore à la gestion d’un véritable service public sur la demande de l’administration. (…) Extérieurement l’acte intervenu a pris alors les apparences d’un contrat. Il semble qu’il y ait eu échange de consentements. En réalité, ces apparences sont trompeuses ; les gouvernants ont créé simplement une situation juridique au profit du concessionnaire par voie unilatérale. Pour le reste, il y a eu entre l’Etat et le concessionnaire un échange de consentements de même ordre que celui qui intervient entre l’Etat et un fonctionnaire. (…) Cette situation de collaborateur à un service public apparaît aussi comme intermédiaire entre la situation de simple particulier et celle de fonctionnaire. (…) L’acte de concession n’est point un contrat, mais un acte organisant une collaboration à un service public » (« Du droit du législateur d’imposer de nouvelles obligations à un concessionnaire de travaux publics », in RDP 1909, p. 529).
Certains administrativistes de la Belle-Epoque furent d’autant moins disposés à analyser les concessions par le biais du contrat que celui-ci était alors monopolisé par la doctrine privatiste. En se l’appropriant comme emblème, celle-ci lui conféra une acception qui pût valoriser l’identité du droit privé comme un droit individualiste et libéral. A l’inverse, en s’évertuant à démontrer tout à la fois l’autonomie et la juridicité du droit public, la doctrine publiciste s’employa à se donner une grammaire caractéristique de sa propre identité. Le contrat de droit public que le Conseil d’Etat dégagea à propos des agents publics en donne une illustration (cf. la thèse précitée du professeur Plessix) : il fut motivé en ce sens par le souci de leur proscrire le droit de grève en établissant une analogie avec le droit privé (CE, 7 août 1090, Winkell). Ce faisant – et c’est là ce qui nous intéresse –, il prit soin d’approprier ce contrat au droit public afin de ne pas subvertir son autonomie.
Jusque dans les années 1920, le contrat resta la chose de la doctrine privatiste. Il lui permit de mettre en exergue les principes immarcescibles du droit privé, tout en dépréciant un droit public réduit à des réglementations spéciales, précaires, unilatérales et impératives.
Ces propos permettent de mesurer les efforts dont firent preuve certains administrativistes pour analyser les concessions suivant une terminologie propre au droit public. Les motifs qui les motivèrent en ce sens sont contingents d’une époque. Cela étant, ils aident à historiciser la conceptualisation des contrats administratifs et permettent de restituer la multiplicité des options doctrinales auxquelles, aujourd’hui, nous pouvons nous montrer ouverts.
L’histoire n’a pas pour objet de prescrire une doctrine en particulier. En revanche, elle peut aider à préciser la portée de certaines questions et à en souligner la pertinence.
La démarche des publicistes de la Belle-Epoque nous convainc que la question de la nature du contrat administratif est une question biaisée. Elle amène inexorablement à lui reconnaître une nature contractuelle. Les termes en lesquels elle s’énonce ferme l’interrogation et suppose déjà la réponse envisageable. « Contrat administratif » ou « contrat public » – ce sont des concepts dont la portée gêne nos réflexions. Ils postulent une unité performative qui engage notre manière de comprendre les contrats de l’administration dans une perspective déterminée. Cette question est faussement discutée, en ce sens qu’elle est présentée en des termes si larges qu’ils lient ensemble des contrats auxquels des réponses différentes pourraient être apportées. Nous ne souhaitons pas dévaloriser le prisme contractuel qu’elle justifie : c’est une option envisageable dont la pertinence est indiscutable. Seulement, celle-ci n’emporterait-elle pas l’adhésion qu’au prix d’une réflexion contrainte ?
Telle qu’elle se présente, la question de la nature des contrats administratifs ne permet pas d’esquisser des alternatives crédibles. Puisqu’on imagine mal que certains contrats administratifs – les marchés publics par exemple – puissent se voir reconnaître une nature qui ne serait pas contractuelle, les « contrats administratifs » pris ensemble seront des contrats. C’est d’ailleurs le paradoxe que soulevait le professeur Drago : celui d’une théorie élaborée à partir d’un contrat qui n’en est pas un (la concession de service public) et qui recouvre pour une grande part des contrats qui confinent avec le droit privé (les marchés publics) (« Paradoxes sur les contrats administratifs », in Etudes offertes à Jacques Flour, Paris, Répertoire notarial Defrénois, 1979, p. 151).
Certains de ces contrats pourraient être qualifiés autrement ; à tout le moins, ils pourraient soulever de sérieuses discussions à ce sujet. Cette entreprise doctrinale ne saurait être fructueuse qu’en explicitant en quoi il pourrait être pertinent d’analyser autrement certains contrats administratifs. Peut-être que, à cet égard, le contrôle de l’administration sur son contractant et les recours ouverts aux citoyens contre l’administration contractante pourraient être des problématiques prometteuses, en relation avec la thématique d’une démocratie administrative. C’est dans cette perspective, par exemple, que le professeur Weber s’est évertué à restituer la pluralité des protagonistes intéressés par les contrats administratifs (« Les acteurs des contrats de l’administration », in Mélanges en l’honneur du professeur Gustave Peiser. Droit public, Grenoble, PUG, 1995, p. 521).
III) Peut-on envisager les contrats administratifs autrement qu’à travers un droit des contrats administratifs ?
Une obligation de mise en concurrence étendue au-delà des contrats publics
L’ordonnance (précitée) du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques expose sous un aspect actuel la question d’un droit des contrats administratifs dont l’existence se justifierait par une cohérence propre (un projet de loi portant ratification de ladite ordonnance a été déposé au bureau de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2017) (cf. à ce propos : J.-G. Sorbara, « La modernisation du droit des propriétés publiques par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 », in RFDA 2017, p. 705). Au premier abord, elle accroît un peu plus la portée du principe de non-discrimination – dans son interprétation donnée par la jurisprudence Telaustria (CJCE, 7 décembre 2000, C-324/98). Ceux des titres qui, en autorisant une utilisation privative du domaine public, emportent des incidences économiques susceptibles de conférer à un acteur du marché un avantage concurrentiel, ne doivent être délivrés par les personnes publiques qu’après avoir satisfait aux mesures de publicité adéquates suivies d’une procédure garantissant l’impartialité et la transparence de la sélection des candidatures. Adoptée en réaction à l’arrêt Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, C‑458/14 et C‑67/15), cette ordonnance étend aux titres domaniaux une obligation de mise en concurrence alors que le Conseil d’État – au contentieux – s’était refusé à l’étendre à des hypothèses pour lesquelles elle ne s’imposait en vertu d’aucun texte (CE sect., 3 décembre 2010, Ville de Paris & Association Paris Jean-Bouin, n° 338272). Pourtant, le droit domanial n’y était, jusqu’alors, pas totalement étranger. L’ordonnance précitée en tient compte. Aussi a-t-elle ajouté au code général des propriétés des personnes publiques (CGPPP) un article L. 2122-1-2 qui écarte les obligations nouvellement instituées lorsqu’« une procédure présentant les mêmes caractéristiques » est prévue par la législation à titre spécial, alors même que, par leur objet, les titres domaniaux correspondants entreraient dans le champ desdites obligations. Sont ainsi visés :
– les titres domaniaux conférés par des contrats de la commande publique ou bien ceux qui s’inscrivent « dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection » (art. préc.).
– les titres domaniaux dont la délivrance est encadrée par des dispositions particulières, telles les concessions de plages (art. L. 2124-4 du CGPPP) ou les autorisations d’utilisation des fréquences hertziennes (art. L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques).
Si la commande publique n’est pas la seule hypothèse où les personnes publiques sont assujetties à une obligation de transparence, elle n’en est pas moins – dans le champ des activités économiques des personnes publiques – un référent.
Nous importe davantage le fait que cette obligation de transparence, en ne se limitant pas aux titres conventionnels, embrasse indistinctement tous les titres domaniaux – y compris ceux délivrés par voie unilatérale. Certes, il ne faudrait pas assimiler les obligations procédurales qui résultent du droit de la commande publique avec celles de la domanialité publique. Les premières sont sensiblement plus contraignantes pour les personnes publiques. Cela étant, « il faudra (…) admettre que le droit de la commande publique n’épuise pas toutes les hypothèses de dévolution transparentes et qu’un ‘‘droit de la mise en concurrence’’ aux confins plus larges est en train de s’échafauder » (Chr. Roux, « La dévolution transparente des titres d’occupation du domaine public », in Droit administratif 2017, n° 6, étude 10). Autrement dit, le contrat n’est plus le seul vecteur par lequel les personnes publiques règlent leur pouvoir discrétionnaire sur le respect de la libre concurrence. Si la commande publique présente toujours des spécificités qui préserveront à moyen terme la cohérence des contrats correspondants, il n’est plus certain qu’elle permette une recomposition de la théorie des contrats administratifs.
Les contrats de la commande publique constituent un ensemble qui est, tout à la fois, trop imposant pour jouer un rôle secondaire dans une théorie des contrats publics, et trop caractérisé pour constituer à lui seul un « droit de la mise en concurrence ». A ses côtés, ne sont plus seulement visés des actes unilatéraux pris isolément mais une catégorie largement définie suivant une logique analogue à la commande publique. D’autant que, par-delà la question de la délivrance des titres domaniaux unilatéraux et conventionnels, d’aucuns ont pu souligner la convergence de leurs régimes juridiques (C. Mamontoff, « Le rapprochement des régimes de l’autorisation et du contrat d’occupation du domaine public », in Contrats publics : mélanges en l’honneur du professeur Michel Guibal, op. cit., t. 1, p. 517).
Les critiques doctrinales apportées à la théorie des contrats administratifs comme les contre-propositions doctrinales ont rarement remis en cause la cohérence résultant du fait d’embrasser les contrats et uniquement les contrats de l’administration (pour un contre-exemple : C. Yannakopoulos : « L’apport de la protection de la libre concurrence à la théorie du contrat administratif », in RDP 2008, p. 421). L’« assiette » de la théorie des contrats administratifs a été discutée : les contrats publics ont esquissé une théorie à la base élargie. Néanmoins, nous avons indiqué plus haut que les auteurs ne sont jamais départis de son architecture théorique consistant à identifier un contrat générique auquel correspondrait un régime juridique, éventuellement compliqué par des déclinaisons spéciales : le contrat, toujours le contrat, rien que le contrat.
Dépasser la théorie des contrats administratifs en re-naturalisant le contrat au droit administratif
Cette disposition doctrinale tendant à considérer en propre les contrats de l’administration – ou une part d’entre eux – a coïncidé avec la mise en forme d’un droit spécial, autonome des matières administratives contigües auxquelles, pourtant, les contrats sont liés par le biais de normes transversales. La littérature administrative suffirait à l’illustrer, depuis les ouvrages didactiques jusqu’aux revues spécialisées, en passant par les thèses (soutenues et en préparation). Le Traité du droit administratif paru en 2011 incline en ce sens. Quelques contre-exemples peuvent être mentionnés sans néanmoins démentir cette appréciation : les ouvrages consacrés au droit des services publics, au droit public des affaires et, d’une manière plus classique, ceux relatifs au droit administratif des biens (en ce qu’ils traitent des marchés de travaux publics). A côté de cela, trois nouveaux ouvrages sont parus ces dernières années sur le droit des contrats administratifs (ceux des professeurs Yolka, Ubaud-Bergeron et Hœpffner) – en plus de ceux qui ont été réédités (ceux des professeurs Richer, Guettier et Lichère).
La parenté entre les contrats publics et privés invite, par symétrie avec la doctrine privatiste, à considérer les premiers au sein d’un droit constitué et fini : un droit des contrats administratifs. Les propositions doctrinales tendant à esquisser un droit administratif des obligations n’ont jamais reçu que des concrétisations éphémères : comme par exemple dans le manuel de Marcel Waline (de la première à la sixième édition incluse, c’est-à-dire de 1936 à 1951), avant que celui-ci n’y renonce à partir de la septième édition (1957) pour mieux cadrer avec la nouvelle programmation des examens de licence. Si le professeur Gaudemet a récemment appelé de ses vœux à la formalisation d’une telle théorie (« Prolégomènes pour une théorie des obligations en droit administratif français », art. préc.), la thèse du professeur Noguellou est l’un des rares essais à avoir été entrepris en ce sens (La transmission des obligations en droit administratif, Paris, LGDJ, 2004).
Cette généalogie commune qui rapproche tous les contrats au prétexte d’un genre originel, hypothèque toute autre manière de voir qui, pour appréhender les contrats de l’administration, privilégierait une approche différente, non-soucieuse de les comprendre ensemble. L’affirmation de cette contigüité, par-delà la summa divisio droit privé-droit public, isole les contrats du droit administratif. S’ils en sont toujours une pièce centrale, ils sont pensés au travers d’un droit qui trouve sa cohérence en lui-même et qui se renforce de ses affiliations avec le droit privé des contrats. L’homogénéité des contrats administratifs (ou publics) est un corolaire de leur parenté avec le contrat privé.
Si, en l’état, il ne peut qu’être question de réflexions prospectives, l’ordonnance précitée de 2017 invitera peut-être à envisager ces contrats autrement. C’est-à-dire sous une perspective qui, au lieu de les appréhender ensemble, associerait certains d’entre eux avec certains actes administratifs unilatéraux. Suivant cette hypothèse, non seulement les contrats ne renverraient plus à une matière homogène, mais encore ils donneraient lieu à des catégorisations qui, chacune, seraient liées à des matières du droit administratif suivant la nature des problématiques les intéressant. Ils seraient en quelque sorte re-naturalisés au droit administratif.
Au demeurant, c’est ce qui se pratique dans les ouvrages didactiques consacrés au droit administratif des biens. Pour ne citer qu’un exemple : le traité du professeur Gaudemet (qui prolonge celui d’André de Laubadère) s’y prend de la sorte en envisageant spécifiquement les contrats de travaux publics – et singulièrement les marchés de travaux publics. Cette approche est classique et prolonge une tradition académique qui associe au droit domanial, les modes de cession forcée de biens (réquisition et expropriation) et l’exécution des travaux publics. La pérennité de cette partition doctrinale atteste de son succès : elle autorise une intelligence de la matière qui n’est pas bornée par des cadres (trop) schématiques. En outre, elle favorise des réflexions transversales autour d’un objet dont la cohérence permet de rendre compte de la spécificité des problématiques qu’il soulève.
Une pareille hypothèse est également envisageable à propos d’un droit public du travail qui embrasserait l’ensemble des agents publics – titulaires et non-titulaires (cf. en ce sens les actes d’un colloque organisé en 2014 et publiés aux éditions l’Epitoge : Le droit public du travail). Les contrats de recrutement d’agents publics ont sûrement plus d’affinité avec le droit des fonctions publiques qu’avec le droit des contrats administratifs où ils sont usuellement abordés. Cette dernière association n’explicite qu’assez mal les singularités de ces contrats, pris entre les fonctions publiques statutaires et le droit privé du travail ; entre leur « fonctionnarisation » et leur « travaillisation ».
Ces exemples ne sont peut-être pas, à eux seuls, de nature à convaincre de la pertinence qu’il y aurait à adopter une méthodologie différente qui renoncerait à comprendre les contrats de l’administration suivant une logique unitaire. C’est néanmoins en ce sens que le professeur Weber critiquait (en 1984) la définition donnée à la concession de service public : la conception contractuelle dans laquelle elle est tenue et son assimilation à la théorie des contrats administratifs gênent, à certains égards, la compréhension des difficultés qu’elle suscite.
« Ce sont les éléments tenant à la gestion du service public ou du travail public, en interférence parfois avec celle de la domanialité, et ceux relatifs aux relations avec les usagers et les tiers qui font problème. Ils s’intègrent mal avec le système de relations que suppose un contrat » (« La nature juridique des concessions administratives d’activités industrielles et commerciales (contribution à une théorie des contrats institutionnels) », art. préc., p. 50).
Peut-être les exemples plus haut évoqués sont-ils isolés, si bien qu’ils se prêteraient mal à une généralisation. Ils invitent néanmoins à en poursuivre la discussion et l’actualité confère à cette hypothèse une valeur inédite.
Des contrats administratifs spéciaux au XIXe siècle ?… ou seulement une autre manière d’appréhender les contrats de l’administration
Ce n’est que depuis les années 1950 que la doctrine administrative appréhende les contrats de l’administration à travers un prisme uniformisant. Gaston Jèze puis Achille Mestre ou Marcel Waline ont été, en ce sens, des initiateurs isolés au cours de l’Entre-deux-guerres. Le droit administratif a évolué trop profondément pour que l’on puisse faire de l’histoire un référent à reproduire. Toutefois, elle invite à considérer que ces contrats ont été saisis – depuis le XIXe siècle – à l’aide d’une intelligence différente de la nôtre, laquelle n’a pas empêché les administrativistes de développer à leurs propos des doctrines remarquables.
Certains auteurs estiment que « le droit du contrat administratif a d’abord été un droit des contrats administratifs spéciaux » (F. Brenet, « Les contrats administratifs », art. préc., p. 264). Suivant la formule incisive que ce dernier attribue au professeur Gaudemet : « L’espèce a précédé le genre » (ibid.).
« On avait le sentiment que tout l’effort de la jurisprudence et de la doctrine, depuis le XIXe siècle, avait tendu – avec succès – à dégager de ces pratiques juxtaposées une catégorie générique du contrat administratif, appartenant elle-même à la grande famille du contrat » (Y. Gaudemet, « Le contrat administratif, un contrat hors-la-loi », in Cahiers du Conseil constitutionnel 2005, n° 17).
Nous ne partageons cette appréciation qu’avec une réserve tenant aux termes employés et à ce qu’ils sous-tendent : ces derniers renvoient à la théorie des contrats administratifs alors que, précisément, ils rendent compte d’une période où celle-ci ne déterminait pas encore la manière de comprendre les contrats de l’administration.
Certes, quelques auteurs dans les décennies précédant la Grande Guerre ont publié des ouvrages consacrés à tel ou tel contrat (exception faite des thèses de doctorat) : les marchés de fournitures (A. Périer, 1876), les marchés de travaux publics (A. Gautier & E. Jouve, 1881), les contrats de l’Etat (E. Perriquet, 1884). Ce sont des ouvrages écrits par des praticiens (excepté Alfred Gautier, professeur à la faculté d’Aix) pour les praticiens. S’ils portent effectivement sur des catégories particulières de contrats, nous ne dirions pas qu’ils préfiguraient un droit des contrats administratifs spéciaux. Une telle expression n’a de sens que si l’on admet – ne fût-ce que virtuellement – un droit général des contrats administratifs. On ne regarde pas certains contrats comme spéciaux sans postuler un contrat générique à l’aune duquel les premiers peuvent être mis en ordre. L’expression « contrats administratifs » était usuellement employée par ces auteurs et leurs contemporains. Cependant, elle n’avait pas le sens que nous lui conférons aujourd’hui : elle était purement contentieuse et n’impliquait pas l’idée que ces contrats pussent être d’une nature différente des contrats du code civil ou qu’ils dussent constituer au sein du droit administratif une matière avec sa cohérence propre. Cette locution est restée circonscrite à une question d’économie juridictionnelle. Les auteurs précités n’ont pas eu le dessein de contribuer à la formalisation d’une théorie en devenir. Ce serait là une interprétation qui dénaturerait leurs doctrines et qui, de surcroît, négligerait la singularité de la théorie de Gaston Jèze. Nous ne pourrions pas dire non plus que ce dernier s’en serait inspiré. Les héritiers des auteurs précédents sont toujours des praticiens : G. Monsarrat (Contrats et concessions des communes…, 1920 & Marchés de travaux et de fournitures des communes…, 1926), L. Tétreau (Des marchés de fournitures, 1921) ou J. Le Clère (Les marchés de fournitures et de travaux publics, 1949).
Le seul auteur qui accrédite l’idée suivant laquelle l’étude des contrats administratifs spéciaux a précédé la théorisation du contrat administratif en y contribuant, est un contemporain de Gaston Jèze : le professeur lillois André Morel – auteur d’un ouvrage oublié quoique très édifiant (Les marchés de fournitures des départements de la guerre et de la marine pendant les hostilités, 1918 ; cf. notre thèse précitée, p. 734).
Nous ne ferions pas cette remarque si elle n’aidait à saisir comment les contrats de l’administration ont été appréhendés au cours du XIXe siècle. Les administrativistes d’alors n’ont jamais compris ces contrats à partir d’une théorie générale. Cela a déjà été constaté. C’est pourquoi, l’attention qu’ils leur ont prêtée a donné lieu à des doctrines plurielles qui ne correspondent pas à l’idée que nous pouvons intuitivement nous faire des contrats administratifs (cf. notre thèse précitée, p. 331).
Les contrats de l’administration n’ont jamais été saisis que de manière incidente, à travers les matières auxquelles ils ont été associés. Cela ne signifie pas que les administrativistes leur aient consacré des développements d’une qualité médiocre. Seulement, ils n’ont pas été préoccupés par le fait de les mettre en forme à travers une théorie générale. Ils les ont envisagés ponctuellement selon les problématiques auxquelles ils ont pu être impliqués. Ainsi les ouvrages savants universitaires ont-ils, respectivement, considéré :
– les marchés de fournitures de l’Etat, à propos des compétences des ministres,
– les marchés de travaux publics, à propos des travaux publics,
– les marchés administratifs, à propos de la répartition des compétences juridictionnelles entre les différentes juges intéressés (juge judiciaire, Conseil d’Etat et conseils de préfecture).
Le co-fondateur du Jda, Anselme-Polycarpe Batbie, est un cas qui n’est singulier qu’en apparence. Pour ordonner le droit administratif, il a revendiqué hautement son emprunt au droit civil afin de convaincre de la véritable juridicité de celui-là. Du reste, il réalisa cette assimilation avec beaucoup de liberté et certains contemporains ne manquèrent pas de noter qu’elle fut plus programmatique que réelle. Batbie a appréhendé les contrats ensemble, à travers un chapitre consacré aux obligations et où, derrière les faux-semblants d’originalité, il est plus classiquement question des travaux publics.
Pour les ouvrages praticiens de vulgarisation dont le plan était organisé en matières (mieux adapté aux usages de leur lectorat praticien, à l’instar de nos répertoires Dalloz et LexisNexis), les contrats étaient envisagés à l’occasion de chapitres thématiques : les bacs de passage, les baux administratifs, les chemins de fer, les communes, les fournitures ou encore la voirie.
Il ne faut pas déprécier cette approche que nous pourrions voir, de notre point de vue contemporain, comme étant fragmentée. Elle traduit un dessein qui a sa pertinence, quand bien même il ne tend pas à abstraire un régime général auquel puiseraient tous les contrats de l’administration (ou une partie d’entre eux). Ce dessein est plutôt celui de les analyser avec une rigueur qui rende compte des spécificités que pouvait leur imprimer la matière à laquelle ils s’appliquaient chacun. Par ne viser qu’un exemple, Gabriel Dufour (avocat aux Conseils) analyse les concessions de chemin de fer avec une perspicacité qui l’amène, sans dogmatisme, à faire comprendre comment se caractérisent ces contrats, compte tenu des contraintes inhérentes aux services de voirie auxquels ils participent. Il n’éprouve aucune difficulté à rendre compte, suivant des termes propres à son approche, des relations spéciales que nous traduisons – aujourd’hui – avec la concession de service public et qui évoquent notre principe de modification unilatérale des contrats administratifs.
« Il est de la nature de l’intérêt auquel répondent les divers services publics, et qui se résume dans ce qu’on appelle l’ordre public, de ne pouvoir jamais être compromis. Ce privilège (…) est le fondement des pouvoirs du gouvernement en matière de police, et fait qu’une mesure de police ne saurait être entravée ni par la possession ou les titres privés, ni par des actes émanés de l’autorité administrative elle-même. (…) Toute disposition, toute convention dans laquelle se trouverait engagé un intérêt d’ordre public ne constituerait qu’un empiètement, une usurpation sur un droit inaltérable ; et du moment où elle reconnaîtrait que cet intérêt est en danger ou en souffrance, le droit et le devoir de l’administration seraient de briser tous les liens et d’écarter tous les obstacles. Cette doctrine n’a, d’ailleurs, rien d’inconciliable avec le respect dû aux conventions librement faites, en ce sens au moins qu’elle n’implique pas l’anéantissement du droit qui peut naître d’un contrat ; et a seulement cette conséquence de le transformer en un droit à une indemnité » (Traité général de droit administratif appliqué, Paris, Cotillon, 1854 (2e éd.), t. 3, p. 193-194).
La cohérence de ces développements n’est pas de la même nature que celle que nous déployons dans nos ouvrages contemporains : elle ne puise pas systématiquement à des principes qui traversent le droit administratif de part en part en s’efforçant de corroborer l’unité de ses sources.
Notre propos n’est pas de faire l’éloge de cet auteur en particulier, mais de souligner le caractère opérationnel d’une méthode différente de la nôtre. En « féodalisant » le droit administratif, Gabriel Dufour se place dans un cadre restreint où s’y conjuguent un raisonnement casuistique et une latitude d’esprit qui n’est pas gênée par des principes induits par des généralisations aux traits géométriques.
Le principal mérite que présente, d’un point de vue historique, la doctrine de cet auteur – et de ses contemporains –, est celui de faire apparaître, en creux, les contraintes méthodologiques dans lesquelles la théorie des contrats administratifs nous cantonne actuellement. Il n’est pas tant question d’imiter ces doctrines du XIXe siècle que de désapprendre la manière dont nous pensons aujourd’hui ces contrats, afin de conjurer les défauts que nous imputons à la théorie des contrats administratifs. Les partisans d’une théorie des contrats administratifs spéciaux s’y sont montrés sensibles en s’efforçant d’attirer l’attention sur le droit « vivant » des contrats administratifs. Toutefois, les critiques adressées à la théorie générale des contrats administratifs porteraient davantage si elles se situaient en dehors de son orbite. En d’autres termes, sa recomposition ne saurait faire l’économie de perspectives doctrinales qui se poseraient en alternatives à celle dont procède ladite théorie.
Il n’est pas question de choisir, mais de confronter pour composer.
Soustraire les contrats administratifs de la prééminence de leur identité contractuelle : un éclairage du XIXe siècle
Pour terminer notre propos, nous souhaiterions discuter une analyse du professeur Gaudemet que nous avons rapidement abordée plus haut :
« Le contrat administratif n’est pas né contrat mais comme une sorte de dérivé, de bifurcation de l’acte unilatéral, une procédure menée par l’administration et qui appelle, le moment venu, l’adhésion d’un entrepreneur, d’un fournisseur, d’un prestataire, lui-même conçu alors comme une sorte de collaborateur adhérant au marché de l’administration » (Y. Gaudemet, « Pour une nouvelle théorie générale du droit des contrats administratifs : mesurer les difficultés d’une entreprise nécessaire », in RDP 2010, p. 315).
Nous acquiesçons à cette idée d’après laquelle certaines relations contractuelles de l’administration ont été imprégnées d’autoritarisme – depuis leur conclusion jusqu’à leur liquidation (cf. dans le même sens : M. Touzeil-Divina, Le doyen Foucart (1799-1860), un père du droit administratif moderne, th. dactyl., 2007). Cela fut le cas, notamment, pour les marchés de fournitures de l’Etat et les marchés de travaux publics. Sans cesser de les analyser comme des contrats, les administrativistes du XIXe siècle furent tout à fait conscients de cet aspect des choses. Comme l’illustre par exemple Armand Béhic – ministre des travaux publics sous le Second Empire :
« Il est juste de reconnaître que les clauses de 1833, comme celles de 1811, portent visiblement l’empreinte de cette pensée, qu’à raison de la nature et du but des travaux dont ils se rendent adjudicataires, les entrepreneurs ne sont en quelque sorte que des agents d’un certain ordre de l’administration, obligés d’accepter ses décisions, lors même qu’elles blessent leurs intérêts et semblent en désaccord avec le véritable sens des clauses du contrat » (Circulaire du 21 novembre 1866, prise en interprétation du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées du 16 novembre 1866, in Recueil de lois, ordonnances, décrets, règlements & circulaires concernant les services dépendant du ministère des travaux publics, Paris, Imprimerie administrative Vve Jousset, 1903, t. IX (1re série), p. 495-496 ; c’est nous qui soulignons).
Cependant, l’opposition entre l’acte unilatéral et le contrat ; l’idée d’un acte d’adhésion du contractant à une procédure peut entraîner des équivoques. Ces terminologies ont été familiarisées par la doctrine juridique de la Belle-Epoque. Elles impliquent une tournure d’esprit ; leur signification renvoie à des représentations doctrinales qui ne sont pas celles des administrativistes du XIXe siècle. D’où la difficulté pour rendre compte des contrats de l’administration tels qu’ils ont pu être conçus avant la fin de ce siècle.
Tous les ouvrages qui en traitent attestent que ces contrats ont été analysés comme des contrats. Louis-Antoine Macarel se réfère à Pothier pour préciser la nature des marchés de fournitures (Questions de droit administratif, 1818). Certains auteurs ont pu discuter de la nature particulière de certains contrats au regard de catégories empruntées au code civil (comme l’avocat Ch. Delalleau avec les concessions).
C’est précisément ce qui fait l’originalité de la doctrine de ces auteurs : les contrats de l’administration ont été admis comme des contrats à part entière et, pourtant, ils ont été appréhendés à travers des problématiques spécifiques au droit administratif. C’est que les contrats administratifs ne se sont pas présentés à leur observation comme une donnée objectivement préexistante qu’il eût suffi de reconnaître. Ils résultent d’une certaine compréhension des choses. Si bien que, de nos jours, il importe davantage de comprendre pour quels motifs les administrativistes en ont traité que de savoir ce qu’ils en ont dits sur le fond. Les doctrines à leur sujet ont été élaborées incidemment, par des auteurs qui souhaitaient prendre exemple de certains contrats pour étayer telle thèse ou contredire telle autre. C’est en les mobilisant de la sorte qu’ils ont été amenés à porter sur tel ou tel contrat des appréciations toutes indiquées par le sens de démonstration à asseoir. Pareillement aujourd’hui, la manière dont nous saisissons les contrats de l’administration s’explique largement par les enjeux contemporains à notre droit administratif : savoir la soumission des personnes publiques au droit de la concurrence. Nous les caractérisons sous un aspect qui, pour être en accord avec une problématique actuelle, n’exclut pas d’autres approches qui valoriseraient autrement ces contrats.
Ainsi, par exemple, les marchés de fournitures de l’Etat ont été intéressés aux controverses touchant le Conseil d’Etat au cours des années 1820 (cf. notre thèse précitée, p. 81). C’est à cette occasion qu’ils ont été appréhendés par quelques-uns sous un aspect singulier. Sous la plume des défenseurs de cette institution, ils furent délibérément analysés comme un vecteur de l’action administrative, c’est-à-dire comme des contrats s’exécutant suivant des modalités propres à l’administration et réclamant, pour leur contentieux, un juge spécial qui soumette l’administration à une tutelle éclairée susceptible d’en redresser les dysfonctionnements. Ces auteurs ont pris prétexte de ces contrats pour convaincre de ce que le contrôle de l’administration ne devait pas résulter d’une stricte observance d’un droit sanctionné par le juge judiciaire ; mais plutôt d’une institution endogène à l’administration qui pût, en tenant compte des contraintes auxquelles l’administration faisait face, discipliner ses agents. D’ailleurs, leurs contradicteurs n’ont pas été en reste et ont prêté ces marchés à une appréciation différente qui permettait de démontrer en quoi le Conseil d’État était impropre à exercer une compétence juridictionnelle. Pour le duc de Broglie, les marchés de fournitures de l’Etat ne sont rien de plus que des contrats. Ce n’est pas qu’il eût été inattentif à certains de leurs caractères. C’est plutôt qu’il ne voulait pas qu’ils fussent autre chose que des contrats, étant précisé qu’il désignait aux contrats une conception univoque à laquelle correspondait la compétence judiciaire. De son point de vue, le salut de l’administration résultait de sa confrontation permanente avec la société, sur le terrain du droit (privé), de sorte que celle-là fût incitée à veiller à ses intérêts au lieu de reposer sa vigilance sur la confiance que pouvaient lui inspirer ses prérogatives et le bénéfice d’une juridiction spéciale.
Voici une illustration topique d’un auteur (avocat aux Conseils) qui, parmi les défenseurs du Conseil d’État, justifie l’existence d’un contentieux administratif en prenant exemple des marchés de fournitures de l’Etat :
« On voit un contrat passé par le gouvernement avec un entrepreneur, et l’on conclut aussitôt que les difficultés relatives à l’exécution de ce contrat ne peuvent offrir rien d’administratif ; mais on ne fait pas assez attention que ce contrat n’est qu’un mode employé pour subvenir à la gestion d’une branche du service public, et que son exécution, qui est la matière litigieuse, consiste dans des (…) actes dominés par les règles établies dans l’intérêt du service public, qu’il y soit pourvu par des agents révocables, ou par des agents irrévocables comme le sont les entrepreneurs » (H.-A. Quénault, De la juridiction administrative, Paris, Delaunay, 1830, p. 46 ; c’est nous qui soulignons).
En un sens, ces propos corroborent certainement l’opinion précitée du professeur Gaudemet. Cela étant, Quénault ne propose pas tant une définition juridique du contrat qu’il exprime une tournure d’esprit. Il avance moins une doctrine arrêtée qu’il ne témoigne du sens en lequel il comprit les marchés de fournitures, compte tenu du propos spécifique qui suscita ses réflexions et qui en détermina la tonalité.
Les contrats administratifs ne sont pas nés sous une forme ou sous une autre qui leur préexisterait. Ils procèdent de la plume des administrativistes qui, pour des motifs divers, s’en sont préoccupés en leur conférant une signification qui fût en accord avec la thèse défendue ou avec la représentation du droit administratif qu’ils essayaient d’incarner. Les contrats de l’administration n’ont pas (ou rarement) été l’objet principal de leur attention. C’est souvent de manière incidente qu’ils ont été mis en discours.
C’est le cas, par exemple, du parisien Gérando et du poitevin Foucart qui ont appréhendé les contrats de l’administration dans le souci d’organiser le droit administratif à travers le prisme d’une « rationalité gestionnaire » (pour reprendre une expression du professeur Guglielmi). Avec d’autres, comme Macarel et Boulatignier, ces auteurs ont souhaité saisir la gestion administrative par le droit. Aussi ont-ils infléchi leur représentation du droit administratif au regard des mutations induites par la genèse du parlementarisme en France (cf. notre thèse précitée, p. 229).
C’est encore le cas de la plupart des administrativistes universitaires des années 1830 qui se sont efforcés de préciser la distinction entre l’Etat-administrateur et l’Etat-propriétaire. Parmi ceux-là se range le second co-fondateur du Jda, Adolphe Chauveau. Celui-ci classait les marchés de fournitures de l’Etat parmi les actes administratifs en les analysants comme une manifestation de l’action administrative dont le contentieux participait de la responsabilité ministérielle. C’est pourquoi leur singularité a essentiellement été formalisée à propos de questions touchant la juridiction et le contentieux administratifs.
Sans poursuivre davantage ces exemples, nous souhaitons souligner deux choses.
D’une part, les « contrats administratifs » n’ont pas d’acte de naissance. La pesanteur de cette locution qui devient usuelle dès les années 1830 ne doit pas nous dissimuler la multiplicité des acceptions successives – parfois concurrentes – que les administrativistes lui ont conférées suivant les époques. Elle ne renvoie pas à la même chose si l’on considère respectivement le premier et le second XIXe siècle. Une histoire des contrats administratifs est une histoire d’une mise en discours des contrats de l’administration par les doctrines administratives. A cet égard, il faut se garder des schémas historiques qui feraient apparaître des linéarités (histoire diachronique) et qui négligeraient de comprendre les doctrines au regard des problématiques auxquelles elles réagirent (histoire synchronique). En soulignant la contingence des doctrines, l’histoire nous permet de nous confronter à celles qui nous sont contemporaines ; elle nous aide à nous procurer le recul nécessaire pour nous soustraire de l’évidence avec laquelle se présente la théorie des contrats administratifs. Il ne s’agit pas de la subvertir nécessairement, mais d’interroger les présupposés sur lesquels elle repose. Encore faut-il, au préalable, les expliciter.
D’autre part, la doctrine administrative du XIXe siècle nous montre qu’il est possible d’envisager les contrats administratifs autrement qu’à travers un prisme contractuel qui oriente l’ordre de nos réflexions. Ce n’est pas que cette nature contractuelle eût été indifférente aux auteurs de ce siècle. Loin de là. Toutefois, certains d’entre eux ont pu concevoir des doctrines qui, en n’attachant pas une importance prééminente à cette question, ont prêté les contrats administratifs à d’autres enjeux que celui consistant à leur assigner un régime juridique donné. Sans nous contraindre à les imiter, leur exemple nous renvoie à la prégnance intellectuelle avec laquelle la question de la détermination du régime applicable se pose à nous et le peu de latitude que nous laisse la théorie des contrats administratifs pour penser ces contrats différemment.
Ce n’est pas que cette théorie nous contraint à ne pouvoir envisager les contrats de l’administration en dehors de son giron. Les réflexions développées dans le rapport du Conseil d’État de 2008 (Le contrat, mode d’action publique et de production de normes) en donnent un exemple ; la doctrine universitaire ne démérite pas non plus. Toutefois, ces réflexions transversales n’ont, jusqu’alors, qu’assez peu influé sur la modélisation du droit des contrats administratifs.
Peut-être que, à cet égard, l’ordonnance (précitée) relative la délivrance des titres domaniaux sera l’occasion de déconstruire (ne fût-ce que partiellement) cette dichotomie entre les actes unilatéraux et les contrats ; et de décloisonner les contrats administratifs. Cette entreprise doctrinale pourrait nous permettre de ne plus les réduire à une identité contractuelle dont les effets sur notre manière de les comprendre pourrait paraître trop (op)pressante.
Nota bene : nous tenons à remercier très amicalement David M. pour la peine qu’il s’est donné en relisant notre article. Nous lui exprimons toute notre gratitude.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 05 : « La réforme de la commande publique, un an après : un bilan positif ? » (dir. Hœpffner, Sourzat & Friedrich) ; Art. 212.