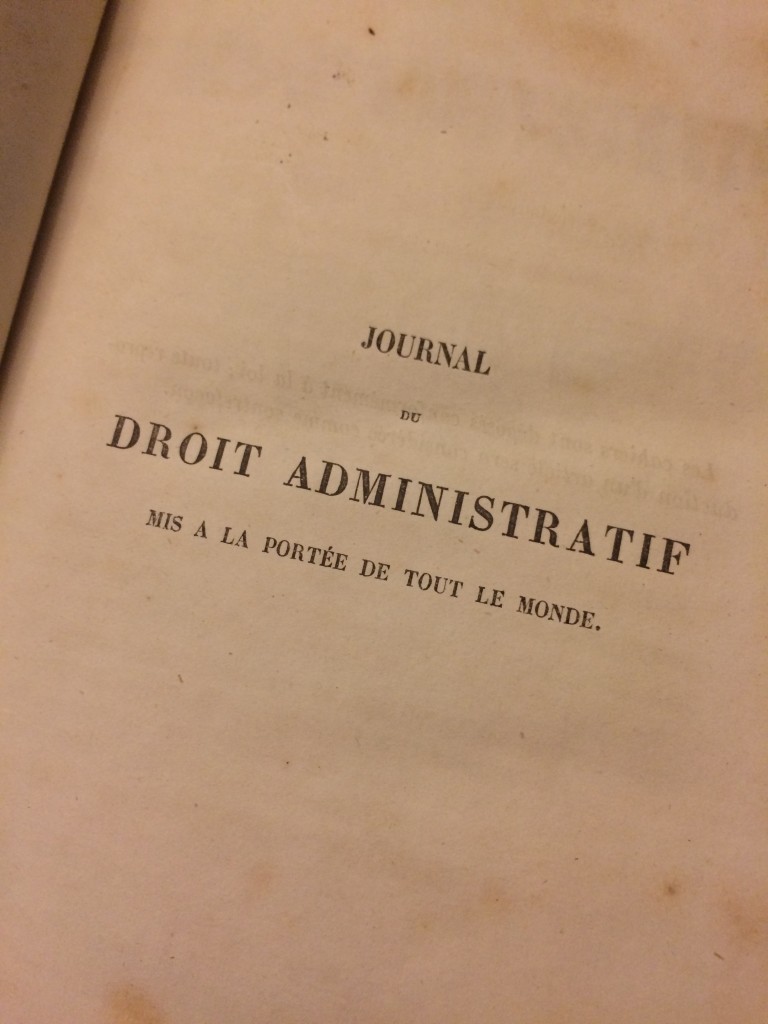Art. 367.
Cet article fait partie intégrante du dossier n°08 du JDA :
L’animal & le droit administratif
… mis à la portée de tout le monde
par Amelia Crozes
ATER en droit public,
Université Toulouse 1 Capitole
L’image est connue : une affiche aux couleurs criardes placardée sur le mur d’une commune représentant un chapiteau, un visage au maquillage bigarré, des acrobates, des chevaux cabrés et des fauves rugissants. L’identité du cirque traditionnel, bien qu’elle ne puisse s’y résumer, s’est en partie construite avec et par l’animal.
Il faut dire que le cirque est une institution ancienne. L’origine latine du terme, circus, semble même le relier étymologiquement aux jeux du cirque antiques. Découlant de circulus (le cercle), lui-même dérivé du latin circus, le cirque désignait en effet initialement l’enceinte circulaire où l’on célébrait les jeux publics chez les Romains[1]. Ainsi, si en pratique et comme l’a souligné Ninon Maillard, il serait probablement artificiel de tisser une généalogie entre jeux du cirque romain et cirque contemporain, ceux-ci se retrouvent toutefois au moins sur deux points : la réunion de spectateurs autour d’une arène ou d’une piste, et la possible mise en scène d’animaux domestiques et sauvages[2]. La version moderne du cirque telle qu’elle s’est faite connaitre jusqu’à nos jours serait cependant née aux alentours du 18e siècle avec Philip Astley et a immédiatement intégré l’idée de numéros avec l’animal, notamment le cheval[3]. Ce ne sera qu’au début du 19e siècle que les animaux sauvages seront véritablement intégrés au sein de ces spectacles, le cirque apparaissant alors « comme le lieu où l’impossible devient réalisable, autant par la maîtrise des corps que par le contrôle des bêtes »[4].
D’un point de vue tant historique que contemporain, il semble donc possible d’affirmer que l’intérêt du cirque pour l’utilisation de l’animal est loin d’être anecdotique. Cette idée se retrouve également d’un point de vue juridique, où l’animal est présent au cœur d’une pluralité de réglementations encadrant la pratique circassienne, visant à qualifier certaines activités de l’institution et, principalement, permettant de définir les conditions d’acquisition, de détention et d’utilisation des animaux lors de ses représentations. Cependant, malgré son importance, la présence animale au sein des cirques n’est en rien un élément de qualification juridique de ce dernier (et donc une condition sine qua non à son existence ou à sa reconnaissance en tant que tel). En effet, avant tout, le cirque fait partie de ce que l’on nomme plus largement les « spectacles vivants », c’est-à-dire ceux diffusés par des personnes s’assurant de la présence physique d’au moins un artiste du spectacle rémunéré[5] et répond en ce sens à la réglementation afférente. De manière plus spécifique, le cirque est actuellement défini par l’Annexe V de la Convention collective nationale de février 2012[6] comme « un spectacle vivant constitué par une succession de numéros ou de prouesses faisant appel à [une] ou plusieurs [disciplines] » telles que l’acrobatie, l’art clownesque ou burlesque, mais aussi le travail et la présentation avec les animaux. De la même manière, s’il est le plus traditionnellement perçu comme itinérant (et l’est effectivement majoritairement)[7], il est à noter que ces spectacles peuvent en réalité également se dérouler au sein de structures fixes[8]. Sont alors qualifiés d’itinérants, les « spectacles réalisés dans des lieux différents ou requérants le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés »[9].
Toutefois, bien que l’animal semble constituer l’une des figures emblématiques du cirque, celle-ci s’avère largement contestée. En effet, aujourd’hui, l’animal et plus particulièrement l’animal sauvage, tend à quitter la piste. Il faut dire qu’avec la montée des préoccupations environnementalistes et animalières, la place de ce dernier au sein de ces établissements est particulièrement questionnée. Depuis plusieurs années déjà, la nécessité de la prise en compte du bien-être et de la sensibilité animale semble avoir considérablement imprégné la sphère tant sociétale que juridique. Avec l’augmentation de la réglementation en faveur de la protection des animaux et des espèces sauvages depuis la fin du 19e siècle, la sensibilité est même devenue le critère clé de la définition juridique de l’animal (à tout le moins domestique ou approprié) au sein du code rural[10] et du code civil[11]. Si la critique à l’acquisition par ces spectacles d’animaux d’espèces non domestiques, leurs conditions de transport, de détention et de dressage n’est pas chose nouvelle[12], ces activités suscitent de plus en plus de réactions d’opposition voire d’interdictions des cirques avec animaux sauvages.
Pour répondre à cette évolution sociétale, certains circassiens ont préféré faire le pari d’un cirque « 100% humain » et remplacer leurs animaux par des hologrammes comme le cirque Roncalli en Allemagne ou l’Éco-cirque Bouglione en France, allant même jusqu’à écarter tout animal domestique dans leurs spectacles comme les chevaux. Toutefois, ces décisions étant minoritaires parmi les cirques faisant appel à des animaux, c’est essentiellement du côté des lois nationales que se jouera l’avenir des cirques avec animaux dans les années à venir. À ce titre, une quarantaine d’États a déjà interdit totalement ou partiellement la présence d’animaux ou d’animaux sauvages dans les cirques dont plusieurs appartenant à l’Union européenne tels que la Suède, le Portugal, la Belgique, ou encore la Grèce.
La France n’est par ailleurs pas étrangère à ces revendications, d’aucuns avançant aujourd’hui une incompatibilité absolue entre le cirque et le respect des conditions biologiques des animaux sauvages. C’est ce dont témoigne notamment le sondage mené par la fondation 30 millions d’amis et l’IFOP, rappelant que la Fédération des vétérinaires européens (FVE) s’était prononcée en 2015 contre la détention notamment des mammifères sauvages dans les cirques itinérants, et la forte sensibilité du public à cet enjeu dès lors que « 72 % des Français sont favorables à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques » et que « plus de 400 municipalités françaises s’opposent à la venue sur leur territoire de cirques avec animaux »[13]. En témoigne également et a foriori la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes dont l’article 12 a pour objectif d’interdire au niveau national la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants, décision d’importance qui concernerait donc les 800 animaux sauvages actuellement détenus par ces établissements[14].
Il faut dire que bien que les autorités administratives aient à leur disposition un certain nombre d’outils pour tenter de garantir la compatibilité de la sensibilité et du bien-être des animaux avec les activités circassiennes (I), ces derniers sont considérés comme profondément limités, justifiant le souhait d’une interdiction locale ou nationale des cirques détenant des animaux sauvages (II).
I. Le rôle traditionnel des autorités administratives dans la prise en compte de la sensibilité de l’animal au sein des cirques
Comme a pu le souligner Christelle Leprince : « Ce mouvement animaliste a inévitablement eu une influence bénéfique dans le cadre du divertissement. Ce n’est pas parce que l’animal est au service d’une économie destinée à divertir l’homme qu’il doit, au nom de la liberté d’entreprendre, être moins bien traité »[15]. En effet, parce qu’ils sont juridiquement reconnus comme des êtres sensibles pour lesquels le propriétaire a l’obligation légale de respecter certaines exigences de bien-être (A), un certain nombre de mesures administratives sont prévues afin de veiller aux conditions d’acquisition, de détention et de participation des animaux aux spectacles de cirque (B).
A. L’animal « de cirque », un être pluriel et sensible
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’animal, quel qu’il soit, se voit appliquer le régime juridique des biens. En effet, le droit ne connait que deux grandes catégories : les personnes d’un côté (notamment les hommes, sujets de droit) et les biens de l’autre (le vivant et non vivant appropriables, objets de droit). Les animaux, qui ne pouvaient être qualifiés de personnes, ont donc été rattachés à la catégorie des biens. Il faut dire que l’animal apparait nécessaire à l’homme dans de nombreux aspects de sa vie : compagnon, alimentation, ressource, … Il existe donc en droit de nombreuses catégories juridiques différentes auxquelles se rattachent des règles spécifiques « définies selon la conception que l’homme se fait d’un animal, l’intérêt qu’il lui porte et l’usage auquel il le destine »[16]. Aussi, plus encore qu’appréhender l’animal dans sa possible réalité, le droit a organisé une fiction réificatrice permettant une classification des animaux fonction du lien entretenu avec l’homme[17] (animal approprié ou non, domestique ou non, rare, utile ou nuisible, etc.). Cette pluralité de catégories disparates, éclatées au sein des différents codes, emmène donc avec elle une grande diversité de régimes juridiques.
Dans le cas de l’animal mobilisé pour ces spectacles de cirque, demeurant juridiquement soumis au régime des biens en vertu de l’article 515-14 du code civil et ne pouvant ainsi pas être considéré par le droit comme un artiste[18], il est donc appréhendé de manière d’abord utilitaire. Or, vague, le terme d’animal renvoie en réalité ici à une pluralité d’espèces : chameaux, lions, chevaux, tigres, éléphants, chiens, … Pluriels, les animaux pouvant être amenés à prendre part aux spectacles et activités du cirque peuvent donc être aussi bien domestiques[19] que « non domestiques » c’est-à-dire sauvages[20]. Il est à noter que, les animaux de spectacle, bien qu’étant détenus en captivité, demeurent juridiquement des animaux sauvages c’est-à-dire des animaux qui, « sans être domestiques, vivent cependant soumis à l’homme et dans son entourage »[21]. Par principe, le droit prévoit la liste des espèces non domestiques que peuvent acquérir sous conditions les établissements fixes ou mobiles souhaitant présenter ces dernières au public[22].
Du fait de cette grande diversité, l’entreprise du juriste souhaitant s’intéresser à l’appréhension des animaux de cirque par le droit se heurte à un premier obstacle : « l’animal de cirque » n’existe pas. En effet, aucune catégorie juridique ne répond en propre à une telle appellation dans le droit contemporain. Ainsi, renvoyant à une réalité protéiforme, les termes « d’animal de cirque » englobent donc en pratique des espèces appartenant à des catégories d’animaux diverses, rendant vaine toute tentative de recherche dans le droit positif d’un régime uniformément applicable à ces dernières. Plus modestement peut-on alors envisager de s’intéresser à la prise en compte des animaux du cirque, comme ceux appartenant à des catégories juridiques différenciées mais acquis, détenus et utilisés par les établissements de spectacles circassiens.
Cependant, parce qu’ils sont tous des animaux répondant à la qualification juridique des articles L. 214-1 du code rural et de l’article 515-14 du code civil et parce qu’ils sont soumis au lien d’appropriation exercé par l’homme, ceux-ci bénéficient de règles communes de protection à ce titre, avant même leur prise en compte spécifique dans le cadre strict de leur utilisation par les cirques. En effet, en France, déjà dès le 19e siècle, l’animal ne peut déjà plus être considéré comme un simple bien ou une simple chose : si l’animal est réifié afin de justifier les prérogatives de l’homme à son encontre, celles-ci apparaissent limitées par la nature même de l’animal de telle sorte à ce que celui-ci devait être considéré comme, « le seul bien dont les personnes détentrices ont l’obligation légale d’assurer le bien-être »[23]. Ainsi, avec d’abord la célèbre loi Grammont de 1850[24], qui condamnait les mauvais traitements exercés en public sur les animaux domestiques, puis par le décret de 1959[25], qui l’abroge, sont réprimés l’ensemble des mauvais traitements exercés sur les animaux de compagnie, domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. A fortiori, la loi du 10 juillet 1976 venue reconnaitre de manière plus explicite la sensibilité des animaux domestiques et assimilés[26], indique que c’est à leur propriétaire d’assurer leur bien-être et de les placer dans « des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de [leurs espèces] »[27]. La loi du 16 février 2015[28] viendra quant à elle parachever cette montée de la reconnaissance du caractère sensible de l’animal en les qualifiant juridiquement « d’êtres vivants doués de sensibilité » à l’article 515-14 du code civil.
À ce titre, l’animal pouvant être amené à être utilisé dans le cadre de spectacles notamment de cirque, voit donc sa sensibilité juridiquement reconnue et constituer en cela un facteur limitant au droit de propriété pouvant s’exercer sur lui, et ce qu’il soit sauvage ou domestique[29]. Si une telle affirmation justifie, en cas de mauvais traitements, l’application des dispositions classiques du droit pénal, cela permet également au préfet d’intervenir au titre de sa police spéciale de protection des animaux. En effet, en vertu de l’article R. 214-17 du code rural, le préfet apparait comme l’autorité compétente pour prendre toute mesure nécessaire en cas de « mauvais traitement, d’absence de soins » ou si des animaux domestiques ou sauvages appropriés ou tenus en captivité « sont trouvés gravement malade pour que leur « souffrance […] soit réduite au minimum ». Cette police de protection des animaux, réaffirmée à l’occasion de plusieurs jurisprudences[30], lui donne ainsi compétence pour vérifier que l’utilisation faite de ces animaux, notamment dans le cas de leur participation à des spectacles, est conforme aux principes énoncés par les articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
L’augmentation de la protection juridique de l’animal a donc eu un retentissement certain sur la prise en compte du bien-être de l’animal du cirque puisque c’est bien sur la base et en application de ces dispositions communes aux animaux domestiques et sauvages assimilés que de nombreuses mesures, notamment de droit administratif, sont venues encadrer spécifiquement l’acquisition, le transport et la détention de ces animaux par les établissements circassiens.
B. Les animaux « du cirque », protégés par des mesures administratives spécifiques
Penser à la rencontre du droit administratif et de l’animal, c’est avoir le plus souvent à l’esprit un ensemble de mesures ayant plutôt vocation à s’appliquer contre l’animal (décisions d’euthanasie des animaux dangereux, de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, etc.). Pourtant, cela a été vu, non seulement est mise en place une police administrative spéciale visant à permettre le contrôle de l’utilisation des animaux domestiques et sauvages en captivité, mais c’est également aux autorités administratives qu’il appartient de mettre en œuvre la réglementation permettant l’encadrement spécifique de l’utilisation de l’animal dans les spectacles vivants fixes ou itinérants, en amont et en aval de leur ouverture et/ou de leur installation.
C’est donc d’abord au titre de l’acquisition et de la possibilité de détention des animaux domestiques ou sauvages par les cirques que va intervenir l’autorité administrative. En effet, si pour l’heure l’animal est encore envisagé juridiquement comme une chose et peut de ce fait être approprié en suivant les règles classiques du droit privé, la situation est un peu plus complexe s’agissant de l’acquisition d’animaux par des établissements envisageant la détention de ceux-ci à but lucratif (et en ce qui concerne la présente contribution, les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou non indigène[31]) et tout particulièrement si ledit animal appartient à une espèce non domestique.
Pour l’acquisition et la détention d’animaux non domestiques, les conditions sont très strictes. D’une part, l’origine des animaux doit pouvoir être prouvée par exemple par la possession d’un document « CITES » dans le cadre des espèces sauvages mentionnées aux annexes de ce règlement[32]. D’autre part, l’établissement doit également être titulaire de plusieurs documents administratifs afin de pouvoir espérer détenir et utiliser ces espèces animales au sein de ses spectacles à savoir un certificat de capacité en vertu des articles L. 413-2 du code de l’environnement ainsi qu’une autorisation d’ouverture[33]. Ce premier document, délivré par le préfet parfois sur saisine de la commission consultative pour la faune sauvage[34] permet en effet d’attester que son titulaire est bien compétent pour assurer l’entretien des animaux, l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille, et repose donc pour ce faire sur son expérience professionnelle ou tout autre document permettant d’apprécier ses compétences[35]. Ce certificat, délivré pour une durée indéterminée ou limitée et étant strictement personnel[36], constitue l’une des formalités préalables à l’autorisation d’ouverture que doit détenir tout établissement destiné à la présentation au public d’animaux, bien que les deux puissent être demandés conjointement[37]. Cette autorisation, également délivrée par le préfet[38] mentionne alors entre autres la liste des espèces autorisées, le nombre d’animaux de chaque espèce, mais aussi le type d’activités susceptibles d’être pratiquées ainsi que les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la sécurité et la santé publiques, l’identification, le contrôle sanitaire et la satisfaction aux règles de détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Dans le cadre particulier des établissements itinérants, pour lesquels il est assurément plus complexe de garantir le bien-être des animaux en raison des conditions de transports, certaines formalités supplémentaires sont exigées. Il est notamment demandé par l’article L. 412-1 du code de l’environnement que l’utilisation des animaux au cours des spectacles itinérants soit soumise à autorisation préfectorale. Celle-ci, comme le rappelle l’arrêté du 18 mars 2011 précité, ne sera toutefois accordée que pour une liste limitative d’espèces[39] et qu’aux seuls établissements bénéficiant de l’autorisation d’ouverture précédemment évoquée[40]. Outre ces formalités administratives liées aux critères nécessaires à l’ouverture de ces établissements itinérants, ces derniers devront également disposer d’un titre régulier d’occupation du domaine public communal[41].
Pour la détention d’animaux domestiques, en revanche, le droit n’avait pas d’exigence particulière avant l’ordonnance de 2015[42] qui est venue renforcer la protection des chiens et des chats notamment dans le cadre de leur utilisation par les cirques. A présent, les établissements circassiens qui souhaiteraient exercer des activités de dressage, d’éducation et de présentation au public de chiens et de chats doivent déclarer leur activité en préfecture mais aussi mettre en place et utiliser des installations conformes et attester qu’au moins une personne en contact direct avec les animaux puisse justifier de compétences particulières (avoir reçu une certification professionnelle ou une formation dans un établissement habilité ou encore être titulaire d’un certificat de capacité[43]).
Ainsi, au titre des conditions de détention et d’utilisation devant être mentionnées par ces documents, l’on retrouve des règles communes à l’ensemble des animaux (interdiction de faire participer à un spectacle un animal dégriffé)[44], spécifiques à certains animaux domestiques (comme les équidés et les camélidés)[45] ou non domestiques (obligation d’identification, d’enregistrement des animaux sauvages)[46], et d’autres ne valant encore que dans le cadre des cirques itinérants[47]. Cette diversité, si elle peut être source de complexité, permet toutefois de prendre en compte de manière plus précise les exigences liées aux impératifs biologiques de chaque espèce. À titre d’exemple, l’arrêté de 2011 fixe certaines conditions spécifiques relatives aux conditions de détention des animaux sauvages au sein des cirques itinérants, concernant notamment leur transport[48] ou espèce par espèce, prévoyant notamment que seuls les spécimens femelles d’éléphants d’Asie peuvent être autorisés ou encore que la détention d’une girafe ou d’un hippopotame amphibie ne peuvent être permis que sous réserve, entre autres conditions, que les établissements itinérants disposent d’installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles peuvent être hébergées ces espèces entre les périodes itinérantes de représentation.
Pour compléter cette règlementation ayant pour objectif de protéger la sensibilité de l’animal malgré son utilisation dans le cadre de ces spectacles, l’autorité administrative peut enfin être également sollicitée en aval de l’ouverture et de l’installation de l’établissement de spectacle fixe ou mobile. En effet, les établissements présentant des animaux sauvages au public sont soumis à des contrôles conduits sous l’autorité du préfet[49] devant avoir lieu au moins une fois par an. Seront notamment vérifiés lors de ces contrôles la détention effective par les établissements des documents administratifs précités mais aussi le respect des règles de détention des animaux.
Ces diverses mesures ont ainsi été prévues afin de permettre la conciliation effective de la sensibilité et du bien-être des animaux avec l’institution du cirque et du spectacle en général. Pourtant, malgré leur existence, celles-ci sont aujourd’hui jugées profondément insuffisantes et inadaptées, conduisant même les autorités de police administrative à aller jusqu’à l’interdiction pure et simple (temporaire ou définitive) des cirques sur leurs territoires, quitte à risquer l’annulation de leurs arrêtés. Car plus encore que l’existence d’une réglementation de protection de l’animal, c’est la compatibilité même de l’animal, en particulier sauvage, avec les conditions de détention et d’utilisation propres au cirque qui est aujourd’hui décriée.
II. Des interdictions locales à l’interdiction nationale des cirques avec animaux sauvages
La question de l’incompatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce avec ses besoins spécifiques et son bien être est l’une de celles ayant provoqué le plus de discussions et de débats passionnés sur les bancs du Parlement depuis le dépôt de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale[50] le 14 décembre 2020. Il faut dire que cette problématique, largement soulignée par les associations de protection animale et par divers comités scientifiques, a également pu diviser les communes. En ce sens, certaines ont en effet pris position en faveur de la protection des animaux sauvages, faisant le choix d’interdire sur leur territoire l’installation des cirques qui en détiendraient, au détriment parfois de leur champ de compétence (A). Ces interdictions locales sont intéressantes à plusieurs titres, en ce qu’elles ont pu à la fois éclairer sur la réalité des compétences du maire en la matière mais également en mettant en exergue le réel intérêt sociétal pour la protection de l’animal. Un intérêt qui semble aujourd’hui se concrétiser par la récente décision de la commission mixte paritaire d’interdire nationalement la possibilité pour les cirques itinérants de détenir tout animal sauvage (B).
A. Le développement de mesures d’interdictions locales à la légalité toutefois contestée
Si les points faibles de la réglementation encadrant l’utilisation des animaux dans le cadre des cirques ont pu être soulevés, notamment dans le cadre des contrôles dont la fréquence pratique serait en moyenne d’une fois tous les deux ans,[51] c’est principalement l’impossible conciliation entre le bien-être de l’animal et son utilisation, sa détention et son transport par les établissements circassiens qui est aujourd’hui contestée. Ce n’est donc pas uniquement la possibilité pour l’animal d’être victime d’une maltraitance au sens où l’entend le code pénal qui est à l’origine de l’essentiel des critiques formulées, mais bien cette idée d’une incompatibilité absolue entre les besoins physiologiques, mentaux et sociaux des animaux et leur détention et utilisation par des cirques fixes mais surtout itinérants[52]. En effet, comme le souligne en ce sens Frank Schrafstetter : « hormis les actions coercitives du dresseur, il nous semble probable que nombre de cirques soient sincèrement attachés à leurs bêtes. Le problème de détention des espèces sauvages n’est pas forcément lié à une forme de maltraitance qui serait généralisées de la part des professionnels du cirque, mais bien au décalage qui existe entre les besoins physiologiques d’une espèce (besoins sociaux, territoriaux, alimentaires) et les conditions de vie qui sont proposées en captivité »[53]. Ce sont d’ailleurs ces termes qui se retrouvaient dans la proposition de loi sur la maltraitance, puisqu’il était envisagé que la détention de certains animaux d’espèces non domestiques pourrait être interdite par les cirques itinérants au regard du degré « d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques »[54]. En conséquence, bien que témoignant d’une prise en compte accrue de la sensibilité des animaux du cirque, la réglementation encadrant les conditions de détention, de dressage et de transports des espèces sauvages au sein des cirques apparait en l’état en inadéquation avec les connaissances scientifiques actuelles. À titre d’exemple, concernant les conditions de dressage des animaux, alors que le droit prévoit qu’au « cours du dressage, ne doivent être exigés des animaux que les actions et les mouvements que leur anatomie et leurs aptitudes naturelles leur permettent de réaliser en entrant dans le cadre des possibilités propres à leur espèce », il a pu être rapporté que si « la position en poirier qui est imposée aux éléphants dans nombre de cirques est possible en terme de réalisation », ces dernières « peuvent causer des blessures » aux « éléphants adultes »[55]. De la même manière, plusieurs vétérinaires ont pu constater de longue date le développement de stéréotypies chez les spécimens d’animaux détenus, qui peuvent être définies comme « des indicateurs de mal-être et de souffrance chronique chez les animaux sauvages captifs », « des comportements répétitifs, invariants, identiques, sans but ou fonction apparent ; ils sont anormaux et inexistants à l’état naturel chez l’animal »[56] tels que le balancement d’une patte sur l’autre ou des allers et retours dans les cages.
C’est donc l’ensemble de ces préoccupations qui a pu amener plusieurs communes à formuler ces dernières années un certain nombre d’interdictions locales à l’encontre de l’installation des cirques sur leurs territoires, alors même que ces derniers pouvaient par ailleurs être en conformité avec la réglementation applicable[57]. Il faut dire que, comme cela a été vu précédemment, les cirques ayant recours aux animaux sauvages à l’occasion de leurs spectacles et respectant la réglementation en vigueur doivent pouvoir se produire sur le territoire communal[58]. Toutefois et pour rappel, le maire dispose d’une compétence de police administrative générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. À ce titre, ce dernier a donc compétence pour prévenir les désordres matériels (trouble à la sécurité, tranquillité ou salubrité publiques) ou immatériels (trouble à la moralité publique[59] ou à la dignité humaine[60]) à l’ordre public. Classiquement, l’autorité de police administrative ne peut toutefois pas porter une atteinte démesurée à l’exercice d’une liberté, sa mesure devant ainsi être à la fois nécessaire, adaptée et proportionnée au trouble allégué[61]. Toutefois, bien que le maire ne dispose ni d’un pouvoir de police spéciale s’agissant des spectacles avec animaux[62], ni s’agissant des mauvais traitements envers les animaux[63] ce dernier peut, « en cas de troubles à l’ordre public […] interdire l’installation d’un cirque avec animaux sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale »[64].
Or, si c’est bien à ce titre qu’a été adoptée la multiplicité des arrêtés précités, de prime abord, la jurisprudence découlant de la contestation de ces arrêtés semble finalement mettre en relief peu de choses nouvelles en comparaison de la jurisprudence en matière de police administrative. En effet, la majorité des arrêtés ayant été annulés l’ont été en raison de la formulation d’une interdiction générale et absolue portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie des établissements itinérants[65], du fait de l’incompétence du conseil municipal en matière de police administrative[66] ou de l’absence de l’établissement de circonstances locales au soutien du caractère immoral allégué de l’activité[67]. Cependant, l’étude plus critique de cette jurisprudence a pu souligner la mise en exergue de plusieurs problématiques d’intérêt, tant pour le droit administratif que pour l’évolution du droit animalier.
Dans un premier temps, la pluralité d’arrêtés au soutien de la protection animale permet de souligner une augmentation drastique de la prise en compte du bien-être animal par les autorités locales pour dépasser les traditionnelles mesures de prévention des troubles causés par ceux-ci[68], ayant permis à certains auteurs d’aller jusqu’à s’interroger sur la pertinence de la mise en place d’un « ordre public animalier »[69]. À ce titre, la dignité animale a toutefois été écartée par le juge administratif comme composante de l’ordre public, conformément à la position de la rapporteure publique à la Cour administrative d’appel de Bordeaux : « Si la société est sans doute en train d’évoluer sur ce sujet, reste que le respect du bien-être animal, la « dignité de l’animal », sauvage ou non, n’est pas en l’état actuel du droit positif, une composante de l’ordre public à la différence de la dignité de la personne humaine placée au sommet des exigences de notre système juridique »[70]. Dans un second temps, cette diversité a également permis de faire émerger la question de l’articulation des pouvoirs de police spéciale de protection animale détenus par le préfet avec ceux détenus par le maire au titre de sa police générale. En ce sens, il semble que la jurisprudence tende plutôt vers une compétence exclusive du préfet en la matière, empêchant ainsi toute aggravation des mesures préfectorale par le maire[71] notamment en « l’absence de péril grave et imminent »[72].
Aussi, les possibilités d’interdiction des cirques fondée sur les pouvoirs de police générale du maire semblent très limitées, justifiant en ce sens le choix de certaines communes de formuler des vœux, simples mesures de soft law[73] mais « à haute valeur symbolique pour un monde animal sans souffrance »[74]. Car finalement, comme a pu le souligner A. Chauvin suite à sa réflexion sur la motivation de l’arrêté du maire de Pessac, « c’est peut-être le cadre local qui n’est pas adapté à la nature du problème » mais bel et bien une « carence du législateur »[75].
B. Vers une interdiction nationale des animaux sauvages dans les cirques itinérants
Pour pallier l’ensemble de ces problématiques, c’est vers une interdiction nationale de la détention des animaux sauvages par les cirques itinérants que semble se tourner la France aujourd’hui. Le souhait d’une telle interdiction de l’utilisation des animaux au sein des cirques et plus largement de leur retrait de tout type de spectacle n’est pas nouveau. En effet, en 2017 déjà, Ségolène Royal, alors ministre de l’Écologie, avait adopté un arrêté sur les delphinariums, interdisant notamment la reproduction en captivité des cétacés et les échanges et imports de nouveaux mammifères marins. Ce dernier avait cependant été retoqué par le Conseil d’État pour vice de forme et l’interdiction était restée lettre morte[76].
Avec l’article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance déposée le 14 décembre 2020 ce souhait d’interdiction est redevenu véritablement concret. En effet, ledit article prévoit des dispositions spécifiques relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement, à savoir notamment les cétacés mais aussi les animaux non domestiques destinés à être présentés au public par des établissements itinérants. Après lecture par l’Assemblée nationale, il était alors envisagé d’interdire la détention, l’acquisition, la reproduction des animaux d’espèces non domestiques, justifiant dès lors l’impossibilité pour les préfets de pouvoir délivrer de certificat de capacité ou d’autorisation d’ouverture aux cirques itinérants ainsi que l’abrogation des autorisations d’ouverture délivrées[77]. La discussion devant le Sénat modifie toutefois ce texte en substance, ne prévoyant plus d’interdiction générale mais de simples interdictions ciblées et distinguant clairement les établissements fixes des établissements mobiles[78]. En effet, la proposition de loi modifiée prévoyait alors toujours une interdiction de détention, de commercialisation, de transport et de reproduction pour les cirques mais seulement de certaines espèces sauvages listées par arrêté du ministère (et pour lesquelles l’activité du cirque pourrait être objectivement considérée comme incompatible avec leur bien-être) et seulement dans le cas des cirques strictement itinérants[79]. Autre nouveauté introduite par le texte : l’application d’un délai spécifique à chaque espèce pour l’entrée en vigueur de ces interdictions mais ne courant que cinq ans après la promulgation de la loi. L’objectif de ce temps étant alors notamment d’accompagner l’évolution des pratiques concernées mais aussi de garantir l’existence d’alternatives viables et permettant d’assurer effectivement le bien-être des animaux (notamment en termes de capacité et de conditions d’accueil).
A l’heure de l’écriture de cette contribution, la Commission mixte paritaire vient de revenir une nouvelle fois sur le texte, retournant selon ses mots à « une rédaction plus proche de celle de l’Assemblée tout en incorporant des améliorations apportées par le Sénat »[80]. En effet, celle-ci introduit un nouvel article L. 413-10 du code de l’environnement prévoyant à nouveau l’interdiction de l’acquisition, commercialisation, reproduction, détention et transport de tout animal d’espèce non domestique dans les établissements de spectacle itinérants. Elle conserve cependant l’idée des délais introduite par le Sénat, prévoyant que pour l’interdiction d’acquisition et de commercialisation, la proposition de loi entrerait en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans ans à compter de la promulgation de la loi, contre sept pour l’interdiction de transport et de détention de ces animaux. Autre innovation par rapport au texte d’origine, la subordination de l’interdiction de tout animal sauvage au sein des cirques itinérants à l’existence de solutions d’accueil pour les animaux « retraités », favorables à la satisfaction de leur bien-être. À défaut, un décret en Conseil d’État précisera les conditions dans lesquelles il sera possible de déroger à l’interdiction (et donc pour les cirques de conserver leurs animaux). À l’instar du Sénat, la Commission prévoit par ailleurs que les criques fixes, de même que les établissements zoologiques à caractère fixe, pourront continuer à présenter des animaux sauvages au sein de leurs spectacles. Si ce point, qui crée une différence claire entre établissements mobiles et fixes avait été particulièrement discuté et critiqué lors des débats à l’Assemblée nationale, il avait été estimé qu’une telle différence, fondée sur un critère objectif – l’itinérance -, permettrait de justifier le souhait de ne pas remettre en cause l’activité pédagogique des établissements zoologiques.
Par conséquent, si la figure du cirque traditionnel s’est en partie construite par l’animal et semble devoir très prochainement devoir réapprendre à se reconstruire sans l’animal, elle ne disparaitra pas pour autant. Parce que la présence de l’animal n’est pas une caractéristique essentielle à la qualification ou à l’existence du cirque, parce que son absence signera l’adaptation d’une institution ancienne aux préoccupations et connaissances actuelles, le cirque traditionnel et ses spectacles artistiques ne disparaitra pas. L’amorce de cette évolution, encore incomplète puisqu’écartant la question de la détention des animaux sauvages au sein des établissements de spectacles fixe, semble toutefois un premier pas important quant à la réflexion sur l’appréhension juridique de la sensibilité de l’animal sauvage, captif ou non, et plus largement de la place à lui accorder dans un monde en mouvement.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), Dir. Pech / Poirot-Mazères
/ Touzeil-Divina & Amilhat ;
L’animal & le droit administratif ; 2021 ; Art. 367.
[1] Selon Le Lexis (Larousse) : « Enceinte circulaire, piste sablée destinée aux jeux publics, chez les Romains » ; N. Maillard, « L’animal au cirque. Communion civique et divertissement collectif autour de l’asservissement de la mort animale », RSDA 2/2016, p. 191.
[2] N. Maillard, ibid.
[3] Pour une vision plus détaillée de la naissance du cirque moderne, v. notamment X. Perrot, « La fabrique du divertissement animalier. Cirque et combats, entre dénaturation pour le rire et effusion de sang pour le plaisir », RSDA 2/2016, pp. 209-224.
[4] Ibid.
[5] Loi n°99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
[6] Article 1.1 de l’Annexe V de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 relative aux Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
[7] Ibid. : « Ces spectacles sont souvent des spectacles itinérants produits sous chapiteau, pour lequel tout ou partie du personnel est logé en structures mobiles ».
[8] Ibid : « Ces spectacles peuvent être diffusés selon différents modes d’exploitation : salle, espace public, structures mobiles… »
[9] Article 1er de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacle itinérants.
[10] Article L. 214-1 du code rural.
[11] Article 515-14 du code civil.
[12] X. Perrot rapporte en ce sens, sur le fondement des travaux de V. Pelosse et P. Serna, que lors de l’un des concours de l’Institut National en 1802 portant sur la question « Jusqu’à quel point les traitements barbares sur les animaux intéressent-ils la morale publique ? Et conviendrait-il de faire de faire des lois à cet égard ? », plusieurs dissertations auraient demandé l’abolition de ces spectacles animaliers. V. X. Perrot, op. cit., p. 210.
[13] Troisième vague du baromètre annuel « Les français et le bien-être des animaux » mené par la fondation 30 millions d’amis et l’IFOP, janvier 2020 in Rapport de l’Assemblée nationale en date du 20 janvier 2021, p. 12.
[14] Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi, modifiée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, enregistré aux présidences du Sénat et de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2021.
[15] Christelle Leprince, « Les animaux de spectacle », in F.-X. Roux-Demarre, L’animal et l’homme, Éditions Mare & Martin, 2019, p. 77.
[16] O. Le Bot, Introduction au droit de l’animal, Independently published, 2018, p. 23.
[17] V. en ce sens : L. Boisseau-Sowinski, « Animaux de compagnie, animaux de ferme ; animaux sauvages : variabilité de la protection et hiérarchie des sensibilités », in : R. Bismuth et F. Marchadier, Sensibilité animale. Perspectives juridiques, CNRS éditions, Paris, 2015, p. 148-171.
[18] É. Barby, « Les animaux de spectacle », Legicom, 1995/3 n°9, p. 21.
[19] Cass. Crim. 14 mars 1861, Bull. crim. n°53 : animaux « placé sous la main de l’homme [qui] ne vivent, ne se reproduisent, ne sont nourris et élevés que sous son toit et par ses soins » ; Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.
[20] Animaux qui « vivent, se reproduisent et se nourrissent en dehors de toute intervention humaine », n’ayant « subi aucune sélection de la main de l’Homme » et étant « destinés à vivre dans leur milieu naturel ». V. M. Redon, Animal, Répertoire de droit civil, Dalloz, avril 2015, p. 1-2 ; art. R. 411-5 al. 1er du C. env.
[21] Ibid., articles L. 413-1 à L. 413-5 du code de l’environnement.
[22] Arrêté du 30 mars 1999, fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article ; R. 413-6 du code de l’environnement ; arrêté du 18 mars 2011 op. cit.
[23] S. Antoine, Rapport sur le régime juridique de l’animal, Ministère de la justice, 10 mai 2005, p. 27-28.
[24] Loi du 2 juillet 1850 dite Grammont sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques, JORF du 20 août 1944 page 299.
[25] Décret n°59-1051 du 7 septembre 1959 réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux.
[26] Il s’agit alors des animaux sauvages en captivité ainsi que de ceux ayant été apprivoisés.
[27] Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifié à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime par l’Ordonnance 2000-914 du 21 septembre 2000.
[28] Art. 2 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015.
[29] La reconnaissance juridique de la sensibilité aux animaux res nullius étant encore débattue aujourd’hui, celle-ci semblant pour l’heure s’envisager comme une forme de compensation du lien d’appropriation. V. en ce sens : L. Boisseau-Sowinski, op. cit., p. 163-164.
[30] V. not. CAA Nancy, 15 nov. 2010, n° 09NC01433, TA Lyon, 25 novembre 2011, n°1908161 ; F. Nicoud, « Maltraitance à animaux et pouvoir de police du maire », AJDA, 2011, p. 1446.
[31] L. 413-2 du C. env.
[32] Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ; Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n°939/97 de la Commission européenne, L. 412-1 C. env.
[33] Il est à noter que l’ensemble de ces documents peut être sollicité par toute personne (c’est en pratique notamment le cas des associations) auprès des communes ou auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs pour ce faire.
[34] R. 413-2 à R. 413-7 du C. env.
[35] R. 413-4 et s. du C. env.
[36] R. 413-3 du C. env.
[37] L. 413-3 et R. 413-8 et s. C. env.
[38] Du département dans lequel est situé l’établissement ou, pour les cirques itinérants, au préfet dans lequel le demandeur est domicilié.
[39] Article 3 de l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application sur le commerce international des espèces, op. cit.
[40] L’arrêté prévoyant toutefois à son article 2 que « Lorsqu’elle prévoit la réalisation de spectacles itinérants, l’autorisation d’ouverture des établissements, délivrée en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, vaut autorisation préfectorale préalable au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées »
[41] L. 2122-1 du CG3P.
[42] Ordonnance n°2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie ; L. 214-6-1 du code rural.
[43] Ibid.
[44] R. 214-84 à -86 du C. rural.
[45] Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux.
[46] Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
[47] Arrêté du 18 mars 2011 op. cit.
[48] Articles 30 et 32 de l’Arrêté du 18 mars 2011.
[49] L. 415-1 C. env., R. 413-43 et s. C. env.
[50] À « renforcer la lutte contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes » de son nom actuel.
[51] Leprince, op. cit., p. 82.
[52] Not. Recommandation de la Fédération des vétérinaires d’Europe (FVE) le 6 juin 2015.
[53] F. Schrafstetter, « Tribune contradictoire. Pourquoi les animaux sauvages n’ont rien à faire dans les cirques », RSDA 2/2016, p. 174.
[54] Art. 12 de la Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale tel qu’enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2020.
[55] F. Schrafstetter, op. cit., p. 173.
[56] L. Carillon, Contribution à l’étude de l’utilisation des animaux à des fins de spectacle en France : état des lieux des pratiques et de la réglementation, analyse éthique, thèse, Lyon I, 8 juillet 2020, P ; 27.
[57] Ces questions ont largement été commentées par la doctrine. V. notamment en ce sens : A. Moreau, « Encadrement des cirques présentant des animaux vivants : quelle place pour le maire ? Trois questions à Arielle Moreau », AJCT 2020, p. 119 ; M. Falaise, « Protection animale et bien-être animal : une prise en compte croissant par le législateur et le citoyen », AJCT 2020, p. 116 ; C. Leprince, op. cit., pp. 84-87 ; J. Kirszenbalt, L’animal en droit public, thèse de droit, Université d’Aix-Marseille, 2018, pp. 556-564.
[58] Circulaire du 7 avril 2017 du ministère de l’intérieur relative aux médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes foraines (NOR : INTA1710483J).
[59] CE.,18 déc. 1959, Société « Les Films Lutetia », et syndicat français des producteurs et exportateurs de films, Rec. Lebon, p. 693.
[60] Not. CE., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. Lebon, p. 372.
[61] CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°17413, 17520, Rec. Lebon, p. 541.
[62] A. Moreau, op. cit.
[63] Ce pouvoir de police spéciale étant confié au préfet.
[64] Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question écrite n°16584 de Mme Christine Herzog, publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020, p. 3596.
[65] TA Lyon, 25 novembre 2020, n°1908161
[66] TA Bastia, 22 octobre 2020, n°1800925 ; TA Nancy, 22 janvier 2019, n°1802270, Association de défense des cirques de famille et a. ; A. Denizot, « Le maire, le conseil municipal et les cirques : de l’art de prendre position sans faire grief ».
[67] TA Lyon, 25 novembre 2020, op. cit., CAA Marseille, 7 juin 2021, n°19MA04275.
[68] M. Falaise, op. cit.
[69] V. en ce sens la thèse de J. Kirszenbalt précitée, notamment p. 556 et s.
[70] A. Chauvin, « Le respect de la dignité animale n’est pas une composante de l’ordre public », JCP La semaine juridique – édition administrations et collectivités territoriales, LexisNexis, n°25, 28 juin 2021, p. 2213.
[71] TA Montreuil, 3 octobre 2019, n° 1801566, CAA Marseille, 30 novembre 2020, n°19MA0047.
[72] TA Lyon, 25 novembre 2020, n°1908161 ; TA Lille, 11 décembre 2020, n°183486.
[73] A. Denizot, op. cit.
[74] C. Leprince, op. cit., p. 85.
[75] A. Chauvin, op. cit.
[76] CE, 29 janvier 2018, Société Marineland, Société Safari Africain de Port, St Père et autre, n°412210 et 412256.
[77] Art. 12 de la Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale tel qu’enregistré à la Présidence du Sénat le 20 janvier 2021 (n°3791).
[78] Rapport (AN), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2021.
[79] Le texte prévoyant alors une dérogation pour les établissement fixes effectuant des prestations mobiles.
[80] Rapport de la Commission paritaire, op. cit.