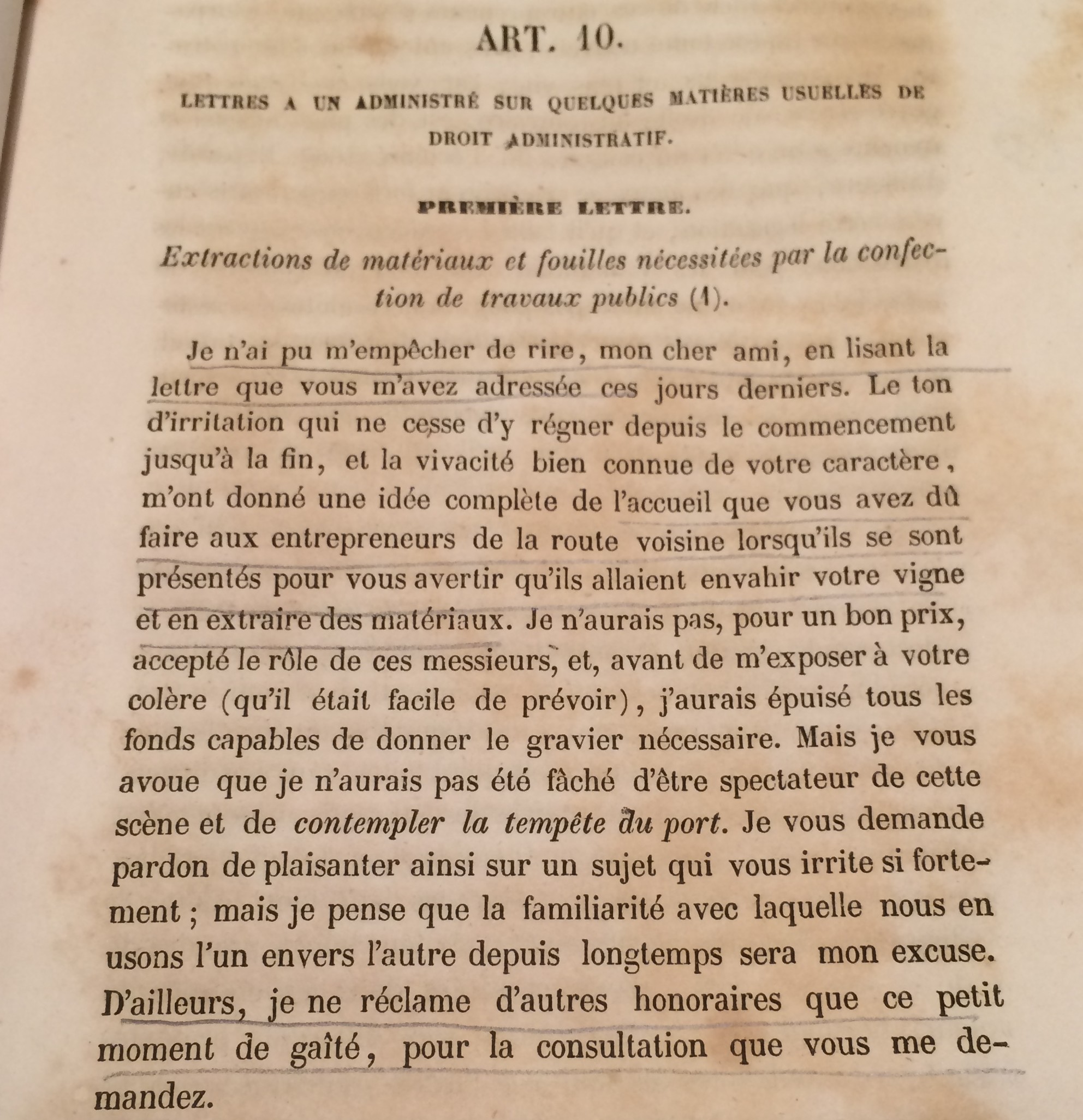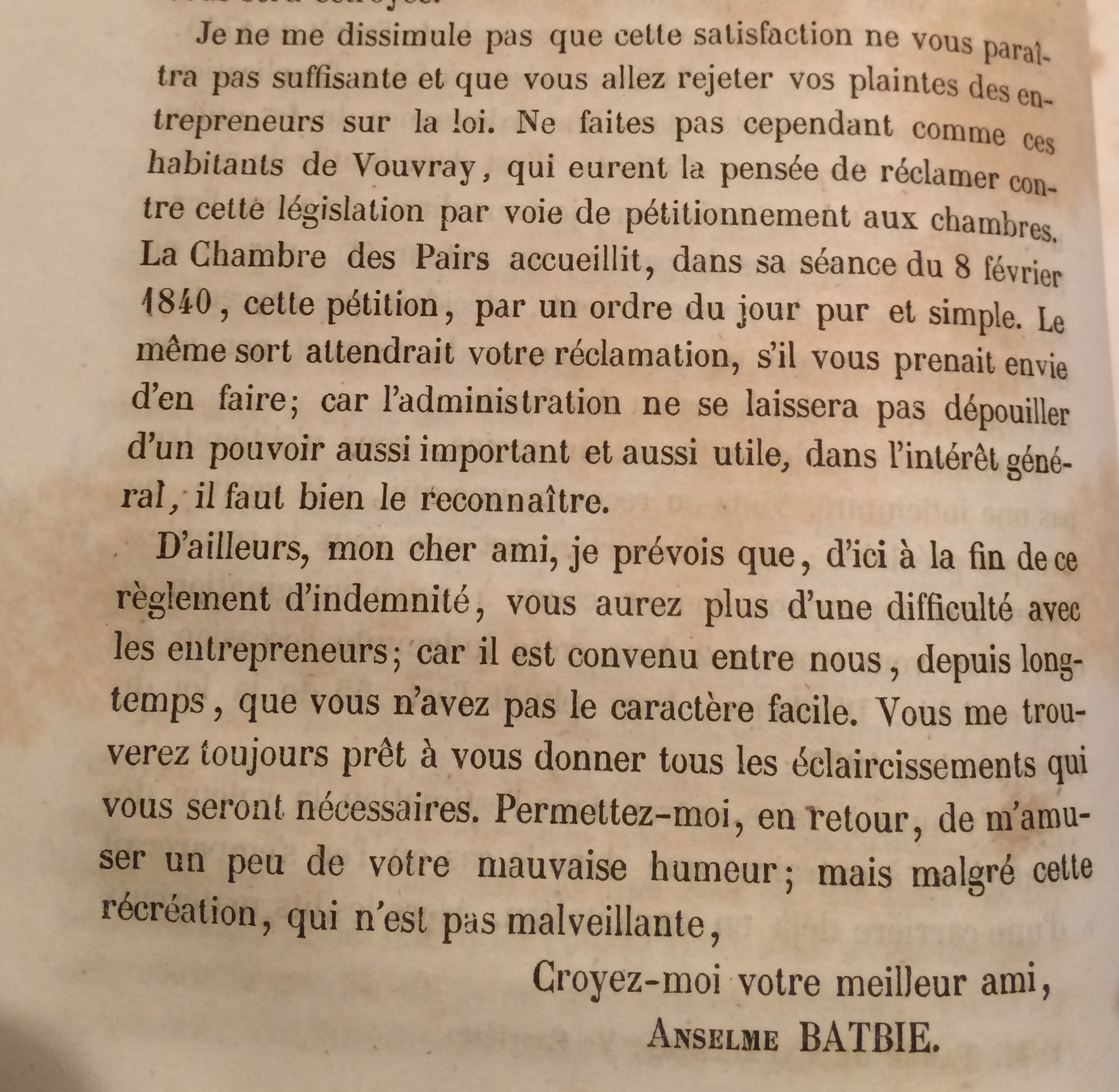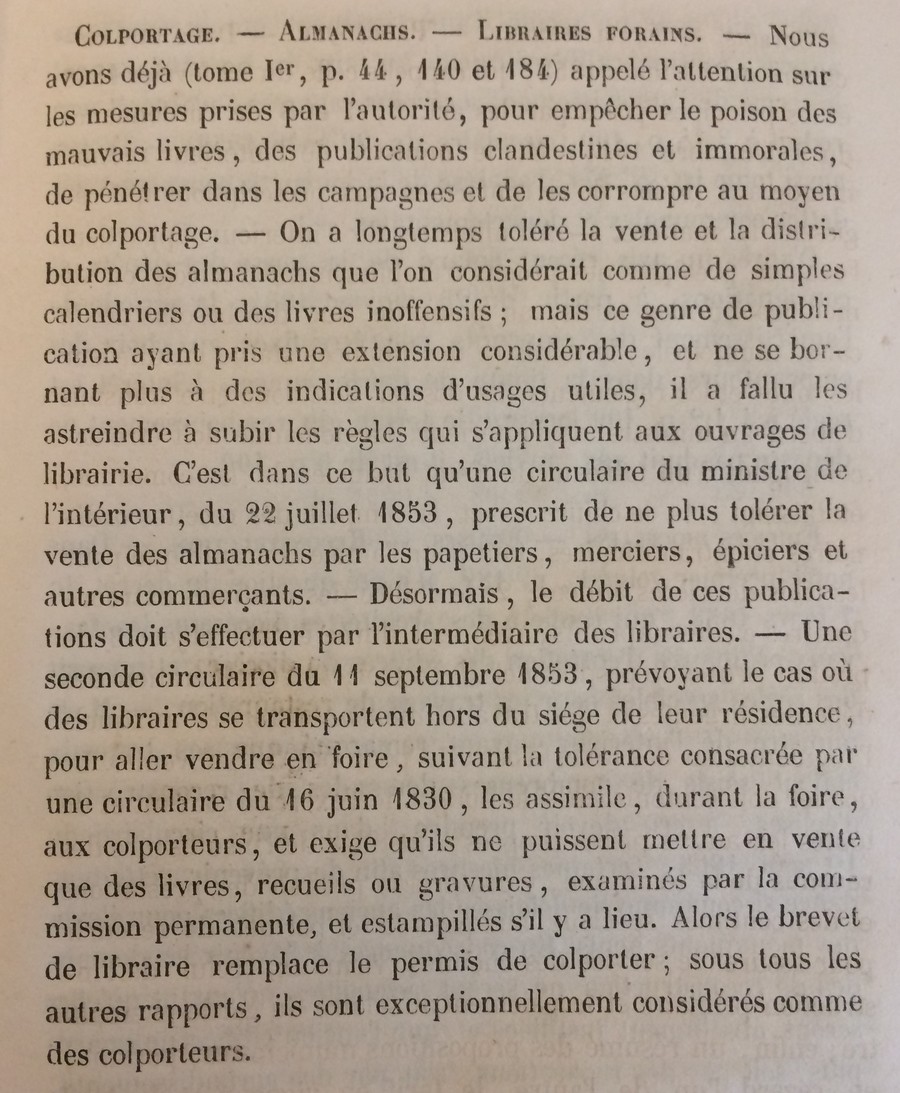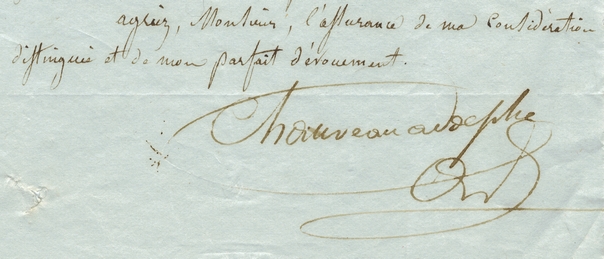Art. 64. Depuis le 1er janvier 2016 est entré en vigueur l’essentiel du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) édicté par l’ordonnance n°2015-1341 et le décret n°1342 du 23 octobre 2015. Présenté comme la lex generalis du droit des relations entre le public et les administrés, citoyens et usagers, il codifie une grande partie des textes applicables jusque-là à la relation administrative. Il a pour objectif de rassembler les « règles générales » c’est-à-dire les règles transversales régissant les personnes physiques et morales avec l’administration. Un code de ce type était attendu depuis une vingtaine d’années après les tentatives inabouties de 1996 et 2004. Sollicité par la doctrine depuis plusieurs décennies, le droit français avait accumulé un retard considérable au regard de la plupart des pays occidentaux déjà dotés parfois depuis plusieurs décennies d’une loi de procédure administrative (EU, Allemagne, Espagne, etc.). La multiplicité des lois et décrets rendait la matière peu accessible, particulièrement pour les principaux intéressés, les citoyens. En outre, aux textes législatifs et réglementaires, s’ajoutaient la source jurisprudentielle (largement dominante) ainsi que les sources constitutionnelles, internationales et européennes du droit de la procédure applicable aux relations entre l’administration et les citoyens, dans un contexte profondément renouvelé par le numérique, le développement des droits fondamentaux et la prise en compte du droit comparé, ce qui invitait à refondre la matière, par certains aspects, obsolète ainsi qu’à renforcer le dialogue entre l’administration et les citoyens.
Ce deuxième dossier du Journal du Droit Administratif dont l’ambition est de tenter de « à la portée de tout le monde » les arcanes de la relation administrative rassemble plusieurs contributions sélectionnées par un appel à publication. Portant sur un aspect très technique du droit administratif : la codification de la relation entre l’administré et l’administration, le dossier fait à la fois un état de ces relations mais également une analyse critique du nouveau Code des relations entre le public et l’administration. Pour ce dossier, le Journal du droit administratif (JDA) a donc décidé de prendre pour objet de réflexion(s) la / les question(s) de la / des relation(s) administrative(s) et de porter un regard complet sur le Code des Relations entre le Public et l’Administration, dans une optique pédagogique et ce selon quatre parties. La première partie de ce dossier vise à resituer la contribution et les limites du code des relations entre le public et l’administration au sein des concepts fondamentaux du droit des relations administration-administrés. La relation entre ces deux acteurs de l’activité administrative est, en tant que telle, ancienne comme le rappelle très justement Mme Espagno-Abadie bien que, un siècle et demi avant le CRPA, le contexte fut incontestablement différent comme le souligne le Pr. Touzeil-Divina. Parce que la terminologie présente une réelle importance dans l’ensemble du droit administratif et précisément dans ce Code, un certain nombre d’auteurs ont analysé les termes choisis et les définitions retenues ; vous pourrez ainsi lire les articles de Mme Tamzini , de M. Groulier ou encore du Pr. Truchet. Le lecteur peut ainsi plus facilement comprendre la codification en question dont il faut d’emblée préciser qu’elle n’est pas toujours synonyme d’innovation, ni de simplification…
La deuxième partie vise à analyser la réglementation édictée par le code, et ce, selon une optique pédagogique, tout en suivant sa structuration afin d’en faciliter la compréhension par les lecteurs du JDA. La codification est analysée de manière précise de sorte que plusieurs aspects fondamentaux du Code sont analysés dans ce dossier, des dispositions liminaires analysées par le Pr. Saunier, à l’analyse des actes administratifs unilatéraux lesquels appréhendés au regard de leur entrée en vigueur par Mme Crouzatier-Durand mais également de leur sortie de vigueur étudiée par M. Gaullier, sans que soient occultées les décisions implicites exposées par Mme Benard-Vincent. Les grands principes du droit administratif tels que l’obligation de motivation , le principe de bonne administration ou la question des droits et libertés sont analysés par les Pr. Carpano, Dubos et Koubi. Il apparaît à la lecture du Code qu’une bonne relation suppose la participation des administrés, notamment aux processus décisionnels comme le souligne le Pr. Chevallier mais également aux enquêtes publiques comme l’analyse Mme Touzeau-Mouflard. Nombre de textes internationaux rappellent et garantissent ces droits comme le souligne le Pr. Crouzatier . Malgré cela, la place du citoyen administratif au Parlement pose question note M. Balnath. Le règlement des différends est un aspect du Code que nos contributeurs ne pouvaient pas ignorer. Le Pr. Gourdou et Mme Diemer nous exposent leurs réflexions.
La troisième partie s’intéresse aux applications des règles générales analysées précédemment dans les différents champs de l’action publique. L’application pratique du Code est appréhendée dans une perspective locale par le Pr. Kada et M. Chicot ainsi qu’au regard de l’aménagement du territoire par Mme Boubay-Pagès. La perspective financière et fiscale est présentée par le Pr. Dussart . Cette dimension pratique est également appréhendée au regard des contrats et marchés par le Pr. Kalflèche (Art. 84. Contrats & marchés …) ou encore du secteur culturel par M. Voizard .
Enfin, les apports du droit comparé forment la quatrième partie du dossier : M. Sorokin présente son point de vue depuis la Russie. Mme le Pr. Franch Saguer donne au lecteur l’occasion de découvrir comment la question est traitée en Espagne et en Catalogne ; le Pr. Andry Matilla Correa, par delà les océans, nous présente cette relation administrative depuis Cuba .
Ainsi, de cet ensemble se dégage une analyse manifestement très mitigée. Assurément, la principale qualité de ce nouveau code est d’exister tant un code de ce type était attendu. Le pragmatisme des rédacteurs apparaît de ce point de vue largement justifié. Le CRPA constitue dès lors une étape importante de la relation administrative. Cependant, bien des hésitations se logent dans les commentaires comme les lecteurs le découvriront en parcourant le dossier. Ces dernières sont en premier lieu liées à l’absence d’accessibilité du texte, contrairement à son ambition initiale. Cela est sans nul doute lié à la technicité d’une matière rétive en réalité à la simplification, mais peut être convenait-il de ne pas céder à la rhétorique d’un objectif, par définition, peu atteignable… Une seconde explication paraît se trouver dans la codification opérée principalement à droit constant alors même que la loi d’habilitation ouvrait de larges perspectives de rénovation. Enfin, une troisième explication découle de la difficulté de scinder une loi dite « générale » des règles spéciales de procédure. Le CRPA paraît sur ces trois points en quelque sorte au milieu du gué : trop général par certains aspects, il ne résout pas de façon précise de multiples questions pratiques qui se posent aux administrateurs. Il est par ailleurs à craindre que le contentieux soit nourri quant à la distinction de cette « lex generalis » des textes spéciaux de procédure, ce qui est rarement une heureuse nouvelle pour le justiciable… Pour autant, le JDA souhaite une longue vie au CRPA, tout adressant ses chaleureux remerciements aux auteurs et, surtout, une bonne lecture, à ses abonnés…
Pour le Journal du droit administratif
Pr. Sébastien Saunier
Mmes Florence Crouzatier-Durand
& Delphine Espagno-Abadie
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 02 « Les relations entre le public & l’administration » (dir. Saunier, Crouzatier-Durand & Espagno-Abadie) ; Art. 64.