Art. 304.
Attention ! le présent article n’est qu’un extrait (afin de vous donner envie !) de la contribution complète parue au numéro XXIX de la collection L’Unité du Droit des Editions l’Epitoge.

Professeur de droit public, Université Toulouse 1 Capitole, Imh,
Président du Collectif L’Unité du Droit
Peut-on vraiment envisager un « droit administratif[1] » enseigné à Toulouse avant[2] que ne s’y installe et y prédomine le doyen Hauriou ? L’homme et son génie n’ont-ils pas tant « créé » sinon « façonné » la matière académique « droit administratif » que rien de véritablement important n’existerait auparavant ? On peut être tenté de le penser et il est manifeste qu’il y a un « avant » et un « après » Hauriou dans l’histoire toulousaine et même française de l’enseignement du droit administratif. Pour autant, la « cathédrale » Hauriou reposait, elle-aussi, sur des fondations universitaires que son génie a longtemps eu tendance à éclipser[3]. Ainsi qu’on a d’ailleurs déjà essayé de le démontrer, il y a bien eu une sinon plusieurs générations d’administrativistes (on nous pardonnera le néologisme) avant que n’arrivent au firmament du droit public les Edouard Laferrière, les Léon Duguit et les Maurice Hauriou. N’oublions effectivement pas non seulement que les Républicains universitaires d’après 1880 quand ils enseignaient (de gré ou de force) le droit administratif en avaient tous reçu au moins des premières leçons lors de leurs formations académiques (ce dont leurs prédécesseurs n’avaient pas tous bénéficié) mais encore que ces véritables pères ou grands-pères du droit public avaient parfois eux-aussi proposé des systématisations et théorisations doctrinales[4].
Le droit administratif n’est pas né de façon spontanée. Son enseignement pas davantage même si cela remet en question(s) le panache de déclarations à l’emporte-pièce telles celle de Jèze[5] magnifiant le Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux et sa génération : « Enfin Laferrière vint » !
Pour envisager brièvement cette préhistoire en un siècle (1788-1888) du droit administratif[6] enseigné à Toulouse avant Hauriou (c’est-à-dire avant que ce dernier n’accède comme titulaire à la chaire toulousaine de droit administratif en 1888), on en présentera d’abord quelques éléments généraux[7] chronologiques (I) avant d’exposer une galerie subjective des portraits de ses titulaires (II). Un espace particulier sera par suite réservé aux deux fondateurs du présent Journal du Droit Administratif (Jda) originel : MM. Adolphe Chauveau et Anselme Polycarpe Batbie (III).
I. L’Université de Toulouse désireuse, dès 1789 puis 1829,
d’un enseignement publiciste pour rivaliser avec Paris & Poitiers
Sous l’Ancien Régime (et donc en 1788), il n’existait principalement que des enseignements de droits romain, canon et essentiellement – civil – français ; les seuls enseignements du droit public ayant existé ont été ceux de répétiteurs ou de précepteurs privés et il n’y eut que peu d’enseignement public du droit public ; il s’agissait alors d’une science réservée à l’élite dirigeante : aux « seigneurs » conseillés par des auteurs tels que Domat ou encore De la Mare. A Toulouse, néanmoins, l’Université a connu des prémisses du droit public avant 1789 et ce, au sein de la chaire de « droit français » ainsi que le rappellent nos estimés collègues Espagno-Abadie et Devaux dans l’art. préc. avec par exemples les leçons d’un Antoine de Martres. Avec la Révolution française, la volonté d’enseigner « la Constitution » a certes existé mais elle ne s’est pas vraiment matérialisée. Ces leçons (pourtant prescrites par le décret du 26 septembre 1791[8]) furent rares et esseulées et non généralisées ; tout y dépendait de la volonté des enseignants affectés. A Rennes, ce serait Lanjuinais qui aurait assuré ce cours que Jacquinot offrait à Dijon. A Toulouse, on n’en sait peu. On connaît les titulaires (dont un dénommé Rouzet) mais on ignore le contenu hypothétique de leurs leçons.
A. Avant l’Université impériale : école centrale & Institut Paganel
Avec la suppression des anciennes Facultés de Droit, lors du Directoire, il y eut a priori quelques cours de législation portant sur le droit public (à partir de 1795) dans les nouvelles « Ecoles centrales » mais là encore on ignore si toutes les écoles y dispensèrent un enseignement publiciste. Les archives témoignent plutôt d’une rareté de cet enseignement attesté cependant par exemple à Dijon avec Proudhon et jusqu’à Maastricht (ou la France s’étendait alors).
Ainsi, s’il n’a pas existé de 1793 à l’an XII (1804) d’enseignement universitaire propre au droit, il faut bien faire une place aux écoles centrales[9] des départements créées en l’an III et modifiées dès l’an IV. C’est effectivement, sous le Directoire, la Loi du 07 ventôse an III (25 Février 1795) et celle du 03 brumaire an IV[10] (25 octobre 1795) qui créent et organisent les écoles centrales pour « l’enseignement des sciences, des lettres et des arts ». Il s’agit d’un enseignement encyclopédique[11] dans la plus pure tradition révolutionnaire : on y enseigne ainsi aux élèves, de 12 à 18 ans, les belles-lettres, les mathématiques ou les sciences techniques en ne faisant qu’une bien maigre place aux études de droit. Il n’était alors prévu pour la science juridique, qu’une seule chaire « d’économie politique et de législation », qui, à la suite de la Loi de brumaire an IV, prit le titre unique de cours de législation. Ce texte législatif a d’ailleurs eu pour origine l’un des premiers grands rapports écrits sur l’Instruction Publique supérieure : le mémoire de Daunou[12]. Les écoles centrales y apparaissent comme des établissements généralistes censés dépasser les anciens collèges royaux sans approfondir pour autant aucune matière en particulier. Les élèves y étaient répartis par classes d’âges en trois sections : de 12 à 14 ans, de 14 à 16 ans et à partir de 16 ans. C’est dans la troisième et dernière section qu’entre la grammaire, l’histoire et les belles-lettres, un professeur de législation était mentionné. Au-dessus de ces écoles centrales dont il existait un établissement par département, le titre III de la Loi de brumaire an IV avait prévu douze écoles spéciales dont une était consacrée aux « sciences politiques ».
Concrètement, les cours de législation furent suivis de façons différentes selon les lieux, les étudiants et les enseignants. Aussi une grande part du succès de ces leçons reposa-t-elle, en fait, sur l’aura et le charisme du titulaire de la chaire. On se souvient ainsi de Berriat-Saint-Prix (dans l’Isère), de Proudhon (dans le Doubs), de Lanjuinais (en Ille-et-Vilaine), de Berthelot (dans le Gard), de Cotelle[13] (père) (dans le Loiret), ou d’Henrion de Pansey (en Haute-Marne) mais on oublia, peut-être, des hommes tels qu’Hanf[14] dans le département de la Meuse Inférieure (Maastricht).
A Toulouse, le décret du 17 avril 1795 a également organisé une école centrale dans le département de la Haute-Garonne et l’on doit à Philippe Picot de Lapeyrouse[15] son érection. On sait par ailleurs qu’un dénommé citoyen Bellecour[16] (fils) y fut chargé, malgré son jeune âge (sic) d’un cours de législation spécialement intitulé « droit public – droit constitutionnel ». On en sait toutefois fort peu sur ce qu’il professa concrètement. Rares témoignages de cette période : des affiches et programmes imprimés de cours[17]. On sait en revanche que dans plusieurs documents, Bellecour est dénommé « professeur de droits de l’Homme » (sic).
On retiendra donc, de façon générale, de cet enseignement du droit par les écoles centrales qu’il fut bien trop faible au moins quantitativement. Tous les départements ne furent en effet pas pourvus d’une chaire de législation et rares y furent, comme à Toulouse, les leçons spécialement consacrées au droit public. De plus, les cours, lorsqu’ils avaient lieu n’étaient pas forcément professés par des juristes qualifiés. Enfin, les Universités d’Ancien Régime ayant été supprimées, il n’existait pas d’autre lieu officiel de l’enseignement du droit. C’est pourquoi, un système privé et parallèle d’enseignement supérieur se mit peu à peu en place. Parmi ces établissements privés, on retiendra à Paris l’Académie de Législation et l’Université de Jurisprudence[18].
Dans la ville rose, comme il en fut à Paris à l’Académie de Législation où professa Challan, il exista un Institut privé dit Paganel (car dû aux bons soins du représentant du peuple Pierre Paganel). En son sein, Pierre Laromiguière[19] et le (fils) Bellecour y dispensèrent des cours de droit[20]. Souvent organisés par des praticiens, anciens avocats ou magistrats de l’Ancien Régime, ces cours privés avaient, semble-t-il, davantage de public que les cours officiels des écoles centrales. De surcroît, cet enseignement privé devint encore plus nécessaire lorsque, par la Loi du 11 floréal an X[21], on vota la suppression des écoles centrales. Certes, la Loi de floréal avait bien prévu la création de dix écoles spéciales à l’étude des Lois et constituées de quatre professeurs mais jusqu’en l’an XII aucune de ces Ecoles de droit ne fut concrètement instituée. Aussi, de l’an X à l’an XIV plusieurs académies privées pallièrent-elles ce manque et ce, avec la reconnaissance, officieuse, du gouvernement consulaire. A Toulouse, ainsi et déjà, la ville voulait rivaliser avec Paris et se présentait – en matière juridique au moins – comme la première ville d’importance des départements. On comprend donc pourquoi l’Institut Paganel (même si ce ne fut que très bref) s’y épanouit comme sera revendiquée par suite l’une des premières chaires, après Paris, de droit administratif dans l’Université impériale devenue royale.
Par ailleurs, en l’an XII (13 mars 1804), avec la recréation des Ecoles (qui deviendront Facultés) de Droit, la Loi dite du 22 ventôse va surtout instaurer un enseignement des Codes du droit privé (civil et pénal puis de procédure). Officiellement, on instituera cependant également une étude du « droit public français et [du] droit civil dans ses rapports avec l’administration publique ». Autrement dit, à partir de 1804, l’enseignement du droit public sera formellement reconnu et doublement divisé : non seulement il ne bénéficiera pas d’un enseignement propre (avec des chaires à part entière comme celles du Code civil) et sera seulement le complément de cours privatistes mais en outre on y distinguera – déjà – deux éléments d’étude successifs : le droit constitutionnel (alors qualifié de « public ») et enseigné en deuxième année et le droit administratif (ou « droit civil dans ses rapports avec l’administration publique »), enseigné en troisième année. Ici encore, cependant, la lecture des archives nous démontre qu’a priori peu d’établissements mirent en place durablement ces enseignements « accessoires ». Il y eut vraisemblablement (comme à Paris avec Portiez de l’Oise ou comme à Poitiers avec Gibault et Gennet et encore comme à Rennes avec Legraverend fils) de tels enseignements lors des premières années d’application de la Loi d’an XII. Toutefois, il n’existe que peu de traces de ces enseignements oraux. Mentionnons cependant, à Parme puis à Milan (alors dans l’Empire français), l’exceptionnelle doctrine d’un Gian Domenico Romagnosi qui, sous l’Empire, puis comme Italien fut l’un des premiers pères du droit public européen.
S’agissant du cours toulousain de « droit civil dans ses relations avec l’administration publique » en marge des leçons de la 3e chaire de Code civil, on sait que c’est le professeur (et futur doyen) Jean-Raymond de Bastoulh qui en fut chargé. On sait par ailleurs grâce, aux précieuses recherches préc. d’Olivier Devaux et Delphine Espagno-Abadie, que cette partie administrative du cours de Code civil a, au moins été enseigné, pendant les deux premières années 1806-1807 et 1807-1808 puisqu’en atteste le registre facultaire des délibérations[22]. Surtout, on doit à l’extraordinaire travail de Jean-François Babouin qui a réussi à retrouver, par quatre cahiers jusqu’ici anonymes et formant 264 pages manuscrites, ledit cours de 1807. On doit à notre collègue d’avoir ainsi exhumé, démontré la paternité et analysé[23] ces premières leçons administrativistes toulousaines du civiliste de Bastoulh.
Cela dit, il semblerait que – rapidement – les deux premiers enseignements publicistes officiels de l’Université (droit constitutionnel et droit administratif) pourtant obligatoires soient rapidement tombés en désuétude et ce, y compris à Toulouse !
Comment alors que le programme était totalement nouveau (le Code Napoleon) et titanesque pouvaient-ils et préparer et enseigner leur cours de Code et celui ou ceux de droit public et administratif ? Il y avait beaucoup trop à faire. Ensuite, la plupart des enseignants sans aller jusqu’à affirmer qu’ils étaient incompétents répugnaient à enseigner une matière publiciste qui leur était totalement étrangère et pour laquelle ils n’avaient pas forcément envie de s’investir. Ainsi faute de temps, de moyens certainement, d’envie de ces professeurs tous privatistes d’enseigner une matière inconnue et faute de pression et d’encouragements de la part de l’administration universitaire, les cours de droit public et administratif furent-ils rapidement laissés à l’abandon. Peut-être même qu’avait ressurgi l’argument qui, jadis, avait empêché tout enseignement publiciste : c’est-à-dire la mention du caractère trop politique, subjectif voire séditieux de ces leçons.
B. La création d’une chaire publiciste ultra (1829-1830)
A l’exception donc de quelques leçons publicistes délivrées en fin d’année par les titulaires des premières chaires de Code civil, il n’exista pas en France d’enseignement proprement publiciste lors des premiers temps de l’Université impériale. Seule la Faculté de droit de Paris réussit l’exploit, en 1819, d’obtenir la création d’un enseignement du droit public et administratif avec les leçons du Baron de Gérando. Toutefois, au bout de six mois, le cours sera purement et simplement supprimé (ici encore sûrement pour des motifs politiques tenant aux caractères dits dangereux ou séditieux selon d’aucuns dudit cours). Il faudra ensuite attendre 1829 pour que ce cours soit à nouveau programmé à Paris.
L’apprenant, les deux Facultés de province de Poitiers et de Toulouse, réclamèrent ce même enseignement désormais administrativiste et non (comme en 1819) de droit public et administratif. Ainsi, c’est effectivement dès 1829, alors que l’on venait de rétablir l’enseignement parisien, que l’Université de Toulouse réclama de « tenir son rang » puisqu’en nombre d’étudiants[24], elle apparaissait comme la deuxième Ecole de droit du Royaume. Or, à la tête du ministère des affaires ecclésiastiques et de l’Instruction Publique[25] siégeait, depuis le 08 août, le baron Isidore de Montbel qui avait récemment été élu maire … puis député ultra de la ville de Toulouse[26].
Bien que le mandat de ce dernier se comptât en jours, il eut le temps, à peine arrivé, d’obtenir, pour sa ville, la création d’une chaire de droit administratif demandée avec insistance par le doyen (Jean-Raymond) de Bastoulh pour essentiellement deux raisons : d’abord obtenir, pour son Ecole, le même enseignement que celui dispensé à Paris et, de façon plus personnelle, afin d’occuper son fils, « Carloman de Bastoulh, professeur suppléant sans emploi » (sic) dans le même établissement. Les archives nationales témoignent[27] ainsi des véritables raisons qui ont poussé la Faculté de droit de Toulouse à demander puis obtenir une chaire de droit administratif : il ne s’agissait malheureusement pas d’agir au nom d’un objectif scientifique de promotion du droit public ! Quelques mois auparavant, toutefois, c’est un objectif similaire qui avait été invoqué en premier devant le ministre de l’époque, le Comte de Vatimesnil. Le doyen de Bastoulh[28], effectivement, avait alors mis en avant le constat suivant[29] : « une chaire de droit administratif serait absolument nécessaire pour l’instruction des nombreux élèves qui fréquentent nos cours ; plusieurs d’entre eux se destinant à parcourir la carrière administrative ». C’est alors une ordonnance en date du 27 septembre 1829[30] qui va concrétiser cette requête toulousaine. Il s’agira, ici comme à Caen en 1830, d’une norme créant une chaire « jumelle » ou « copie » de la chaire parisienne. En effet, dans les deux cas, le texte renverra expressément aux dispositions de l’ordonnance parisienne du 19 juin 1828 au profit de de Gérando. C’est par la suite le 13 octobre 1829 que Carloman de Bastoulh sera officiellement nommé à la tête de ce nouvel enseignement publiciste qu’il n’assura manifestement que peu[31] (et qui plus est accompagné d’un suppléant). En effet, après avoir commencé à donner ses premières leçons au début de l’année 1829-1830, il n’eut pas le temps de les pérenniser puisque, comme son doyen de père, il refusa – comme son suppléant un dénommé (Jean-Marie-Etienne) Armand (ou Arnaud parfois) Laburthe – après juillet 1830, à la rentrée d’automne, de prêter serment aux gouvernants orléanistes.
Toutefois, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le nouveau gouvernement ne supprima pas directement le cours publiciste mais uniquement celui qui l’avait professé. En effet, prenant acte de l’absence de titulaire à la tête de la chaire de droit administratif, l’ordonnance du 25 novembre 1830[32] y substitua une nouvelle « chaire de droit public français ». Il fallait donc lui trouver un nouveau titulaire. Pour ce faire on demanda au professeur de Code civil, le libéral Malpel, alors nommé recteur de l’académie, de pourvoir aux postes absents. Ce dernier réussit alors à placer[33] à la tête de la nouvelle chaire de droit public « un des ténors du Barreau toulousain : Jean-Baptiste[34] Romiguiere ». « Fils d’un avocat au Parlement, Romiguiere avait été en 1789 un des dirigeants du mouvement révolutionnaire, avant de prendre parti contre les terroristes et d’être déporté lors du 18 fructidor. Avocat depuis 1805 il fut à la barre de tous les grands procès qui défrayèrent la chronique judiciaire sous la Restauration ». Romiguière, qui avait été l’un des chefs du parti libéral[35] à Toulouse, fut installé dans ses fonctions le 01 décembre 1830 mais « comme l’écrit dans ses Mémoires, Charles de Remusat, il s’était fait nommer à la Faculté de droit pour augmenter sa réputation[36], mais n’a jamais enseigné de crainte de la diminuer » ! Wolowsky offrira un témoignage similaire en déclarant[37] que « fut créée, pour M. Romiguiere, une chaire de droit public français à laquelle M. Romiguiere renonça peu de jours après avoir été installé, et sans qu’il eût encore professé ». On peut donc conclure avec Lame-Fleury[38] que la chaire de droit public toulousaine créée en 1830 « n’eut qu’une existence purement nominale ». En outre, cette chaire de droit public français ne se verra, par la suite, jamais attribuer de titulaire et il faudra attendre la fin de l’année 1837.
C. La confirmation d’une chaire pérenne et libérale de droit administratif
(à partir de 1838)
Même lorsqu’en décembre 1837, Salvandy créa une chaire spéciale de droit administratif (qu’il offrit à son ami Chauveau, alors avocat à Paris), la chaire vide et précédente de droit public français était encore théoriquement vacante. C’est pourquoi, en 1845[39] alors, la Faculté de droit toulousaine demanda officiellement à ce que l’on supprimât cet enseignement jugé inutile si, comme elle l’espérait, on pouvait en échange lui offrir une chaire d’histoire du droit. Il est donc important de garder en mémoire qu’entre 1830 et 1837 il n’y eut, à Toulouse, aucun enseignement publiciste (ni en droit administratif, ni en droit public français (constitutionnel)). En effet, ainsi que l’a constaté Dauvillier[40], la Faculté de droit était désormais « suspecte d’attachement au légitimisme » ; elle fut en conséquence « traitée avec malveillance alors qu’elle réclamait (…) chaque année » (et ce, jusqu’en 1845) le rétablissement de sa chaire supprimée. Nommé ministre de l’Instruction Publique le 15 avril 1837, Salvandy rédigea, dès le 12 décembre suivant[41], un rapport partant des constats suivants : d’abord il reconnaissait l’utilité scientifique de l’enseignement du droit administratif car celui-ci « se lie à l’exercice de tous les droits, à l’étude de tous les pouvoirs qui sont la base de notre Constitution » puis il remarquait que sur neuf Ecoles de droit, cinq[42], encore, n’en étaient pas pourvues ce qui était fort préjudiciable : « l’absence de cet enseignement place dans un état d’infériorité que rien ne justifie cinq de nos écoles ». C’est alors, pour la première fois, un désir (certes d’inspiration libérale) réellement scientifique qui va motiver, la rédaction de la première ordonnance générale (et non spéciale) à l’enseignement, en France, du droit administratif. Dès la fin de l’année 1837, les Universités de Strasbourg et de Dijon franchirent ce pas. Elles furent ensuite suivies par Grenoble et Rennes et enfin seulement par Toulouse. C’est ainsi que Salvandy, dans le rapport précédant son ordonnance du 12 décembre 1837, constata qu’à Toulouse, « l’ordonnance du 25 novembre 1830 y avait érigé une chaire de droit public français, qui est demeurée jusqu’à présent inoccupée et qui ne se retrouve pas dans la plupart des autres Facultés ». En conséquence, il fallait recréer une chaire à la tête de laquelle on appela, le 25 mars suivant[43], Adolphe Chauveau[44], nouveau titulaire de la « chaire restaurée de Droit administratif ». Toutefois, l’arrivée de Chauveau (qui n’était ni docteur en Droit ni Toulousain) ne plut pas du tout aux titulaires de la Faculté de Droit qui lui réservèrent un accueil si froid qu’il le leur rendit bien ! Les professeurs suppléants ne l’appréciaient – du moins au début – pas davantage puisqu’en nommant Chauveau, l’avocat parisien et ami du ministre, Salvandy avait certes sélectionné un juriste ayant déjà publié et réfléchi au droit administratif mais ce dernier venait flétrir les prétentions des professeurs suppléants déjà implantés à Toulouse et désireux d’obtenir une chaire d’enseignement[45].
Chauveau, aidé un temps (puisque de santé fragile) notamment des professeurs suppléants Batbie et Rozy (on y reviendra infra ainsi que d’autres « intermittents ») régna alors sur le droit administratif toulousain et s’y investit jusqu’à son décès en 1868. Il sera par suite remplacé par Henri Rozy qui occupa les lieux, vraisemblablement sans véritable goût pour la matière, de 1868 à 1882 avant qu’Henri Wallon ne prenne sa place jusqu’en 1888. Avant Hauriou, « la » figure tutélaire du droit administratif à Toulouse a donc été celle d’Adolphe Chauveau.
II. Portraits des premiers administrativistes académiques toulousains
Rencontrons maintenant de plus près ces premiers administrativistes occitans dont on a déjà perçu que pour la plupart d’entre eux (sinon tous) ils avaient accepté (comme Hauriou du reste) de donner des leçons de droit administratif davantage par obligation statutaire (notamment quand ils étaient les derniers « arrivés » ou « recrutés » dans l’ordre hiérarchique du Tableau) que par désir véritable d’approfondir et de diffuser l’enseignement publiciste. Il faut dire que tous, précisément, étaient privatistes et avaient été formés au seul droit privé. On comprend que la « montagne » publiciste les ait effrayés.
A. La dynastie civiliste des de Bastoulh aidée d’un de Laburthe
Le premier nom qui s’impose à nous est celui des de Bastoulh[46] et ce, pour deux raisons. D’abord au nom du père (Jean-Raymond (1751[47]-1838)) et ensuite au nom du fils (Carloman (1797-1871)). Rappelons en effet que le père (qui devint doyen de l’établissement d’août 1821 au 29 septembre 1829) fut l’un des premiers titulaires de la chaire de Code civil III dans laquelle a priori devait être enseigné le droit administratif ou a minima ses linéaments. On ne sait en revanche si – concrètement – le civiliste accepta de s’y adonner plus qu’une année ou deux ! On sait par ailleurs que le futur doyen de Bastoulh avait été avocat au Parlement de Toulouse sous l’ancien régime (vers 1775) et qu’il accéda le 22 mars 1805 comme titulaire de la 3e chaire de Code Napoléon. On devine enfin qu’il fut légitimiste puisque, comme son fils (ou plutôt l’inverse) il démissionna de ses fonctions (y compris décanales) le 29 septembre 1830.
Quant au fils : né le 06 janvier 1797, (Antoine-Hyacinthe) Carloman de Bastoulh était donc l’héritier d’une dynastie occitane. C’est dans sa ville natale, à Toulouse, que Carloman avait obtenu ses grades (du baccalauréat au doctorat[48]) en droit puis qu’il s’était inscrit au Barreau dès 1816. Toutefois, ambitionnant à son égard une carrière d’envergure nationale, son père, dès sa nomination[49] comme doyen de la Faculté de droit, le confia, en novembre 1821, à son ami Isidore de Montbel pour qu’il apprenne auprès du Barreau parisien. Carloman n’y resta toutefois qu’une année puisque, le 09 octobre 1822, il réussit à intégrer l’établissement paternel en qualité de professeur suppléant. Selon Dauvillier[50], c’est dès cette époque qu’il aurait commencé à enseigner le droit administratif. Nous réfutons néanmoins cette thèse puisque les archives nationales[51] nous apprennent que cet enseignant aurait d’abord professé le Code civil puis, à partir de 1828, le cours de droit commercial. En octobre 1829, c’est encore de Montbel qui va permettre à Carloman d’obtenir sa titularisation en tant que professeur de droit administratif. Cette dernière est manifestement d’inspiration politique, amicale, et non scientifique ; le ministre déclarant expressément au doyen et paternel de Bastoulh[52] qu’il désirait lui « donner une preuve de son estime particulière ». En outre, entre la date de création de la chaire et l’annonce de la nomination de son titulaire, Carloman écrivit directement au toulousain de Montbel, soutenu en ce sens par le député Roquette, et n’hésita pas à confier au ministre que puisqu’il s’attendait à être nommé il avait déjà commencé à préparer un (son) cours de droit administratif[53] : « Mes espérances se sont accrues et mon travail a redoublé, afin de justifier la confiance et la faveur que je viens solliciter de votre excellence, si vous me jugez digne de remplir ces fonctions, j’aurai l’honneur de soumettre à votre excellence la partie de mon cours dont je me suis déjà sérieusement occupée ».
Carloman de Bastoulh ne sera néanmoins pas seul pour assurer ce cours si vaste et nouveau. Effectivement, les archives universitaires placent à côté de son nom celui d’un suppléant provisoire nommé Arnaud de Laburthe[54] dont on ne connaît, aujourd’hui, quasiment que le patronyme[55] ! D’ailleurs, nous ne disposons pas davantage de renseignements sur le contenu du cours projeté et enseigné quelques semaines par de Bastoulh à Toulouse, en droit administratif. Il semble, en effet, qu’il n’en existe aujourd’hui aucune trace écrite. Ce qui, en revanche, est certain c’est que les leçons furent impossibles après juillet 1830. En effet, « fervents légitimistes[56] », les (de) Bastoulh, seigneurs de Nogaret, étaient allés jusqu’à reprendre, sous la Restauration, « la particule abandonnée depuis la Révolution ». Malheureusement ce caractère légitimiste vaudra au père comme au fils[57] « d’être destitués par Louis-Philippe en 1830 » (comme les romanistes Ruffat et Flottes) et ce, comme évoqué supra, pour avoir refusé de prêter le serment de fidélité à la nouvelle Monarchie. A partir du 25 novembre 1830[58], en conséquence, les leçons de droit administratif furent-elles abandonnées puisque sans professeur. Il y eut ainsi, pour cette année universitaire 1830/1831, de nombreux cours à être supprimés puisque, à Toulouse ainsi que le souligne Puzzo[59], plus de la moitié des enseignants préférèrent démissionner « plutôt que de renier leur serment de fidélité à Charles X ». De fait, commente Wolowsky[60] : « en 1830, MM. de Bastoulh, doyen, Bastoulh fils, Ruffat et Flottes, refusèrent de prêter serment. On déclara alors supprimées les chaires de MM. de Bastoulh fils et Flottes[61], et les chaires de MM. de Bastoulh père et Ruffat furent seules mises au concours ».
B. Couraud, Rozy & Cassin : les intermittents du droit administratif
Au théâtre et à l’opéra comme sur la scène académique, il y a les titulaires mais aussi les remplaçants ou encore les doublures qui entrent en mouvement (simplement comme lecteurs de cahiers de titulaires généralement). En droit administratif il en fut de même et l’on a pu ainsi retrouver la plupart des noms des professeurs (officiels et pérennes ou simplement de quelques semaines) rattachés à la chaire toulousaine de droit administratif entre 1806 et 1888. La présente liste se veut la plus exhaustive possible même s’il est possible que d’autres noms de suppléants nous aient échappés[62] :
- de Bastoulh J-R. : 1806 à 1808 a priori lors des leçons de Code civil (III) ;
- de Bastoulh C. : nommé professeur de droit administratif en 1829, démissionnaire en 1830 ;
- de Laburthe A. : professeur suppléant de droit administratif (1829-1830) ; démissionnaire en 1830 ;
- Romiguières J-B. : professeur de droit public français, 1830, chaire non occupée ;
- Chauveau A. : professeur titulaire de la chaire de droit administratif (1838-1868) ;
- Dufour[63] F. C. : professeur suppléant de droit administratif (1831-1841) ;
- Batbie Anselme-Polycarpe : professeur suppléant de droit administratif (1852-1857) ;
- Couraud[64] P-A-A. : professeur suppléant de droit administratif (1855 puis peut-être pour quelques jours en 1858) ;
- Rozy[65] H-A. : professeur suppléant (à partir de 1855) puis titulaire (à partir de 1868) de droit administratif (jusqu’en 1882) ;
- Cassin[66] A-L-M. : professeur suppléant de droit administratif (1862-1864) ;
- Wallon M-V-E. : professeur de droit administratif (1885-1888).
Des investigations sur Couraud & Rozy mériteraient notamment à nos yeux d’être entreprises car le passage de Couraud à Toulouse le prédétermina manifestement à embrasser le droit administratif lorsqu’il gagna par suite les Facultés de Grenoble puis de Bordeaux. Quant à Rozy, nos premières recherches le décrivent comme un être exceptionnel et l’on aimerait ainsi en savoir davantage. Si l’on fait le compte, depuis 1806 et jusqu’en 1888 il y eut ainsi – sauf erreur ou omission – onze professeurs de droit administratif avant Hauriou dont cinq (et en fait quatre) titulaires véritables : de Bastoulh, Romiguières, Chauveau, Rozy et Wallon. A ces onze professeurs universitaires, on croit devoir ajouter les patronymes précités des enseignants administrativistes antérieurs à l’Université : Antoine de Martres (sous l’Ancien Régime), Bellecour (à l’école centrale) et Pierre Laromiguière et l’abbé Bores (à l’Institut Paganel retrouvant Bellecour) ce qui porte à quinze la liste des administrativistes avant Hauriou mais évoquons plutôt le dernier titulaire de ces quinze joueurs de l’équipe toulousaine, précisément également rugbyman.
C. Un gentleman rugbyman (et privatiste) : (Marie-Victor) Ernest Wallon[67]
Lorsque l’on cherche des renseignements sur le juriste Wallon, on est rapidement déçu car ce sont surtout les ouvrages relatifs au rugby qui l’évoquent. Même le pourtant excellent (et en partie toulousain) Dictionnaire historique des juristes français (Paris, Puf, 2nde éd., 2015) ne le mentionne pas et la plupart des ouvrages consacrés au Droit – sauf ceux spécialisés sur l’histoire de l’enseignement juridique en Occitanie– l’ignorent totalement comme s’il n’avait pas existé. Il faut dire qu’un élément plaide à la décharge du professeur pour que sa mémoire spirituelle ou doctrinale soit entretenue : il a très peu publié d’ouvrages et seuls quelques articles nous sont parvenus. Aucun manuel, aucun traité : seul témoignage conséquent de sa doctrine : la publication de sa thèse de doctorat soutenue en 1876 à l’Université de Toulouse (au sein de laquelle il a conquis tous ses grades[68]). Consacrée à la dot mobilière, sur le modèle classique pour l’époque, de deux dissertations successives en droit romain (près de 150 pages) et en droit civil (dit français) (près de 200 pages), la thèse[69] de Wallon fut publiée en 1877. Dès son doctorat, l’homme assumait ses opinions doctrinales et ne se contentait pas d’une exégèse insipide. Il affirmait, proposait, démontrait. Ce sont ces qualités qui dépassent celles du juriste expert qui vont le conduire au professorat. Malheureusement, sa première tentative (en 1877) de participation au concours d’agrégation sera vaine et il ne sera intégré à la Faculté de Toulouse – qui le soutenait[70]– d’abord que comme « délégué dans les fonctions d’agrégé » et ce, à la suite d’un arrêté ministériel du 1er août 1878 obtenu du ministre (et avocat) Agénor Bardoux. A la suite de son succès au concours de 1879, où il fut classé (le 14 juillet 1879) dernier des dix lauréats, Wallon sera institué comme agrégé « près les Facultés de Droit » (arrêté de Jules Ferry en date du 25 juillet 1879) et affecté, dès le 8 août 1879, à l’Ecole toulousaine. On dispose à cet égard des deux dissertations qu’a soutenues Ernest Wallon lors de ce second concours devant le jury les 16 avril et 30 mai 1879 mais elles apportent peu à la compréhension de sa doctrine et sont davantage des témoignages de son aisance à traiter de tout sujet imposé en droit (en l’occurrence par exemple à propos des aliénés[71]). A bien y regarder, cela dit, cette dernière dissertation (qui traitait des conséquences d’actes administratifs de placements) augurait des cours que l’on allait bientôt offrir, malgré lui, au jeune agrégé. Et, si Wallon enseigna d’abord à Toulouse le droit des gens (pendant l’année 1880[72]-1881) puis le droit international privé[73] (pendant deux années dès la rentrée 1881), c’est à l’enseignement du droit administratif que la Faculté voulut l’affecter à la suite du décès d’Henri Rozy (1829-1882).
Concrètement, Wallon assuma par obligation issue de l’arrêté ministériel en date du 30 octobre 1882 et non par choix cette mission qui ne devait être que temporaire. Pourtant, comme aucun titulaire ne désirait le cours de droit administratif, un décret du Président de la République Fallieres, contresigné par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Jules Grevy, daté du 9 février 1885 vint pérenniser le temporaire et consacrer « M. Wallon, agrégé des Facultés de Droit »comme « professeur de droit administratif à la Faculté de Droit de Toulouse ». Jusqu’en 1887, Wallon dut donc assumer cette charge et il publia, à la Revue critique ainsi que dans l’année judiciaire[74] notamment, de nombreuses notes de jurisprudence administrative qui font état de son investissement réel dans la matière qu’il disait pourtant subir. Les notices individuelles de son dossier personnel aux Archives Nationales (A.N.) nous permettent d’avoir un aperçu de cet enseignement à propos duquel le doyen ne tarissait pas d’éloges. En 1884, Henry Bonfils (1835-1897) relevait ainsi que Wallon faisait part d’un « esprit sage et élevé, doué d’un grand sens pratique et ayant la perception nette de ce que commande notre organisation sociale et politique ». L’année suivante, il ajoutait qu’Ernest était « un fonctionnaire attaché à ses devoirs. Chargé d’un cours important depuis quelques années, nommé récemment professeur dans la chaire qu’il occupait, il s’efforce de perfectionner tous les jours son enseignement. Il sait exposer avec fermeté et avec tact des théories délicates et se montre [d’un] esprit libéral. Il s’intéresse aux questions universitaires ». Pourtant, assurait en 1886 le même doyen, le cours de droit administratif était des plus « difficiles » pour conclure, en 1887, que le professeur Wallon s’en sortait particulièrement bien car il avait refusé (comme dans sa thèse a-t-on vu supra) de s’engoncer dans des théories évanescentes pour être au plus près des questions concrètes : « Très attaché à ses fonctions, M. Wallon prépare ses cours avec un soin particulier. Sans négliger la partie théorique, il sait se pénétrer des nécessités de la pratique et imprime à son enseignement un cachet particulier. La jurisprudence est soigneusement relevée et rapprochée de la doctrine. L’élocution est correcte, mais manque de souplesse et de chaleur ».
« Enfin Wallon, ça n’est pas un ballon » ! C’est par ces mots, romancés et prononcés fictivement par Maurice Hauriou (1856-1929) dans la pièce de théâtre que nous lui avons consacrée en 2018[75], que nous avons essayé de décrire la « passation » du cours de droit administratif entre Wallon (qui désirait s’en débarrasser même si la matière avait fait de lui un titulaire) et Hauriou, jeune agrégé toulousain. Les archives font état de ce que la demande de Wallon était approuvée et soutenue non seulement par le doyen Bonfils mais aussi par le recteur Charles Perroud (1839-1919) qui estimait qu’il valait mieux qu’un titulaire reprenne la chaire « noble » de Code civil (utile à tous les juristes) quand un « simple agrégé » comme Hauriou pouvait (comme l’avait fait avant lui Wallon) se charger du cours de droit administratif (manifestement moins important à leurs yeux). Rappelons-nous, à cet égard[76] qu’avant 1900 au moins (et sûrement même après si l’on en croit, à Toulouse toujours, les propos tenus par certains collègues contemporains), le droit administratif avait bien mauvaise presse et était considéré par d’aucuns comme un « sous » droit.
Plusieurs archives témoignent ainsi, avons-nous écrit par ailleurs, du véritable rejet (d’aucuns parlaient même de dégoût) développé par quelques-uns des premiers (et non des moindres) professeurs de droit administratif lorsqu’on leur a demandé d’enseigner cette matière qui leur était souvent inconnue (surtout avant 1850) et leur paraissait conséquemment inintéressante et rébarbative. Chauveau (précisément à Toulouse, avant Wallon et Hauriou[77]), Gougeon ((1797-1882) à Rennes), Baril-leau ((1855-1925) Poitiers), Vuatrin ((1811-1893) à Paris), Giraud ((1802-1881) à Aix) ne se destinaient ainsi originellement pas au droit administratif. De fait, rares sont ceux qui, comme Trolley ((1808-1869) à Caen) ou Foucart ((1799-1860) à Poitiers), semblent s’être eux-mêmes voués et dévoués au droit administratif – par choix – au lieu de l’avoir vécu comme une contrainte d’enseignement. On se souviendra alors de la répugnance avouée par Gougeon à l’idée d’enseigner cette matière[78], à l’aversion décrite par le biographe de Barilleau concernant ses premières années de professorat[79] ou encore aux multiples courriers de Chauveau et de Giraud au ministre de l’Instruction Publique et dans lesquels ils expliquaient leur volonté de rapidement enseigner une autre matière que celle qui leur avait été « imposée[80] ». Quoi qu’il en soit, Wallon fit donc bien partie de cette liste exceptionnelle des premiers titulaires Toulousains de la chaire de droit administratif et ce, à la suite d’Adolphe Chauveau (de 1838 à 1868) et d’Henri Rozy (de 1868 à 1882) et ce, juste avant Hauriou (de 1888 à 1920). « On vient, on gagne et on s’en va » chantent les supporters du Stade Toulousain… Wallon fit de même en droit administratif.
C’est toutefois en 1887 qu’Ernest Wallon put réaliser son rêve académique : être titulaire de la première chaire de Code civil à la suite de l’admission à la retraite du professeur Gustave Bressolles (1816-1892). Un arrêté du 19 décembre 1887, signé par Sadi Carnot (1887-1894) consacrera cette demande après avis du Conseil de Faculté (en date du 3 novembre 1887) et du Conseil supérieur de l’Instruction Publique (en date du 16 décembre 1887). Comme dans les sports collectifs contemporains (au football mais aussi au rugby), on assista donc en 1887 à un mercato officialisant le transfert de chaire de Wallon vers son « club d’origine » : le droit privé. Le conseil de Faculté toulousain signale à ce propos qu’il a « donné à l’unanimité un avis favorable à cette demande de transfert (sic) de Wallon ». Siégeaient à cette importante réunion (outre le doyen Bonfils et Wallon qui partit pendant l’examen de cette question), les professeurs Deloume (1836-1911), Paget (1837-1908) et Campistron (1848-1917) ce qui nous permet d’imaginer que les conseils de Faculté ne passionnaient déjà pas les foules (eu égard au nombre restreint de participants !). Le terme de « transfert » fut donc ici institutionnalisé et l’on sait, grâce à la lettre du 30 septembre 1887 (conservée aux Archives Nationales au dossier préc.) que c’est Wallon lui-même qui l’employa : « Ayant toujours eu une préférence marquée pour l’enseignement du droit civil, j’ai l’honneur de vous adresser ma demande de transfert (sic) de la chaire de droit administratif dans celle de Code civil ».
Le reste de la carrière de Wallon à Toulouse (au terme de 35 années et 6 mois de services) est assez classique : il fut promu à l’ancienneté à la 3e classe (1894) puis à la 2e classe (1911) des professeurs. Il participa comme membre du jury à un concours d’agrégation (celui de 1908) et fut enfin admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1914 mais ce, à la suite de trois années de congés pour raison de santé[81]. Cette dernière était en effet fragile ainsi que les notices le concernant aux archives en donnent plusieurs témoignages (par exemple en 1895, 1898 ou en 1901). L’intéressé écrivait même au ministre le 22 janvier 1914 : « ma santé étant de plus en plus ébranlée, j’ai perdu tout espoir de reprendre mon enseignement ». Quoi qu’il en soit, sa retraite sera liquidée par décret du 3 mars 1914, date à partir de laquelle on prononcera son honorariat. Entre 1887 et 1912 (et à quelques rares exceptions), ses renseignements confidentiels sont quasi identiques et tous élogieux[82], le doyen Hauriou résumant en 1912 qu’il n’avait « que des éloges » à faire et à adresser à Wallon et ce, « à tous points de vue ».
A Toulouse, enfin, évoquer Wallon suscite des regards enthousiastes de sportifs (et non de juristes) se remémorant un palmarès d’exception. Associé, comme premier Président du Stade Toulousain au nom même du rugby français, Wallon est finalement plus connu comme sportif que comme juriste. Il a popularisé les couleurs « rouge & noire » du célèbre maillot et a souvent été décrit comme un entrepreneur sans pareil (ce que nous avons développé aux Mélanges Mestre préc.).
Cela dit, s’agissant du droit administratif à Toulouse, ce n’est pas Wallon mais son successeur, Hauriou, qui va… « transformer l’essai » !
(….)
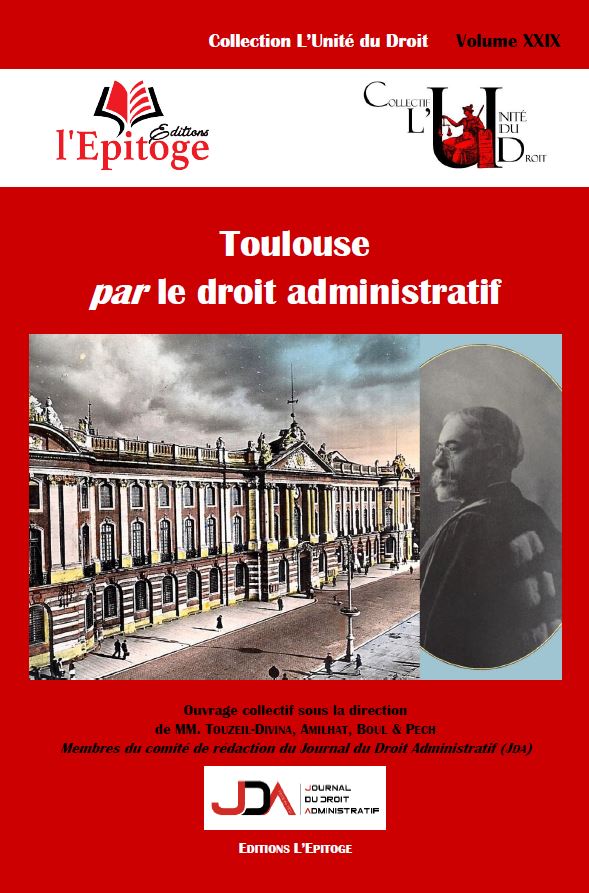
La 3ème partie de ce texte est à retrouver dans l’ouvrage présenté ci-dessus !
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2020 ;
Dossier VII, Toulouse par le Droit administratif ; Art. 304.
[1] Sur l’expression même, il faut lire le récent article de Gilbert Simon, « Enquête sur la reconnaissance formelle du droit administratif avant 1789 et sur l’identification doctrinale de son caractère « civil » et « mixte » sous le Consulat et le Premier Empire » aux Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre ; Toulouse, L’Epitoge ; 2020 ; Tome II ; p. 107 et s.
[2] Les présents propos complètent le seul et premier article paru, selon nos sources, sur cette question : Espagno-Abadie Delphine & Devaux Olivier, « Avant Maurice Hauriou : l’enseignement du droit public à Toulouse du XVIIe au XIXe siècle » in Histoire de l’enseignement du Droit à Toulouse ; Toulouse, Pusst ; collection du Cthdip n°11 ; 2007 ; p. 327 et s.
[3] Et qu’il a lui-même cherché à éclipser ainsi qu’on croit l’avoir démontré in Touzeil-Divina Mathieu, « Maurice Hauriou, mystificateur ou Héros mythifié ? » in Miscellanées Maurice Hauriou ; Le Mans, L’Epitoge ; 2013 ; p. 83 et s.
[4] Ce que nous avons voulu détailler in Touzeil-Divina Mathieu, La doctrine publiciste 1800-1880 ; éléments de patristique administrative ; Paris, La Mémoire du Droit ; 2009.
[5] Jèze Gaston, Principes généraux du droit administratif ; Paris, Giard ; 1914, Tome I, p. VII.
[6] La plupart des éléments exposés ci-après sont issus de précédents travaux (notamment de doctorat) desquels sont tirées les principales recherches. On renverra donc, pour plus de précisions éventuelles, à : Touzeil-Divina Mathieu, Eléments d’histoire de l’enseignement du droit public (…) ; Poitiers, Lgdj ; 2007 ; Eléments de patristique administrative (…) ; Paris, La Mémoire du Droit ; 2009 et Un père du droit administratif moderne, le doyen Foucart (1799-1860), éléments d’histoire du droit administratif ; Paris, Lgdj ; 2020.
[7] On lira également en ce sens le récent chapitre premier (rédigé par Olivier Devaux) de Barrera Caroline (dir.), Histoire de l’Université de Toulouse ; Toulouse, Midi-Pyrénées ; 2020 ; Volume III ; p. 11 et s.
[8] « A compter du mois d’octobre prochain, les Facultés de droit seront tenues de charger un de leurs membres, professeur dans les universités, d’enseigner aux jeunes étudiants la Constitution française ».
[9] Sur ces établissements, on lira le numéro spécial de la Rhfd) ; 1986 (n°3) avec les contributions de MM. Imbert, Halperin & Bouineau.
[10] Décret du 07 ventôse an III in Duvergier Jean-Baptiste, Collection complète des Lois, décrets … ; Paris, 1835 ; Tome VIII, p. 29 et Loi du 03 brumaire an IV (25 octobre 1795) sur l’organisation de l’Instruction Publique in Recueil de Beauchamp ; TI, p. 36.
[11] A contrario voyez l’opinion développée par Trenard Louis, « L’enseignement secondaire sous la Monarchie de Juillet : les réformes de Salvandy » in Revue d’histoire moderne et contemporaine ; 1965, Tome XII, p. 84 qui estime que dès l’instauration des écoles centrales, l’idéal culturel et révolutionnaire encyclopédique est nié au profit de la seule utilité professionnelle.
[12] Deux rapports tout aussi prestigieux l’avaient néanmoins précédé : ceux de Condorcet et Talleyrand. Voyez ainsi le rapport du 27 vendémiaire an IV (09 octobre 1795) de Daunou sur l’organisation de l’Instruction Publique in Recueil de Beauchamp ; TI, p. 861.
[13] Il ne s’agit pas d’Ange-Toussaint Cotelle (le fils) mais de Louis-Barnabé-Joseph Cotelle (le père) qui sera également enseignant à la Faculté de droit de Paris sous l’Empire alors que son fils connaîtra une carrière en tant qu’enseignant à l’Ecole des Ponts et Chaussées.
[14] On désespère de ne quasiment rien trouver sur cet auteur.
[15] A son égard : Lamouzele Edmond, « Contribution à l’Histoire de l’instruction publique à Toulouse sous la Révolution » in Annales du Midi ; 1932 ; n°44-175 ; p. 332 et s.
[16] Dont on peut encore lire un très beau mémoire issu de ses travaux (sans date !) au sein de la Société des Jacobins de Toulouse : Rapport sur le mode d’admission fait au nom du comité de surveillance de la Société populaire de Toulouse dans la séance du 2 messidor, par Bellecour fils.
[17] Aux Archives de la Haute-Garonne : L2550 à 2553 et aux archives municipales (5S74 notamment) ; citées par Devaux préc.
[18] Sur ces établissements et sur la période consulaire, en général, il faut lire l’essai (classique mais fleuve) de Hayem Henri, « La renaissance des études juridiques en France sous le Consulat » in Rhdfe ; Paris, 1905, p. 96-122, 213-260 et 378-412. Voyez également les documents publiés par Bienvenu Jean-Jacques, « Quelques aspects de la doctrine juridique à l’Académie de législation » in Rhfd ; Paris ; 1989 n° 9 ; p. 45 ainsi que Thuillier Guy, « Aux origines de l’Ecole libre des sciences politiques : l’Académie de législation en 1801-1805 » in La Revue Administrative ; Paris ; 1985, p. 23.
[19] Né le 03 novembre 1756 et qui sera remplacé (selon Espagno-Abadie & Devaux) par un dénommé abbé Simon Borès.
[20] Cf. Devaux Olivier, « L’institut Paganel et la difficile survie de l’enseignement du droit à Toulouse en 1794 » in Rhfd ; Paris ; 1987 n°5 ; p. 23.
[21] Loi du 11 floréal an X (01 mai 1802) in Recueil Follevile ; p. 6.
[22] Séance du 08 juin 1807 citée par nos collègues (archives universitaires toulousaines 2 Z 2-2).
[23] Babouin Jean-François, « Enseigner le droit administratif sous l’Empire : le cours d’administration de Jean-Raymond-Marc de Bastoulh » in Rhdf ; 2012 ; p. 179 et s.
[24] Sur leur évolution statistique, voyez : Burney John, Toulouse et son Université ; Facultés et étudiants dans la France provinciale du XIXe siècle ; Toulouse, Presses universitaires du Mirail & Cnrs ; 1988.
[25] Et non l’inverse !
[26] Ce qui n’a évidemment rien à voir avec la situation contemporaine de 2020 où la ville de Toulouse a, par exemple, obtenu l’implantation d’une neuvième Cour administrative d’appel au grand dam du maire de Montpellier qui y voit un favoritisme local de la Garde des Sceaux.
[27] Archives Nationales (A.N.) F17 / 20 103.
[28] Qui avait lui-même était chargé, rappelons-le, d’enseigner le « droit civil dans ses rapports avec l’administration publique » de 1806 à 1808 ainsi qu’il en atteste (ibidem).
[29] Lettre du 04 avril 1829 : ibidem.
[30] Ordonnance du 27 septembre 1829 qui établit une chaire de droit administratif dans la Faculté de droit de Toulouse in Recueil de Beauchamp ; TI, p. 630.
[31] Sur ces premières leçons : Espagno-Abadie & Devaux ; op. cit.; p. 345 et s.
[32] Ordonnance (préc.) du 25 novembre 1830 « qui supprime les chaires de Pandectes et de droit administratif de la Faculté de droit de Toulouse et qui crée, dans cette Faculté, une chaire de droit public français ».
[33] Poumarede Jacques, « Le Barreau et l’Université » in Gazzaniga Jean-Louis (dir.), Histoire des avocats et du Barreau de Toulouse ; Toulouse, Privat ; 1992, p. 175.
[34] Il s’agit bien, contrairement à ce qu’avance Dauvillier (« Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles » in Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse ; Toulouse ; 1976 ; Tome XXIV, fascicules 1 et 2 ; p. 353), de Jean-Baptiste Romiguiere et non de (Dominique-Jean-Joseph) Louis Romiguiere, son père, célèbre avocat également.
[35] Sicard Germain, « Les avocats de Toulouse pendant la Révolution » in Gazzaniga Jean-Louis (dir.), Histoire des avocats et du Barreau de Toulouse ; Toulouse, Privat ; 1992, p. 74.
[36] De fait, Romiguiere sera nommé procureur général de la Cour d’appel de Toulouse en 1833 puis conseiller à la Cour de Cassation en 1849 (et pair de France en 1841).
[37] op. cit.
[38] Lame-Fleury Ernest-Jules-Frédéric, De l’enseignement du Droit Administratif (…) ; Paris, Guyot ; 1866.
[39] Voyez en ce sens : Bonnecase Julien, La Thémis (1819-1831) (…) ; Paris, Sirey ; 1914.
[40] op. cit. ; p. 355.
[41] Rapport et Ordonnance du 12 décembre 1837 portant création de chaires dans les Facultés de droit de Dijon, Grenoble, Strasbourg, Rennes et Toulouse in Recueil de Beauchamp ; TI, p. 781. Voyez aussi : Salvandy Narcisse-Achille (de), « Rapport sur la création de cinq nouvelles chaires de droit administratif et d’une chaire de droit pénal comparé » in Rlj ; Paris, De Cosson ; 1838, Tome VII ; p. 158 et s.
[42] La Faculté de droit de Toulouse étant comprise dans ce lot de cinq établissements, soulignait le ministre, puisque même si les Toulousains ont reçu (par ordonnance du 25 novembre 1830) une chaire de droit public, celle-ci demeura inoccupée jusqu’à ce jour : ibidem.
[43] Ordonnance du 25 mars 1838 inBulletin universitaire contenant les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction Publique ; Tome VIII, p. 105.
[44] Sur l’homme il faut lire (outre notre Annexe II) : Batbie Anselme-Polycarpe, « Annonce du décès de M. Adolphe Chauveau » in Rclj ; Paris, Cotillon ; 1869, Tome XXXIV ; p. 96 ; Dauvillier Jean, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles » in Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse ; Toulouse ; 1976 ; Tome XXIV, fascicules 1 et 2 ; p. 368 et surtout : Rozy Henri-Antoine, Chauveau Adolphe, sa vie, ses œuvres ; Paris, Thorin ; 1870.
[45] C’est ce qui ressort explicitement des séances de la Faculté de Droit des 04 mars 1836 et 28 décembre 1837 telles qu’analysées par nos collègues Espagno-Abadie & Devaux ; op. cit. ; p. 352 et s.
[46] Parfois orthographié de Bastouilh.
[47] Né Jean-Raymond-Marc de Bastoulh le 12 août 1751 à Revel.
[48] Ledit doctorat (ayant été soutenu le 17 juillet 1817 et délivré le 12 août suivant) faisait de Carloman de Bastoulh le neuvième docteur de l’Université (depuis sa création en 1808) : Jourdan Athanase (dir.), « Appendice : Régime des Facultés de droit ; listes des docteurs reçus (…) depuis la création de l’Université » in Thémis ; Paris ; 1820, Tome II ; p. 202 et s.
[49] C’est en effet le 21 octobre 1821 que Jean-Raymond de Bastoulh accéda au décanat.
[50] Dauvillier Jean, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXème et XXème siècles » in Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse ; Toulouse ; 1976 ; Tome XXIV, fascicules 1 et 2 ; p. 353.
[51] A.N. F17 / 20 103.
[52] Ibidem.
[53] Lettre en date du 02 octobre 1829 : ibidem.
[54] Liste nominative des professeurs de la Faculté de droit de Toulouse pour 1830 : A.N. F17 / 2083.
[55] Le professeur Devaux constate également l’absence d’informations sur ce suppléant « disparu » en 1830 : Devaux Olivier, L’enseignement à Toulouse sous la Restauration ; Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse ; 1994, p. 183.
[56] op. cit. ; p. 350.
[57] Poumarede Jacques, « Le Barreau et l’Université » ; op. cit. ; 1992, p. 172.
[58] Ordonnance du 25 novembre 1830 qui supprime les chaires de Pandectes et de droit administratif de la Faculté de droit de Toulouse (…) in Recueil de Beauchamp ; T1, p. 658. L’événement est également relaté par Bonnecase Julien, La Thémis (1819-1831), Son fondateur : Athanase Jourdan ; Paris, Sirey ; 1914.
[59] Puzzo Monique, « La Faculté de droit de Toulouse et le ministère durant le Second Empire » in Rhfd ; Paris, 1988 ; n° 7 ; p. 108.
[60] Wolowsky Louis-François-Michel-Raymond (dir.), « Tableau actuel des neuf Facultés de droit de France avec les mutations survenues depuis leur création » in Rlj ; Paris, De Cosson ; 1839, Tome IX ; p. 464 et s.
[61] En 1822 Flottes avait été nommé à la tête d’une chaire romaniste de Pandectes créée la même année que la chaire de droit commercial qu’occupera Ferradou.
[62] On signale parfois celui d’Alexandre Mérignhac (1857-1927). Toutefois, selon nos sources, si le grand homme s’intéressa bien à quelques questions publicistes (notamment à propos de la domanialité publique du canal du midi), il les traita d’abord en historien et non – en chaire – dans un cours de droit administratif dédié. Par ailleurs, s’il accepta effectivement de tels enseignements publicistes, ce ne fut qu’après 1888 (en 1924 par exemple selon nos recherches). En ce sens : Touzeil-Divina Mathieu, « Alexandre Mérignhac ou l’Unité du Droit incarnée » in Le sceptre renversé ; Mélanges en l’honneur de Jean Barbey ; Paris, Mare & Martin ; 2019 ; p. 257 et s.
[63] Né à Alzon le 12 mars 1805 (et décédé le 23 mars1882), François Constantin Dufour fut d’abord avocat au barreau de Montpellier puis professeur suppléant près la Faculté de droit de Toulouse (de 1831 à 1841) et ce, avant de devenir titulaire de la chaire de droit commercial (1841) et même doyen de l’établissement (1869-1879) et placé en retraite en 1882.
[64] Pierre-Amédée-Adrien Couraud fut suppléant provisoire à Toulouse (1855), agrégé des Facultés à Grenoble (1857) puis pour quelques semaines de retour à Toulouse (1858) avant d’être confirmé comme professeur titulaire à Grenoble où il se saisit de la chaire de droit administratif (1858) avant de devenir doyen de l’établissement (1869) et ce, avant sa mutation à la Faculté de droit de Bordeaux (1871-1886) où il sera également administrativiste et doyen (puis doyen honoraire (1886)).
[65] Henri Antoine Rozy est né à Toulouse, le 12 octobre 1829 et décédé le 20 septembre 1882). L’homme a successivement été avocat, professeur suppléant provisoire (1855), puis agrégé et rattaché à la Faculté de droit de Toulouse (1862) où il enseigna l’économie politique pour les aspirants au doctorat et remplaça en droit administratif le titulaire Chauveau aux côtés de Batbie lorsque Chauveau, précisément, ne pouvait assurer du fait de son état de santé ses leçons (Adhg, 3160W249 ; Arch. Ut1, 2Z2-7 et 2Z2-8).
[66] André-Léon-Michel Cassin fut professeur agrégé (au sens premier de l’époque c’est-à-dire suppléant et non titulaire de chaire) à Strasbourg puis à Toulouse (1862-1864) puis à Nancy et à Paris. Il décéda le 27 mai 1883.
[67] Il existe deux dossiers personnels de Wallon comme agent public : aux Archives Départementales de la Haute-Garonne (A.D. 3160W249) et aux Archives Nationales (A.N. F17/22259/B). Ces différents dossiers seront cités au moyen de leurs initiales. Un autre dossier existerait aux archives de l’Université Toulouse 1 Capitole sous la cote parfois citée 2P106 mais nous n’avons rien trouvé en ce sens. On se permettra de renvoyer à : Touzeil-Divina Mathieu, « A Toulouse, entre Droit & Rugby : Ernest Wallon (1851-1921) » in Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre ; Toulouse, L’Epitoge ; 2020 ; Tome I ; p. 411 et s (dont les présents propos sont issus). Citons également la seule forme de biographie relative à Wallon et ce, dans la base Siprojuris (en ligne) sous la cote 178887943.
[68] Ernest y est reçu bachelier ès lettres et ès sciences puis licencié puis docteur en Droit (le 16 décembre 1876).
[69] De la dot mobilière en droit romain et en droit français, Paris, Thorin, 1877.
[70] La lecture de son dossier préc. aux A.N. nous apprend qu’Ernest était également très soutenu des notables locaux et nationaux à l’instar du député tarnais Adrien Constans (1873-1932) et de l’inspecteur général Charles Giraud (1802-1881). En particulier, une lettre de ce dernier (datée du 26 juillet 1878) nous semble avoir été déterminante dans l’entrée de Wallon dans l’Université. Le savant inspecteur Giraud y décrit effectivement le jeune Wallon comme un futur universitaire destiné à une belle carrière malgré son récent échec au concours.
[71] Respectivement : E. Wallon, Composition de droit français ; Comparer, au point de vue de la validité des actes, les effets de la démence, de l’interdiction et du placement dans une maison d’aliénés, Paris, Rousseau, 1879 et Composition de droit romain ; Quid est communio et quomodo tam sine judice qiam judicio divisio fieri potest ?, Paris, Rousseau, 1879.
[72] C’est au cours de cette première année d’enseignement que décède sa mère, à Montauban, le jour même de l’anniversaire d’Ernest.
[73] A ce sujet, on dispose d’une source intéressante. Un article (de l’automne 1881) versé au dossier préc. aux A.N. décrit l’inauguration du cours et loue de façon dithyrambe les qualités morales, scientifiques et d’élocutions du jeune agrégé Wallon. Ainsi, explique le journal local, « M. Wallon pense qu’une même législation pour tous les pays est une utopie irréalisable. Il a excellemment défini le droit international privé ». « Sa leçon, formée d’aphorismes, de pensées fortes et empreinte d’un grand esprit de justice et de vérité, mérite d’être retenue ». Le droit international privé, mettrait selon lui deux principes en avant : « Un Etat doit avant tout respecter les Lois des autres Etats. Le respect cesse d’être dû lorsque la législation étrangère porte atteinte à la Loi nationale ». Pour conclure : « D’un bout à l’autre la science du droit est admirablement servie par une parole élégante et facile ». Cet engouement surprend peu lorsque l’on sait que l’inspecteur général Accarias (1831-1903) écrira en mars 1882 à propos du même cours inspecté et de son titulaire : « esprit très ouvert » ; « déjà très avancé dans la connaissance des législations étrangères sans lesquelles le droit international privé ne saurait être enseigné » ; « M. Wallon est déjà un excellent professeur » !
[74] On y a notamment relevé les examens prétoriens des années 1882 (p. 404 et s.), 1883 (p. 449 et s.), 1884 (p. 641 et s.), 1885 (p. 129 et s.), 1886 (p. 545 et s.), 1887 (p. 145 et s.) et 1888 (p. 545 et s.). On notera que cet examen a cessé sitôt que Wallon obtint son « transfert » de chaire !
[75] M. Touzeil-Divina, Une vie d’Hauriou, Toulouse, manuscrit, 2018. Une version vidéo et amateure de ladite pièce réalisée à Toulouse lors du premier « Marathon du Droit » est en ligne ici :
http://marathondudroit.org/UVH.mp4.
[76] Ce que nous avons souligné dans nos travaux de doctorat puis in « Maurice Hauriou, mystificateur ou héros mythifié ? », in Miscellanées Maurice Hauriou, Le Mans, L’Epitoge, 2013, p. 85 et s.
[77] Sur le rejet a priori d’Hauriou : J.-M. Blanquer & M. Milet, L’invention de l’Etat ; Léon Duguit, Maurice Hauriou et la naissance du droit public moderne, Paris, Odile Jacob, 2015, p. 61 et s.
[78] Lettre en date du 26 octobre 1842 (dossier personnel : A.N. F17 / 20862).
[79] E. Audinet, Georges Barilleau, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Poitiers (1853-1925), Poitiers, Imp. Moderne, 1927.
[80] Dossiers personnels : A.N. F17 / 20 404 (Chauveau) et AJ 16 / 217 (Giraud).
[81] Voyez à cet égard les arrêtés ministériels accordant des congés « pour raison de santé » respectivement en date des 15 juillet 1911, 20 juillet 1912 et 29 juillet 1913 (aux A.N. – préc). En 1914, il « prend les eaux » en bords de Méditerranée et écrit ses courriers depuis Nice (au 4, rue Dante) où, « même en janvier », les températures sont pour lui plus supportables à l’approche de la retraite espérée (A.D.).
[82] Signalons entre autres ces extraits : « très universitaire », « de grande valeur scientifique et professionnelle » ; prenant « part active à tout ce qui intéresse l’Université » (1911 ; doyen Hauriou) ; « M. Wallon accomplit très exactement ses fonctions : son cours très travaillé jouit d’une grande autorité auprès des élèves qui suivent ses leçons de droit civil » (1903 ; doyen Deloume) ; le recteur (Perroud) renchérissant : « M. Wallon est le plus universitaire des professeurs de la Faculté. C’est un professeur instruit, laborieux judicieux, (…). La parole est nette et élégante ». En 1898, le doyen Paget signalait un « très bon Professeur. Son enseignement est sérieux, élevé, libéral (sic) et clair. Sa santé, seule, trahit parfois ses efforts ». Enfin, en 1888, le doyen Bonfils affirmait : « Monsieur Wallon est un fonctionnaire attaché à l’accomplissement de ses devoirs et soucieux de la prospérité de l’Université. Il travaille avec ardeur le cours de Code civil et y apporte les qualités qui avaient été fait auparavant apprécier son cours de droit administratif ».
Partager la publication "Toulouse & le droit administratif enseigné I / III : le XV avant Hauriou (1788-1888)"

À propos de l’auteur