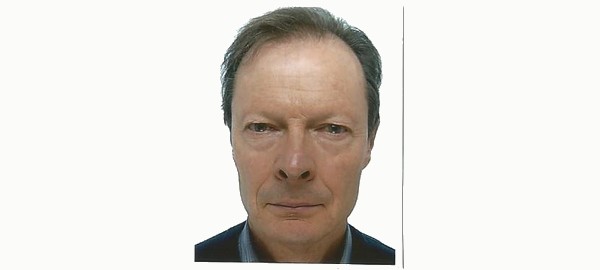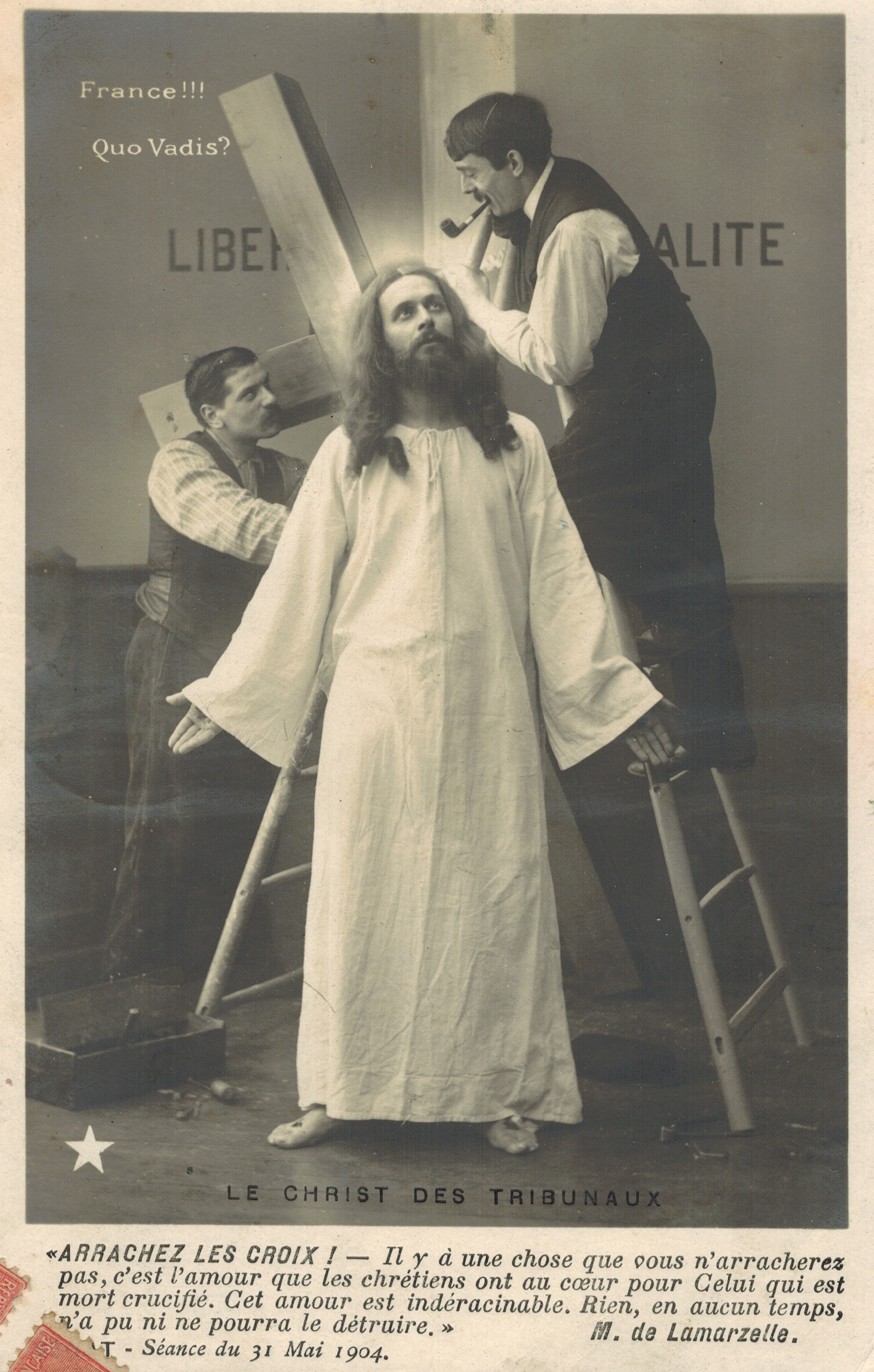par Abdesslam DJAZOULI-BENSMAIN,
Doctorant contractuel en Droit Public à l’Université Toulouse 1 Capitole (IDETCOM)
Art. 108. (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, Avis CE n° 390.786 du 17 novembre 2015, Avis CE n° 391.124 du 2 février 2016, Avis CE n° 291.519 du 28 avril 2016, Avis CE n° 391.834 du 18 juillet 2016, Avis CE n° 392.427 du 8 décembre 2016)
Cet article fait suite au dossier du Journal du Droit Administratif portant sur l’Etat d’Urgence d’avril 2016 – Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina
« L’état d’urgence ne peut être renouvelé indéfiniment ». Cette simple phrase dans un entretien au Monde[1] de Jean-Marc Sauvé[2] a suscité dans la vie civile une vague d’interrogation[3] sur le fondement des prorogations successives de l’état d’urgence au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.
À la suite des attaques du Stade de France, du Bataclan et des terrasses parisiennes, le Président de la République a décidé de mettre en place ce vieux mécanisme datant de la guerre d’Algérie. À l’origine, le législateur souhaitait créer un état d’exception sans pour autant y intégrer la connotation martiale de l’état de guerre ou l’état de siège (Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 23). Cette volonté est alors clairement explicitée par l’Assemblée nationale dans une lettre au ministre de la Justice où les députés développent l’idée selon laquelle « les hommes qui commettent ces attentats[4] contre les personnes et les biens ne sauraient en aucun cas être considérés comme ayant un caractère militaire »[5]. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que François Mitterrand, encore ministre de l’Intérieur sous le gouvernement de Mendes-France en février 1955, fut l’un des grands artisans[6] de cette loi gratifiant l’exécutif de prérogatives supplémentaires. Cela est d’autant plus étonnant qu’il fut l’auteur d’un essai à charge envers le Président de Gaulle, « Le Coup d’État permanent[7] », où il dénonce précisément le cumul de prérogatives au profit de l’exécutif sous le régime de la Vème République.
Cette loi a été mise en action, avant les évènements tragiques qui nous intéressent, trois fois seulement depuis son entrée en vigueur. Une première fois pour circonscrire les premières étincelles de la guerre d’Algérie[8] sans pour autant faire intervenir les forces armées[9]. Une seconde fois lors des évènements en Nouvelle-Calédonie[10] pour tenter de gérer la situation. Enfin, une troisième fois en 2005[11] lors des émeutes des banlieues parisiennes malgré la relative légèreté des causes de son actionnement[12] par rapport aux précédentes.
Déjà à l’époque, et notamment concernant les émeutes de 2005, la question de la prorogation de cette disposition d’exception a fait l’objet de vifs débats juridiques sur cette question fondamentale : une prorogation de l’état d’urgence n’étend-elle pas le risque de voir apparaître en France un état d’exception permanent ? Il est d’ailleurs intéressant de constater que la doctrine s’est insurgée à l’encontre de cet état d’exception permanent à la suite d’une prorogation seulement de trois mois alors qu’aujourd’hui nous vivons sous l’état d’urgence depuis plus d’un an. Tout cela met en perspective ces débats vieux d’une décennie à l’aube de la nouvelle année.
Les questions de 2005 se posent encore aujourd’hui avec une nouvelle envergure. Après une première prorogation de trois mois[13] en novembre 2015, le gouvernement a décidé de prolonger encore une fois l’état d’urgence de trois mois en février 2016[14], puis encore deux mois en mai 2016[15] pour enfin arriver à la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant une nouvelle fois cet état d’exception pour six mois portant la durée totale à dix-sept mois. Nous vivons donc ainsi la plus longue application de cette disposition depuis la Guerre d’Algérie, ce qui nous pousse à la réflexion quant à l’intensité de l’actualité.
Cette multiplication des prorogations a, naturellement, donné l’occasion au Conseil d’État d’exercer sa mission traditionnelle, celle de donner sa position sur les projets de loi qui lui sont soumis. Il s’agit de sa mission depuis plus de deux siècles[16] et elle permet, selon les mots du Vice-Président Sauvé, « aux représentants du peuple français — d’assurer de manière informée et juridiquement rigoureuse les missions constitutionnelles qui sont les leurs[17] ». Ces avis, qu’ils soient favorables ou défavorables, apportent une forme de caution juridique que le Conseil d’État, par son importance, est à même d’apposer. Lorsque la disposition législative sur laquelle il est amené à se prononcer revêt une importance aussi grande que celle de la prorogation d’un état d’exception, l’avis apparaît alors comme fondamental dans l’appréciation que les juristes, les politiques et la société civile doivent se faire de l’opportunité de la décision de prolongation de l’état d’urgence.
Ainsi, l’étude attentive de la succession d’avis du Conseil d’État sur cette question semble pertinente et nécessaire. De plus, l’expression publique du Vice-Président de cette même juridiction, s’écartant[18] de son devoir de réserve, incite à l’imagination. Est-ce que le Conseil d’État arrive à ce qu’il juge être une limite en terme de prorogation ? Est-ce que celui-ci, malgré les différents avis favorables, souhaite exprimer des réserves à l’encontre de ces dispositions ? Ces questions n’obtiennent pas de réponse dans l’entretien sommaire du Monde. Néanmoins le juriste peut trouver des éléments de réponses dans les avis du Conseil d’Etat. De cette manière, il nous sera possible d’apporter des pistes de réflexion quant à la position de la Haute-Cour sur l’état d’urgence. Il sera intéressant de déterminer si celle-ci est homogène tout au long de cette année où si, tout au contraire, elle change selon la période donnée. Nous pourrons également apprécier le ton de la Cour suprême de l’ordre administratif et dégager l’évolution de celui-ci.
Les avis du Conseil d’État ne sont pas complètement homogènes, il est possible d’en extraire des différences notables malgré un socle formel commun évident. Chacun intervient à un moment précis et subit (ou embrasse) l’actualité — parfois triste — de notre époque. Ces deux aspects poussent le lecteur à lire ces avis comme les épisodes d’une longue « saga ». Les deux premiers avis, prorogeant chacun de trois mois l’état d’urgence se font l’écho de « la menace fantôme » (I) qui a régné sur notre pays comme sur notre système juridique au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Le troisième avis, prorogeant là de simplement deux mois, apparaît comme « un nouvel espoir » (II) pour le Conseil d’État de voir ses recommandations suivies. Enfin, les deux avis les plus récents marquent le retour d’une approche plus ferme de l’état d’urgence, une « contre-attaque » de l’exécutif (III).
I. La menace fantôme
Les deux premiers avis du Conseil d’État (n° 390.786 et n° 391.124) sont les plus proches des attentats du 13 novembre 2015 qui sont la cause originelle de l’application de la loi du 3 avril 1955. Le contexte sécuritaire est encore perturbé par les attaques de Paris, mais aussi par un climat international particulièrement lourd. La tension est alors palpable tant le pays semble vulnérable face à ces dangers qui sont par définition invisibles. L’Etat doit réagir et l’exécutif décide d’utiliser ce dispositif de l’état d’urgence, inappliqué depuis une décennie.
Déjà aux visas de ces deux premiers avis, quelque chose attire l’œil du juriste : le quantum de la prorogation proposé par le projet de loi. Cette mention n’est pas anodine, car comme nous le verrons, la question du prolongement de l’état d’exception dans le temps est au cœur des réticences que met en exergue le Conseil d’État dans ses avis. De plus, la mise en perspective de ces périodes avec les justifications de fait qu’évoque le juge administratif peut être intéressante à réaliser tant ces deux éléments seront fondamentales dans les avis suivants. Dans le cas des deux premiers, sans réelle surprise, il s’agit d’une période de trois mois.
La première prorogation n’a pas eu réellement besoin de justification matérielle tant la menace terroriste était encore dans l’actualité. Ainsi l’avis, comme le projet de loi, ne fait pas mention particulière des raisons tangibles qui imposent cette prorogation. Néanmoins le texte passe plus de temps que les autres à justifier de l’opportunité juridique d’une telle disposition. Le juge administratif fait appel à deux éléments. D’abord la décision du Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité de l’application de la loi du 3 avril 1955 en 1985 concernant la Nouvelle-Calédonie[19]. Puis, sa position préalable, au lendemain des émeutes de 2005, sur la conventionalité du dispositif au regard de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales[20] (sur ce point, Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 27). Le juge administratif n’utilisera plus ces éléments dans les avis suivants et ne gardera que de simples éléments de faits.
Ainsi, dans l’avis du 2 février 2016 portant sur la deuxième prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’État justifie le « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public[21] » par les « liens entre le terrorisme intérieur et le terrorisme dirigé depuis l’étranger contre la France » qui n’ont « rien perdu de leur intensité » ; la présence jugée « importante de ressortissants français […] en zone Irako-Syrienne » qui « sont susceptibles de revenir en France à tout moment pour y accomplir des actions violentes » et la « persistance de la menace » du fait « d’actions de moindre ampleur ». Tous ces éléments factuels développent cette notion d’une possible « menace fantôme » qui, tout en pesant avec gravité sur notre société n’est pourtant pas tangible, elle est même parfois extérieure.
Néanmoins le Conseil d’État considère l’état d’urgence justifié et cela notamment vis-à-vis de l’efficacité de celui-ci. Le juge administratif considère que « l’expérience acquise depuis le 14 novembre a confirmé la nécessité des mesures prises au titre de l’état d’urgence tant pour prévenir les attentats que pour désorganiser les filières terroristes ». Sur le terrain de l’efficacité, lors des premiers mois de son application, force est de constater que la disposition a fait ses preuves avec, notamment, 3284 perquisitions, 392 assignations à résidence et 10 fermetures de lieux de cultes[22]. Néanmoins, il apparaît complexe de lier l’opportunité de l’application de la disposition à son efficacité tant, par la suite, celle-ci ne va pas se pérenniser.
Le second avis a une autre originalité, celle de faire mention d’une mise en garde de la juridiction administrative envers le Gouvernement et le législateur quant à l’habitude qui pourrait se créer de prolonger cet « état de crise ». Le Conseil énonce, par la négative, que la durée proposée de trois mois « n’apparaît pas inappropriée au regard des motifs justifiant la prorogation ». De plus, le juge considère que « la prorogation prévue opère […] une conciliation non déséquilibrée entre la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement, d’une part, et la protection de l’ordre et de la sécurité publics, d’autre part ». Tout cela sous-entend, à notre avis, une forme de mise en garde sur l’avenir. Il s’agit d’un avertissement qui cherche à éviter que ce temps de crise ne se banalise. Le juge reprend par ailleurs les conclusions du juge des référés du Conseil d’État de 2005[23] qui déjà à l’époque rappelait qu’un « régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui dans un État de droit sont par nature limités dans le temps et dans l’espace ». Le message apparaît comme clair, il est d’ailleurs explicité, « l’état d’urgence doit demeurer temporaire ». Le Conseil d’État ajoute que l’état d’urgence perd son objet quand « s’éloignent les atteintes graves à l’ordre public » ou « que sont mis en œuvre des instruments qui, sans être de même nature que ceux de l’état d’urgence […] ont vocation à répondre de façon permanente à la menace qui l’a suscité ». On retrouve ici les deux aspects qui vont s’avérer fondamentaux pour apprécier le changement de ton que va opérer le Conseil d’État à travers les avis suivants.
II. Un nouvel espoir
L’avis n° 391.519, concernant la troisième prorogation de l’état d’urgence, apparaît comme inédit à la lumière des deux précédents. Sur la forme, il reprend pourtant le même schéma que le deuxième avis en énonçant des éléments de faits qui vont venir justifier l’opportunité du projet de loi d’avril 2016.
L’avis observe que « plusieurs attaques terroristes ont frappé des métropoles d’Europe, du Proche et du Moyen-Orient » caractérisant, une fois de plus, cette menace invisible planant sur notre société, mais, également, l’incidence du double attentat de Bruxelles[24]. Enfin, il souligne également que des « opérations terroristes qui ont eu lieu ont été préparées, financées et réalisées par des individus venant de zones de combat en Syrie et profitant de filières de migration et de nombreux déplacement dans l’espace européen » visant la France et ses intérêts à l’étranger.
De manière, plus originale, le Conseil d’État relève la collusion entre ces menaces extérieures et l’organisation de manifestations sportives de grandes ampleurs en France. Il s’agit notamment de l’EURO 2016[25] de Football et de l’édition 2016 du Tour de France[26]. Et alors qu’il pourrait comme dans le second avis ne justifier la prorogation de l’état d’urgence que par les premiers éléments factuels, le juge administratif utilise la « conjonction d’une menace terroriste persistante d’intensité élevée[27] » avec les manifestations sportives de niveau national pour motiver sa décision et pour caractériser le « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ».
Nous sommes là en présence de l’un des points d’intérêts de cet avis. Le Conseil d’État ne considère plus que les « simples » évènements extérieurs reflétant la « menace fantôme » explicitée plus haut justifient les prorogations successives de l’état d’urgence. Selon lui, il faut désormais, les conjuguer avec des évènements d’une ampleur telle que le risque sur la sécurité nationale est palpable. Il s’agit d’une forme supplétive d’avertissement dirigé vers l’exécutif et le législateur.
Le Conseil d’État rappelle ensuite, dans son quatrièmement, que l’état d’urgence « doit demeurer temporaire » comme dans son avis du 2 février 2016. Puis, le juge administratif relève la conformité de ce nouveau projet de loi par rapport aux mises en garde qu’il avait réalisées lors des avis précédents. En effet, le gouvernement a limité cette nouvelle prorogation à seulement deux mois, et cela pour couvrir la durée des manifestations sportives précitées. Ainsi, l’exécutif et le législateur en adoptant ce projet de loi se montrent plus mesurés dans l’application de la loi de 1955 de sorte qu’un nouvel espoir semble jaillir dans les mots du Conseil d’État. En effet, ses trois recommandations précédentes, sur l’efficacité de la mesure, sur son quantum et sur les pouvoirs accordés à l’exécutif semblent avoir porté leur fruit.
Le juge administratif note « que cette prorogation limitée dans le temps […] tient compte de la réduction progressive des effets des mesures de l’état d’urgence au fil du temps ». En effet, force est de constater que l’effectivité de la disposition d’exception n’est plus ce qu’elle était au moment de sa première prorogation. La grande majorité des perquisitions et assignations à résidence s’est faite dans les premiers mois de la mesure, au-delà, celles-ci se sont faites plus rares démontrant de l’affaiblissement progressif de l’impact réel de ces dispositions.
Le Conseil d’État fait également mention de « pouvoirs réduits » de l’exécutif pendant l’état d’urgence. En effet, cette nouvelle prorogation exclut l’usage de perquisitions administratives rétrécissant de fait les moyens quelque peu exorbitants accordés à l’administration en temps de crise. Rappelons que la perquisition est, avec l’assignation à résidence, l’outil clé de la loi du 3 avril 1955 (Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 32).
Enfin, le Gouvernement n’a proposé qu’une prorogation de deux mois, simplement pour envelopper le Tour de France et l’EURO 2016 de la couverture sécurisante de l’état d’urgence. Cette décision apparaît, pour le lecteur comme pour le juge administratif, comme un assouplissement de la mesure sonnant, peut-être, le glas de l’état d’exception.
Ces trois éléments démontrent l’espoir du Conseil d’État de voir l’application de cette disposition cesser dans les mois qui suivent. Le juge administratif énonce qu’ils sont « bien de nature à conduire à une cessation de cet état » tout en rappelant, encore une fois, que l’état d’urgence « perd son objet, dès lors que s’éloignent les atteintes graves à l’ordre public » ou que sont « mis en œuvre des instruments […] ayant vocation à répondre de façon permanente à la menace qui l’a suscité ». Il apparaît clair au terme des quatrième, cinquième et sixième points de l’avis du 28 avril 2016 que le juge administratif appelle le Gouvernement et le législateur à une sortie progressive et maîtrisée de l’état d’urgence.
III. L’empire contre-attaque
Cet espoir du juge administratif n’a pourtant pas été suivi par les faits, ce qui peut être constaté à travers les deux avis suivants, celui du 18 juillet 2016 et le très récent du 8 décembre de la même année.
C’est une actualité particulièrement dense bouleversant encore une fois le pays qui a poussé le Gouvernement et le législateur à réagir fortement. Les attentats du 14 juillet 2016 à Nice[28] ont vu passer la « menace de fantôme » à une menace plus directe, plus tristement palpable. La société civile, la population, a tout de suite demandé une réaction de la part de l’autorité et c’est ainsi, alors que la loi de prorogation précédente avait été celle de la modération, qu’est née la loi n° 2016-987 du 21 juillet qui a été celle de la contre-attaque de l’administration pour relancer plus fortement la dynamique de l’état de crise.
Initialement, le projet de loi prévoyait une prorogation de trois mois de l’état d’urgence mais la loi repoussera à six moi supplémentaires. Le juge administratif constate évidemment la violence de l’actualité avec l’attentat de Nice, mais aussi une « menace terroriste » intense résultant de « la venue d’individus en provenance de zones de combat en Syrie, profitant des filières de migration[29] ». Le Conseil d’État, comme pour la première prorogation, n’a besoin d’aucune autre base factuelle que celle des attentats de Nice pour qualifier le « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » de sorte que seul cet acte justifie une prorogation de six mois. On peut par ailleurs se poser la question de l’opportunité du quantum alors que les attentats de Paris n’avaient entrainé « que » 3 mois de prorogation.
Le dernier avis en date, celui du 8 décembre 2016, reprend quelque peu la logique du troisième avis mais est dépourvue de l’espoir qu’il, semblait-il, inspirait. Il découle de la menace terroriste « intense », sur de nombreux attentats « commandité à partir du territoire syrien » déjoués par les forces de l’ordre, mais surtout de « l’assassinat d’un prêtre de la paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray » en date du 26 juillet 2016[30]. Néanmoins, de la même manière que dans l’avis du 28 avril, le Conseil d’État vient mettre en relation cette « menace intense » avec un élément d’actualité : la campagne électorale présidentielle et législative. Usant de la même formule, le juge administratif « estime que la conjonction de la menace terroriste persistante d’intensité élevée […] et des campagnes électorales présidentielle et législative caractérise un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ».
Dans les deux avis, le juge administratif rappelle la nécessité de ne pas banaliser dans le temps l’état de crise par les formules devenues traditionnelles. Néanmoins, le lecteur peut sentir un haussement de ton de la part du juge administratif dans l’expression de la formule suivante au (5) de l’avis du 18 juillet 2016 : « Les menaces durables ou permanentes doivent être traitées, dans le cadre de l’État de droit, par des moyens permanents renforcés par les dispositions résultant des lois récemment promulguées[31] ». Là où le Conseil laissait un choix auparavant – la disparition du péril imminent ou l’adoption de moyens appropriés – il se montre ici plus ferme en utilisant une tournure plus affirmative.
Par ailleurs, dans le dernier avis en date, le juge administratif précise plus encore sa position en associant les « instruments permanents de lutte contre le terrorisme » au « projet de loi sur la sécurité publique qui sera prochainement examiné par le Parlement ». Il est relativement sain d’imaginer que cette analogie (en plus des propos de Jean-Marc Sauvé à la presse) est l’ultime alerte du Conseil d’État sur les dérives temporelles de l’état d’urgence.
La position du Conseil d’État est complexe sur le sujet de l’état d’urgence. Le pouvoir judiciaire et surtout la plus haute juridiction de l’ordre administratif doivent à la fois garantir les droits et libertés de chacun tout en conciliant ceux-ci avec les questions de protection de l’ordre public. Difficile, dans cette situation de trouver l’équilibre parfait. Les différents épisodes de cette « saga » posent de nombreuses questions annexes que le juge administratif ne traite pas du fait de leur caractère trop politique. Elles sont néanmoins essentielles. Il s’agit de savoir si la société veut vivre perpétuellement sous cet état de crise, si elle n’encoure pas de voir les dispositions de l’exception se transformer en droit commun ou encore si elle est prête à limiter ces libertés pour plus de sécurité. Le danger également est de voir cette « saga » se perpétuer trop longtemps au risque de voir les épisodes se répéter. Ces problématiques ne peuvent obtenir de réponses dans les avis du Conseil d’État, mais poussent à un réveil de la conscience citoyenne que nous appelons de nos vœux.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2017 ; chronique administrative 02 ; Art. 108.
[1] Le Monde, Samedi 29 octobre 2016, propos recueillis par Jean-Baptiste Jacquin
[2] Vice-Président du Conseil d’Etat depuis 2006
[3] Quelques exemples : « Etat d’Urgence : les réserves du Conseil d’Etat et les questions sur une nouvelle prolongation » – LeFigaro.fr publié le 19/11/16 ; « Etat d’urgence : le vice-Président du Conseil d’Etat » – Linfo.re publié le 18/11/16 ; « L’Etat d’Urgence : un régime d’urgence qui doit rester exceptionnel » – Village-Justice.com publié le 20/12/16
[4] Nous sommes encore dans le cadre de la guerre d’Algérie
[5] Lettre de l’Assemblée Nationale à Jean-Michel Guérin du 13 novembre 1954 – BB18 4226
[6] François Mitterrand reconnaît sa participation à l’élaboration du dispositif dans des débats à l’Assemblée Nationale le 31 mars 1955
[7] Edition Plon, Coll. Les débats de notre temps, 1964
[8] Plusieurs fois de 1955 à 1962 lors des évènements de la Toussaint Rouge, des mouvements du 13 mai 1958 et du « Putsch des généraux » en 1961. Pour aller plus loin, Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 25
[9] Cela n’aura que peu d’incidence sur le cours de l’histoire
[10] Loi n°85-86 du 25 janvier 1985 relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances
[11] Décret n°2005-1386 du 08 novembre 2005 portant application de la loi du 3 avril 1955 ; Loi n°2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955
[12] L’utilisation de l’état d’urgence a été vivement critiqué comme une pure action d’opportunité politique visant à mettre en avant le Premier Ministre, Dominique de Villepin, face à son ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy
[13] Loi 2015-1501 du 20 novembre 2015
[14] Loi n°2016-162 du 19 février 2016
[15] Loi n°2016-629 du 20 mai 2016
[16] Article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII
[17] Conclusion de Jean-Marc Sauvé, « L’Assemblée nationale et les avis du Conseil d’Etat », Assemblée nationale 25 novembre 2016
[18] Il ne s’écarte en fait que très peu de son devoir de réserve puisque les avis explicitent exactement la même idée
[19] Cons. Constit. N°85-187 DC du 25 janvier 1985
[20] CE Ass. 24 mars 2006, Rolin et Boisvert
[21] L’article 1er de la loi du 3 avril 1955 énumère deux situations qui permettent son application, le « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » et des évènements présentant le caractère de « calamité publique »
[22] Au 3 février 2016 – JORF n°0048 du 26 février 2016
[23] 9 décembre 2005 (n°287777) et plus récemment 27 janvier 2016 (n°396220)
[24] Des attentats ont été commis le 22 mars 2016 dans la ville de Bruxelles notamment dans des infrastructures de transports. Deux terroristes ont réalisé un attentat suicide à l’aéroport de la ville et un troisième dans une rame de métro. Ces attentats ont été revendiqués par l’Etat islamique et l’enquête a démontré la collusion entre les auteurs et ceux des attentats de Paris de novembre 2015.
[25] Avec 51 matchs disséminés dans tous le pays et une affluence particulière de spectateurs, notamment étrangers, le facteur risque était très fort
[26] De la même manière, le Tour de France attire beaucoup de spectateurs à travers de tout le pays
[27] Les attentats de Bruxelles, les opérations terroristes à l’étranger, …
[28] A l’issue du feu d’artifice de la fête nationale, un homme a causé la mort de 84 personnes et a fait 286 blessés en percutant la foule à l’aide d’un camion sur la Promenade des Anglais. L’attentat a été revendiqué par le groupe Etat islamique
[29] Le juge administratif fait référence à la « crise des migrants » de fin d’année 2015 qui a vu un grand nombre de réfugiés quitter les zones de guerres pour rejoindre l’espace Schengen
[30] Assassinat revendiqué par le groupe Etat islamique
[31] Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, loi n°2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs et loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lute contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale