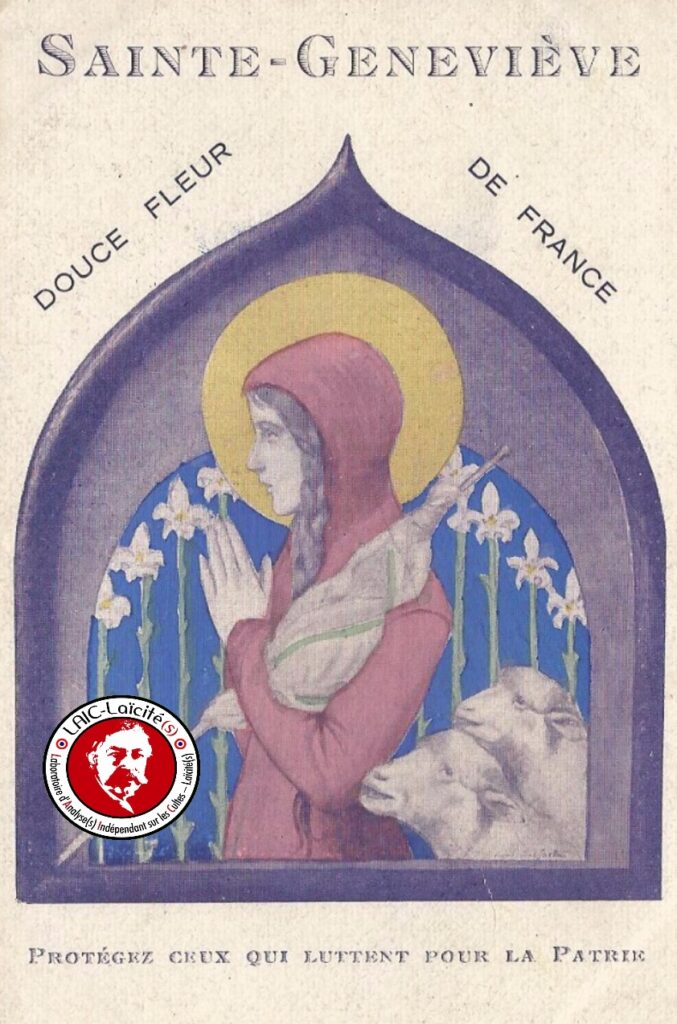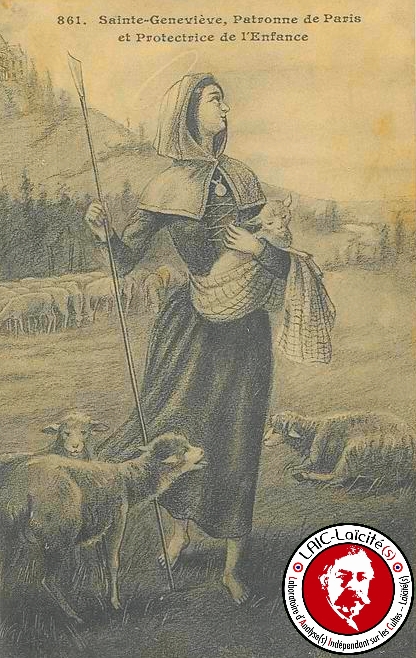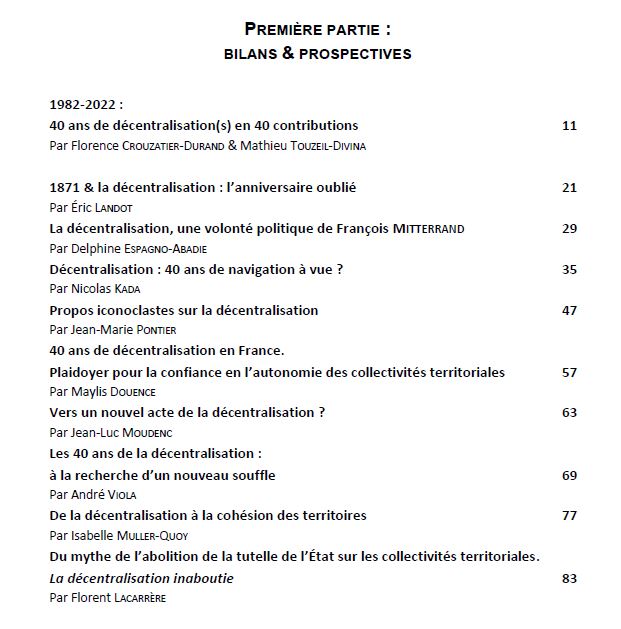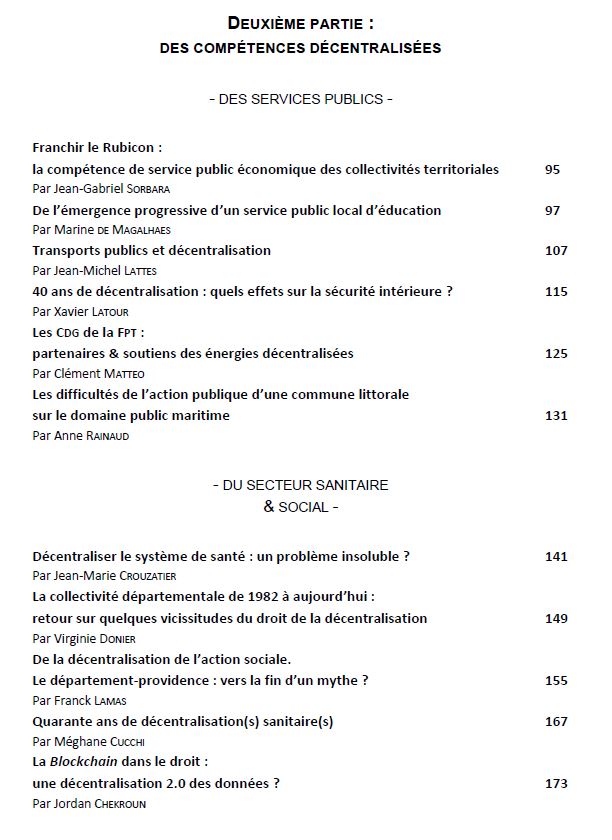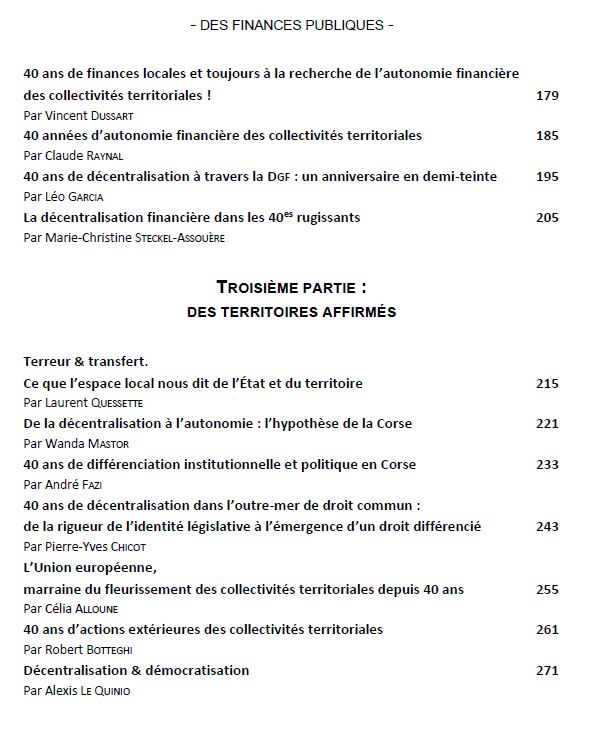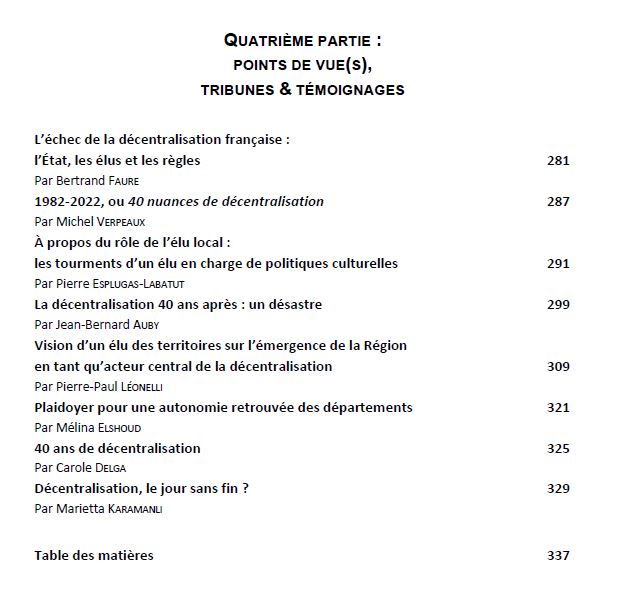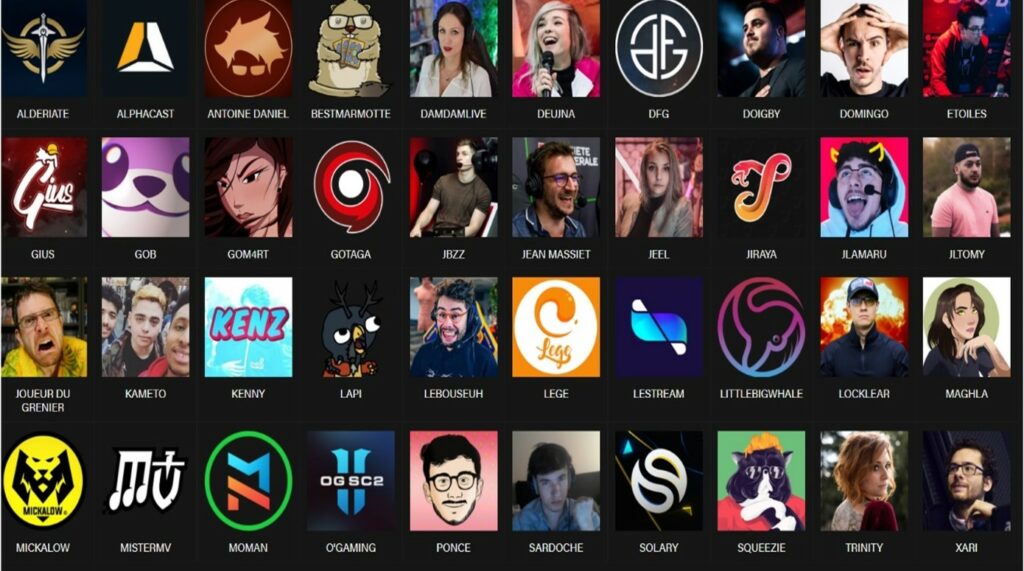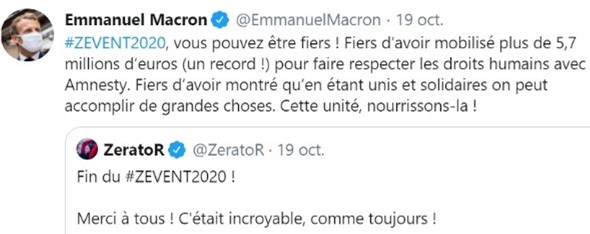Art. 335.

Le présent article rédigé par M. Gauthier Desfontaine, Etudiant en Master II Droit de la Santé, Université Toulouse 1 Capitole, promotion Gisèle Halimi (2020-2021), s’inscrit dans le cadre de la 3e chronique en Droit de la santé du Master avec le soutien du Journal du Droit Administratif.


Les coulisses du football business où se mêlent argent, pression, culte de la performance et hypermédiatisation : un terreau propice au développement de troubles psychosociaux
Dans son roman autobiographique posthume « Le premier homme » Albert Camus écrivain, philosophe et prix Nobel de littérature écrivait « qu’il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est plus heureux que dans un stade de football ». Cette phrase laisse subsister le doute quant à la nature et à la fonction de cet homme dans le stade. Albert Camus fait-il référence au simple spectateur ou alors au joueur ? Car si la première option est surement vraie la seconde laisse place à controverse[1].
Le football professionnel est un milieu privilégié. Il peut garantir la notoriété, la gloire ainsi qu’une situation financière parfois (très) confortable. Les jeunes apprentis footballeurs ont tous rêvés de devenir « pro » à l’instar de leurs idoles. Nombre d’entre eux ont été dissuadés par leurs entourages conscients des difficultés de cette profession et de l’impitoyabilité du milieu.
Comme nous le verrons au fil du développement, le secteur du football est profondément imprégné par la logique de marché. C’est un milieu très concurrentiel avec des enjeux économiques considérables. Seul les meilleurs ou parfois les plus chanceux atteignent les sommets et sur la route du succès se mêlent de nombreux obstacles.
Cet environnement est évidemment nocif pour la santé des joueurs qui paradoxalement se doit d’être optimal et afin de répondre aux nombreuses attentes de « l’espace social de la haute performance » pour reprendre l’expression de Bruno Papin dans son ouvrage « Temps sportif, santé du champion et logique de l’urgence »[2].
Plusieurs études et de nombreux témoignages mettent en exergue le constat suivant : la santé mentales et psychologiques des footballeurs professionnelles se dégrade, les cas de dépression et de burn out sont en croissance constante. Ces pathologies font parties des risques psychosociaux définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d’emploi, les facteurs liés à l’organisation du travail et aux relations de travail[3].
Selon les données de Sporting Chance publiées dans un rapport de la PFA (Professional Footballers’ Association), depuis le début de l’année 2020, près de 10% des 4 000 membres du syndicat de sportifs professionnels le plus ancien au monde ont déjà eu recours à une forme de soutien à ce sujet, dont 42% sont des joueurs actuels et 55% d’anciens joueurs. D’autant plus préoccupant que les chiffres ont quadruplé depuis 2016).
De plus une étude de la Fifpro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) a révélé en 2015 que sur un panel de 607 footballeurs professionnels 38% d’entre eux étaient sujets à la dépression. Ce taux est supérieur à celui du reste de la population mondiale dont le taux environne les 15%.
L’intérêt de cette étude apparaît donc à plusieurs égards.
Tout d’abord, celle-ci a pour finalité de sensibiliser aux problématiques sociales et sanitaires que peuvent rencontrer ces hommes et ces femmes exerçant le métier de footballeur professionnel loin de l’image idyllique que les médias et les réseaux sociaux renvois d’une profession en réalité très difficile et très inégalitaire. Ces derniers constateront que malgré les aprioris voir parfois le mépris qu’il suscite, ce sport est un véritable miroir du monde du travail actuel avec ses failles et ses dérives.
L’autre enjeu sera d’étudier les moyens existants et de proposer d’autres solutions institutionnelles et juridiques afin d’endiguer une dégradation de la santé mentale des footballers professionnel qui commence progressivement à interroger tant les acteurs de ce sport que les professionnels de santé.
Partie I.
Etat des lieux d’un secteur professionnel hétérogène dominé par une impitoyable logique de marché
Culte performance, inégalités et industrialisation du football sont étroitement liées. Ces composantes du football professionnel constituent un terreau propice au développement de troubles psychologique et de maladies mentales dont les premiers concernés sont ceux qui sont au cœur de ce système, à savoir les joueurs.
Le terrain de football : terre d’inégalités
A l’instar du personnel hospitalier, le monde du football professionnel se caractérise par l’extrême diversité des membres qui le compose. Il est important de faire la distinction entre les stars du football et le footballeur moyen qui représente la grande majorité de la profession et qui est soumis à des risques de précarités importants.
Si la sphère médiatique fait surtout références à l’activité d’une minorité de joueurs aux salaires mirobolants jouissant de longues carrières, celle-ci passe sous silence le quotidien d’hommes et de femmes qui ne sont que de simples adversaires – voire coéquipiers – de ces stars multimillionnaires, et qui ne partagent avec elles que le titre de footballeur professionnel (pas toujours) car tout ou presque les sépare.
Le maitre mot du marché de l’emploi dans le football professionnel est inégalité.
Ces inégalités sont de nature économique et par conséquent elles peuvent avoir des conséquences sociales désastreuses pour ces individus qui ont tout misé sur le sport et qui disposent d’un capital formation pour la plupart insuffisant afin d’appréhender sereinement une après-carrière.
Richard Duhautois, chercheur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) spécialiste de l’économie du football professionnel s’est penché en 2018 sur la réalité des rémunérations dans le monde du ballon rond, loin des clichés des joueurs vedettes surpayées[4].
Plusieurs éléments en ressortent :
La grande majorité des footballeurs ont de faibles salaires et une carrière très courte. En effet, une fois cette dernière entamée, le risque qu’elle s’arrête brutalement – pour cause de blessure ou tout simplement parce que le joueur ne trouve pas de club tant la concurrence est rude – est relativement fort. La durée moyenne d’une carrière en première division en Europe est d’environ cinq ans avec de grandes disparités entre les stars et les autres. Les salaires moyens sont plus hétérogènes dans les championnats européens car ils dépendent en grande partie des droits télévisés.
L’hétérogénéité est encore plus grande si on élargit l’analyse au monde. Le chercheur s’est penché sur quelques pays qualifiés à la Coupe du monde 2018 et à une statistique publiée fin 2016 par la Fédération internationale des joueurs professionnels (Fifpro) : la plupart des joueurs rémunérés touche moins de 1000 $ par mois. Dans le monde, 45% des footballeurs professionnels sont dans ce cas, avec un record pour le Ghana (plus de 99%). Ils sont environ 2% pour les grands championnats européens.
Selon le quotidien sportif l’Equipe le salaire brut mensuel touchés en moyenne en Ligue 1 est de 108.422 euros. Toutefois cette somme est faussée par les salaires pharamineux proposé par une minorité de clubs importants. D’après les chiffres donnés par l’UNFP, le syndicat des joueurs professionnels en France, 25% des footballeurs de Ligue 1 toucheraient à eux-seuls 75% du total des revenus bruts distribués.
Autre inégalité qui, à défaut d’être endigué, tend à être de plus en plus médiatisé : le cas du football féminin.
L’article 3 du préambule de la Constitution de 1946 précise que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Malgré tout, « la joueuse doit sans cesse faire ses preuves et sa place reste encore bien marginale au sein d’un football essentiellement masculin »[5].
Cette inégalité apparait tant au niveau du statut juridique qu’au niveau des salaires même si en France celle-ci la différence ne résulte pas d’une discrimination mais de la taille du « gâteau » (le marché) selon les termes avancés par Luc Arrondel et Richard Duhotois économistes et spécialistes du football[6].
En France, d’un point de vue juridique, aucune joueuse n’est considérée comme professionnelle à proprement parler, contrairement aux hommes qui signent un contrat avec leurs clubs respectifs, et sont liés à la Ligue de football professionnel (LFP). Les filles dépendent de la Fédération française de football (FFF) et sont sous « contrat fédéral », similaire à celui des amateurs. Néanmoins, dans les faits et en dépit de cette notion juridique, elles agissent toutes comme si elles étaient professionnelles. Si les meilleures peuvent toucher plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois, en France, le salaire mensuel moyen d’une footballeuse est de 2494 euros bruts, indique à LCI la Fédération française de football (FFF).
Des voix s’élèvent afin de lutter contre ces discriminations salariales notamment aux Etats-Unis où le soccer féminin est très médiatisé. La sélection Américaine est considérée comme l’une des plus fortes nations du football féminin sur le plan mondial comme le prouve son palmarès, qui en nombre de trophées lui permet d’être l’équipe la plus titrée au monde. La star et capitaine de l’équipe Mégane Rapinoe est l’une des figures de proue du mouvement contestataire. Avec elle, l’équipe féminine américaine engage notamment un contentieux retentissant fait à la Fédération américaine de football, en raison des différences de traitement de rémunérations entre joueurs et joueuses de l’équipe nationale.
Selon le Huffington post « 50% des footballeurs se retrouvent ruinés au moins 5 ans après la fin de leur carrière ». Le taux de chômage, dans ce milieu, dépasserait les 15% et, à chaque période estivale, 25% des footballeurs commenceraient la saison sans contrat. Cette donnée est d’autant plus prégnante chez les footballeuses beaucoup moins bien payées que les hommes malgré le développement du professionnalisme du football féminin.
Le terrain de football :
une industrie qui « consomme » de l’être humain
Dans la stricte logique du libéralisme économique, la notion de « capitalisme sauvage » développé par Pierre Bourdieu [7]renvoi à un modèle économique « sauvage » c’est-à-dire « non-policé » et parfois cruel.
L’arrêt Bosman[8] rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 15 décembre 1995 va jouer un rôle considérable dans ce mouvement d’industrialisation du football.
Le tournant à partir duquel la Communauté européenne s’est occupée du sport et de ses incidences sur la jeunesse porte une date bien précise : 29 mai 1985.
Ce mercredi soir Liverpool et la Juventus de Turin sont opposés en Finale de la Coupe des Champions. Plus de 60 000 personnes doivent assister à la finale dans l’enceinte du stade du Heysel. Les conditions de sécurité et de confort sont mauvaises, et en raison de nombreuses failles dans le système de contrôle, plusieurs milliers de fans sans billets ont réussi à pénétrer une enceinte déjà pleine à craquer (c’est le cas de le dire).
Suite à un but du club bianconero la violence des hooligans anglais se déchaîne : des spectateurs innocents de la tribune Z, des femmes, des enfants, en grande majorité des italiens, tombent les uns sur les autres. Des scènes de terreur : un mur s’écroule sous la pression humaine, 39 personnes succombent dans des conditions horribles, la plupart asphyxiées.
Le match finira tout de même lieu pour des questions de sécurité car son annulation déclencherait la « vendetta » des tifosi. Le lendemain, Madame Thatcher s’excuse officiellement auprès des italiens pour cet acte de barbarie.
En juillet 1985, un mois et demi seulement après ce drame, le Parlement européen approuve un document sur le vandalisme et la violence dans le sport, qui propose des mesures concrètes pour faire face à ces fléaux à l’intérieur comme à l’extérieur des stades de football.
En même temps, le Conseil de l’Europe adopte une convention à ce sujet qui entre en vigueur dès le mois de novembre.
Ces initiatives, outre que réprimer la violence, poursuivent une stratégie préventive grâce au recours aux campagnes intensives d’information au niveau national.
Mais le véritable déclic est accompli grâce au rapport de Mme Jessica Larive (A3-0326/94) du 29.04.1994. Ce document prévoit tous les problèmes qui caractérisent de nos jours le sport au niveau de l’Union. Il commence par souligner que l’activité sportive est devenue le point de référence centrale de la vie de millions d’Européens et doit faire l’objet d’une attention politique au niveau le plus élevé. Il conclut en proposant d’appliquer au sport la normative communautaire et de combattre, par les moyens appropriés, les dangers qui le menacent car en raison de son succès grandissant et des énormes intérêts en jeu, il risque de devenir l’objet de la convoitise de la criminalité internationale organisée.
Dans ce processus, un rôle notable revient à l’arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 1995 en matière de transfert de footballeurs et d’élimination de limites de présence dans les équipes des ressortissants d’autres États membres. L’arrêt 415/93 a produit l’effet d’une véritable révolution ; une large partie de l’opinion publique, des milieux intéressés, des chercheurs l’approuve ne fut-ce que sur la base du principe que « l’homme n’est pas une marchandise ».
En effet cette décision s’inscrit dans la logique de libre circulation des travailleurs posé par le traité de Rome du 25 mars 1957. Le principe de la liberté de circulation est, avec la saine concurrence, un des « piliers » de la construction européenne.
La jurisprudence Bosman n’a fait en réalité que confirmer ce que le juge communautaire avait déjà énoncé deux décennies auparavant, avec l’arret Walrave et Koch (1974), puis Donà (1976). « La primauté du droit communautaire, qui s’exerce à l’encontre des législations nationales, ne pouvait que s’appliquer également aux règles sportives d’origine privée, particulièrement lorsqu’il s’agit de garantir l’exercice des libertés fondamentales reconnues par le traité[9] ».
Mais de nombreux spécialistes et parlementaires sont d’avis qu’il entraînera des conséquences désastreuses. Selon cette thèse, l’arrêt Bosmanrisque d’entraver l’indispensable formation des jeunes, environ 50 % des indemnités de transfert financent les fonds destinés à cette fin et de mettre en danger la survie des petits clubs, tout en entraînant la poursuite des fins commerciales dans le sport. On finirait donc « par couper les liens entre le sport et la vie culturelle et par provoquer le résultat opposé à celui escompté »[10].
En octobre 2011, cette jurisprudence est applicable dans tous les pays de l’Union européenne et concerne tous les ressortissants des États membres de l’Espace économique européen, de Suisse (Accords bilatéraux), de Russie (Accord de Corfou UE-Russie) et des 79 pays ACP (Accord de Cotonou).
L’arrêt Bosman change considérablement le paysage du football européen mais aussi mondiale. Les effets économiques et commerciales redoutées ont été confirmé : multiplication des transferts, la hausse des salaires versés, le renforcement des clubs les plus riches au détriment des moins fortunés, ou le pillage des clubs formateurs qui en résulte…
Le football est devenu une activité économique comme une autre, avec ces exigences de rentabilité et ces règles du calcul économique. Il apparaît comme symptomatiquedes transformations économiques des dernières décennies avec l’accent mis sur la spéculation financière, le caractère irréel de la valeur économique [11] ou l’accroissement des écarts entre les revenus des acteurs.
Cette rationalisation économique du football signifie aussi qu’il existe une industrie des joueurs, la matière première du sport, qui constitue, elle aussi, une diversification des ressources : un joueur n’est pas formé par un club pour porter les couleurs de équipe, « pour l’amour des couleurs », mais parce qu’on doit, par souci de rentabilité, former un produit vendable sur le marché ; outre l’incertitude qui pèse sur l’avenir professionnel de jeunes joueurs mis en concurrence, un joueur change de club selon sa valeur et les moyens et non par fidélité[12].
Si les acteurs du secteur hospitaliers s’insurgent à juste titre contre la tarification à l’activité renvoyant à un fonctionnement des institutions fondé sur le modèle de l’entreprise, les fans de football constatent que cette tendance touche également leurs équipes préférées.
Il est à noter que « bon nombre de supporters « ultras » s’inscrivent en opposition avec les dirigeants du club qu’ils soutiennent, accusés de sacrifier à une « marchandisation » du football qu’ils refusent »[13] pour citer l’ouvrage « Droit(s) du football » rédigé par les Professeurs Thouzei-Divina et Maisonneuve à l’occasion de la troisième édition des « 24h du droit ».
Ce mouvement de contestations entre groupes de supporters historique et direction de club est cristallisé notamment par les politiques commerciales de « merchandising » et de développement des sources de recettes des stades qui poussent à la construction de nouveaux stades ; et, avec ces nouveaux stades, les autorités régulatrices du football semblent attendre un nouveau public, « moins contestataire et « turbulent » – plus spectateur et consommateur »[14].
Les clubs sont donc désormais gérés comme des entreprises ayant le statut sociétés anonymes à but lucratif. Des investisseurs sont à la tête de ces clubs permettant de faire rentrer du capital ou de coter le club en bourse. L’objectif est donc de faire des bénéfices et la matière première de ces entreprises sont les joueurs professionnels.
Cette approche capitaliste du football professionnel s’éloigne de l’époque où les clubs étaient fondés en majorité sous la forme juridique de l’association puisque celle-ci exige un but idéal intrinsèque à l’activité sportive.
Il est possible de remettre en cause l’aspect éthique et moral de ses transitions renvoyant à la question de l’aspect patrimonial du joueur. Les lois bioéthiques de 1994 ont inséré dans le code civil des dispositions protectrice du corps humain.
L’article 16-1 alinéa 3 du Code civil dispose que « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».
De même l’article 16-5 du Code civil prévoit que « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».
Même si affirmer que ces transitions portent atteintes à l’intégrité corporelle du corps humaine est surement exagéré mais l’approche parfois déshumanisée des joueurs que l’on s’échange comme s’ils étaient de simples monnaies d’échanges interroge toutefois.
L’usage systématique du CDD illustre cette vision pragmatique des clubs qui ne souhaitent se fermer aucune porte. En effet l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée en cours constitue la garantie pour le club employeur de pouvoir monnayer, avec les clubs potentiellement intéressés, la rupture anticipée dudit contrat. C’est le principe même du transfert, qui est juridiquement impossible lorsque le contrat arrive à échéance[15].
Les premières victimes de cette industrie « omnivore » sont les jeunes joueurs qui aspire à devenir footballeur professionnel.
Raffaele Poli chercheur à l’observatoire du football point du doigt cette véritable boulimie des clubs professionnels. « Les clubs achètent beaucoup de joueurs sans avoir un plan spécifique pour chaque joueur, c’est de la consommation. Finalement, peu importe, s’ils arrivent ou pas à percer. Pour les clubs anglais aujourd’hui, quelques centaines de milliers d’euros, ça ne leur coûte pas cher. Pour des jeunes, souvent issus de milieux défavorisés, si on leur offre une prime à la signature pour partir à l’étranger, la tentation est grande… » [16].
L’actualité récente a malheureusement permis d’illustrer ses propos. En effet le 26 octobre 2020, Jeremy Wisten, un garçon de 17 ans natif du Malawi, passé par l’académie de Manchester City s’est donné la mort. Selon la presse anglaise, le jeune défenseur serait tombé en dépression quelques semaines avant son geste, en partie parce qu’il n’avait pas été conservé par le centre de formation des citizens[17].
Ce décès a fait l’objet de vive réaction notamment de la part de joueur professionnel qui se sont retrouvé dans le parcours du jeune Anglais. Le joueur du FC Nantes Kader qui a connu le chômage et les emplois précaire avant de signer professionnel évoque notamment le manque de qualification de ces jeunes ainsi que le sentiment d’abandon de ceux-ci lorsqu’ils échouent à signer professionnel.
Afin de protéger le développement personnel du footballeur mineur, le règlement de la FIFA est venu encadrer les transferts des mineurs [18].
Le principe est le suivant : « le transfert international d’un joueur n’est autorisé que si le joueur est âgé d’au moins 18 ans. »
Toutefois l’article 19.2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA pose 3 exceptions :
-Si les parents du joueur s’installent dans le pays du nouveau club pour des raisons étrangères au football, par exemple pour des raisons professionnelles. Cependant, il ne faut pas que le ou les parents du joueur soient embauchés par le nouveau club ou qu’il se prévalent d’un faux contrat de travail dont l’unique but est de contourner le règlement FIFA.
-Si le transfert a lieu à l’intérieur de l’UE ou au sein de l’Espace Economique Européen pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans.
-Si le joueur vit tout au plus à 50 km d’une frontière nationale et si le club auprès duquel le joueur souhaite être enregistré dans l’association voisine se trouve à une distance de 50 km maximum de la frontière. La distance maximale entre le domicile du joueur et le club doit être de 100 km. Dans ce cas, le joueur doit continuer à habiter chez ses parents et les deux associations concernées doivent donner leur accord exprès.
Ce principe souffre donc de trop nombreuses failles dans lesquelles s’engouffre les clubs professionnels peu scrupuleux.
Le 14 janvier 2016, La FIFA a condamné le Réal Madrid et l’Atlético Madrid à une interdiction de recrutement d’un an, soit pendant 2 mercatos (été 2016 et hiver 2017). Les deux clubs ont été accusés d’avoir violé le règlement FIFA sur les transferts des joueurs mineurs.

Les Football Leaks (fuite de documents confidentiels) nous apprenaient que plusieurs clubs, dont l’AS Monaco, contourneraient les règles de transfert de jeunes joueurs. Il serait reproché à l’AS Monaco d’avoir proposé des primes anticipées à la signature à un joueur de 12 ans. A ces primes s’ajouteraient des aides au logement et à la scolarité.
Toujours d’après ces documents, l’AS Monaco aurait versé la somme de 15.000 euros aux parents d’un joueur de 14 ans.
Toutefois affirmer que seuls les jeunes joueurs sont sujets à ces troubles mentaux est une grave erreur qui ne fait qu’accentuer le malaise existant.
Les cas de dépressions et de suicide ne touchent pas uniquement les jeunes joueurs. Ces phénomènes affectent également des joueurs confirmées, rodés et connaissant les rouages du football professionnel. A l’image de la métaphore avancée par le psychopathologue, un déséquilibre affectif personnel combiné à la pression du monde professionnel, peut plonger les plus grands champions au bord de l’abime.
Le culte de la performance sur et en dehors des terrains
Le milieu du monde du football professionnel est un milieu extrêmement concurrentiel. Les offres d’emplois sont relativement faibles eu égard à une demande toujours plus importante.
Le phénomène de mondialisation et l’apport de l’Arrêt Bosman a étendu le champ de la concurrence.
A titre d’illustration, en 2010 l’équipe italienne de l’Inter de Milan comptais un groupe de 30 joueurs. Sur ces 30 joueurs seulement 4 étaient Italiens.
Par conséquent face à cette forte concurrence, les joueurs se doivent d’être de plus en plus performant quitte à dissimuler leurs failles tant physiques que mentales et ceux dès leur plus jeune âge au sein des centres de formation pilotés par des logiques de performance et de rentabilité[19].
En effet si la blessure physique est fréquente dans le football et abordé sans tabou, ce n’est pas toujours le cas des failles mentales et psychologiques.
Alexandre Le Jeune, psychopathologue du sport au centre médical de Clairefontaine évoque ce constat dans une interview donnée pour le magazine So Foot : « C’est assez paradoxal, car on parle beaucoup de communication, de mental solide, mais ça laisse très peu de place au doute et il est compliqué d’en parler. Ce sont de belles machines qui marchent bien quand tout va bien, mais qui manquent de ressources quand un grain de sable vient l’enrayer ».
Il s’agira d’illustrer cette analyse à travers le cas tragique de Robert Enke.
Capitaine de Hanovre, favori pour garder les buts de la sélection Allemande à la Coupe du Monde 2010, celui-ci s’est jeté sous un train le 10 novembre 2009. Il avait 32ans.
Selon plusieurs journaux sportifs, Robert Enke suivait une thérapie psychologique.
Le gardien de but était suivi depuis 2003 par des psychiatres car il souffrait d’une angoisse aiguë de l’échec.
En Allemagne le drame a ouvert un vaste débat sur la question des maux psychologiques qui peuvent affecter les sportifs de haut niveau. Ainsi à la suite du suicide du portier, il a été décidé de la mise en place obligatoire d’un psychologue au sein de chaque club professionnel Allemand. Décision qui n’a pas empêché Andreas Biermann (33ans) de se donner la mort en 2013.
De plus la performance footballistique à un très haut niveau ne concerne pas uniquement le terrain. L’individus doit pouvoir se frayer un chemin au milieu du public, des médias, dans le vestiaire. Il n’y a donc pas que la performance sportive qui va compter et c’est pourquoi certains trés bon joueurs ne s’imposent pas ou ne réussissent pas à devenir professionnels.
Dans son autobiographie, l’ancienne star allemande Sebastian Deisler qui avait sombré en dépression et qui par conséquent avait pris sa retraite à 27 ans illustre parfaitement cette nécessité de performer sûr mais aussi en dehors du terrain : « au Bayern, tu ne réussis que si tu dis que tu es le meilleur, tu te définis par rapport à ton ego et ta fierté. Je n’ai jamais écrasé les autres, on m’aimait bien pour cela, mais cela m’a aussi valu des problèmes ».
Aujourd’hui, les centres de formation commencent à intégrer ces notions auprès des joueurs. Ils les forment entre autres à la communication avec les médias mais aussi à la pression du public composante du football professionnel.
Le football est, comme chacun le sait, un sport très médiatisé qui alimente les passions du grand public. Cette médiatisation poussée parfois à l’extrême conduit évidemment à de nombreuses dérives.
Les dérives psychologiques dues à l’hypermédiatisation
Dans l’esprit du grand public, les footballeurs sont des privilégiés qui, vulgairement, « gagnent bien leur vie en tapant dans un ballon ». Si bien qu’il est inconcevable pour ce grand public d’entendre que des joueurs soient dépressifs. Les joueurs sont évidemment conscients de cette conception quitte à l’intérioriser et à ressentir un sentiment de culpabilité.
La psychologue du sport Delphine Herblin, qui collabore avec plusieurs joueurs et clubs professionnels s’est expriméesur la question. Selon elle « les footballeurs n’osent pas aller voir des psychologues ou des coachs mentaux. Pour eux, c’est comme si ce n’était pas légitime. Il y a une très forte culpabilité à ne pas aller bien alors qu’ils sont censés aller bien parce qu’ils gagnent beaucoup d’argent et que beaucoup de personnes les envient. Le grand public envie la carte postale. Ils envient la partie visible de l’iceberg et n’imaginent pas la souffrance, la douleur, les doutes que les joueurs vivent au quotidien. Se sentir mal est presque inavouable pour les joueurs. À tel point qu’ils ont complètement intériorisé cela ». [20]
La réflexion de la psychologue met donc en exergue une réalité complexe. Toutefois cette réticence à aller consulter un professionnel tend à être légèrement nuancée dans le sens où les coachs mentaux et les cellules psychologiques se développent progressivement dans la sphère du monde professionnel (Voir plus loin dans le développement).
Ce traitement spécial réservés par les médias et par l’opinion public a tendance à affecter l’estime de soi du joueur. Dans une interview, le footballeur allemand Andre Schürrle, champion du Monde en 2014, avouait que « soit tu es un héros, soit tu es zéro. Il n’y a rien entre ça ». Ce dernier a traversé une profonde dépression après 2014 et a pris sa retraite à 29ans.
Le docteur Herblin compare le traitement accordé au footballeur à celui réservé aux gladiateurs qui « déchaînaient de la ferveur et de la passion de la part d’un public qui tombait en transe et prenait du plaisir à huer, à siffler, à haïr, à acclamer et parfois à voir mourir ces gladiateurs dans l’arène. Ces spectateurs allaient au spectacle et oubliaient qu’ils avaient affaire à des êtres humains derrière leurs tenues de combattants. C’est un peu la même chose avec le football, qui est devenu le sport roi du peuple ».

Cette image relayée par les médias et par l’opinion public peut entrainer de véritables troubles de l’identité. En effet, lorsqu’un joueur est pris pour un héros, ce dernier s’approprie la position du héros tant attendu et il va faire de ces attentes et de cette pression une affaire personnel ce qui constitue un poids énorme sur ses épaules d’autant plus que les joueurs sont souvent très jeunes.
Le risque est donc de s’identifier complètement à l’image relayée par l’opinion public, ce qui peut être dangereux pour leur santé mentale notamment en cas d’échec ou lors de la redouté fin de carrière où les joueurs tombent progressivement et inexorablement dans l’oubli.
En effet la retraite est une véritable petite mort pour ces sportifs qui ont consacré toute leur jeunesse à la pratique intensive de ce sport. Le retour à la vie normale est parfois difficile à encaisser : perte de célébrité, l’absence d’objectifs sportifs, une nécessaire réinsertion professionnelle, des soucis financiers à la suite d’une mauvaise gestion patrimoniale…
Un nombre très important de joueurs choisissent de rester dans le milieu du football à la fin de leur carrière.
A cet égard il existe un véritablement mouvement de solidarité corporatiste dans le monde du football professionnel. La priorité est donnée aux anciens professionnels notamment en ce qui concerne l’octroi de diplôme fédérale permettant d’entrainer à haut niveau mais également au sein des instances dirigeantes du football (Fédération Française de Football, Ligue de Football Professionnel).
La médiatisation implique également de signaler l’évolution du rôle du footballeur professionnel. Certaines stars sont devenues de véritables personnalités publiques au même titre que les hommes politique et par conséquent leurs rôle a progressivement évolué quitte à aller au-delà du simple aspect sportif. Véritable égérie de leur sport certains joueurs se sont vu attribuer un rôle d’exemple, de modèle de réussite impliquant un comportement exemplaire.
Par conséquent les médias font les choux gras des faits divers impliquant les footballeurs ou leurs entourages. Les exemples sont légions. Si la couverture médiatique est souvent pertinente à cet égard et permet de mettre en lumière certaines zones d’ombres concernant la vie et l’entourage de certaines stars du football (confère la mise en examen de Karim Benzema dans l’affaire de la « sex tape » de son co-équipier Mathieu Valbuena), parfois celle-ci se limite à inciter au mépris et à la condescendance (confère les articles de Ouest France, de la Dépêche, du Figaro couvrant la « dégustation » par le footballeur Ribéry d’une entrecôte recouverte de feuille d’or à Dubai).
Enfin l’hypermédiatisation et la folie collective pousse certains joueurs à vivre reclus dans des lotissements ultra sécurisés, coupés du monde. Des légendes tels que Cristiano Ronaldo ou Leo Messi ne peuvent prendre le risque de sortir dans la rue sous peine d’être littéralement engloutit par la foule. Le génie argentin s’est confié sur ce statut de superstar dans une interview accordée à La Sexta. « C’est vrai que je suis privilégié par rapport à tout ce que j’ai vécu. Mais il y a des moments où j’aimerais être anonyme et pouvoir profiter d’aller au marché, au cinéma ou au restaurant », a avoué l’Argentin. « Je suis toujours reconnaissant, cet amour que je reçois à travers le monde est vraiment spectaculaire. Mais il y a des moments, surtout quand je suis avec mes enfants, où oui, j’aimerais passer inaperçu ».

Cet enfermement forcé peut évidemment avoir des conséquences néfastes sur la santé de certains footballeurs.
Les conséquences de la crise Covid 19
A l’instar de l’ensemble de la population mondiale civile et professionnelle, la sphère du football professionnel a été touché par l’épidémie de Covid 19 et le virus a marqué les corps mais également les esprits. L’esprit c’est surement ce qu’il fait défaut aux dirigeants de l’Union des associations européennes de football (UEFA) et de la Fédération internationale de football association (FIFA) en cette période de crise sanitaire mondiale.
En effet, malgré les appels répétés et les recommandations des épidémiologistes appelant à la prudence et à la prise de conscience, les instances dirigeantes du football professionnel ont tenté de « dribbler » le covid et les conséquences indésirables ne sont pas faites prier.
En effet l’épidémie cristallise à elle seul l’ensemble des maux du football professionnel : les impératifs économiques ont pris le pas sur les considérations sanitaires et humaines.
Les compétitions se sont déroulées coute que coute quitte à proposer un triste spectacle (interdiction de supporters dans les stades) perdant tout son intérêt au vu du contexte tant pour les spectateurs que pour parfois les joueurs.
C’est le cas notamment de Josip Ilicic parti s’exilé depuis mi-juillet en Slovénie, son pays d’origine, alors même que son équipe concourait en Ligue des Champions (première participation de l’histoire du club) contre le Paris Saint Germain.
Selon le média sportif italien Corriere dello Sport le joueur vit actuellement une dépression étroitement liée aux événements survenus à Bergame ces derniers mois durant l’épidémie du Covid-19. Le Slovène a effectivement eu une jeunesse très difficile, marquée par le décès de son père et de la guerre qui l’avait contraint à fuir le pays.
Rappelons que Bergame a été l’épicentre du virus en Europe. Le déplacement de plus de 40.000 supporters de Bergame à Milan pour assister au match entre l’Atalanta et Valence à constituer d’ailleurs une « véritable bombe biologique » selon Fabiano Di Marco, le responsable du département pneumologie de l’hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame pour qui ce match avait été un accélérateur de la propagation du virus dans la ville.

L’autre fait marquant est celui relatif à la quarantaine imposée par le régime aux équipes de la Super League Chinoise.[21]
Les équipes ont été confinées pendant 79 jours (du 19 juillet au 29 septembre), dans le cadre de mesures strictes visant à contrecarrer la pandémie de coronavirus.
Les joueurs, les entraîneurs et les membres des staffs, qui n’était pas autorisé à voir leurs familles et n’étaient autorisés à quitter les hôtels que pour jouer des matches et s’entraîner.
L’objectif était clair : il fallait terminer le championnat.
Cette mise en quarantaine forcée a alerté les médecins Chinois qui ont émis des craintes quant à la santé des joueurs actifs en Chine et plus particulièrement sur leurs santé psychique et mentale.
Le confinement drastique imposé par les pouvoirs publics Chinois a généré des effets secondaires peu surprenant : peur d’être contaminé, solitude en quarantaine, anxiété…Les psychologues chinois ont fait face à un afflux croissant de personnes ayant du mal à surmonter les bouleversements entraînés par l’épidémie de Covid-19.
« Plus la quarantaine est longue, plus les répercussions sur la santé mentale sont importantes », résume un professeur de psychiatrie à l’Université de Melbourne.
En effet selon Franceinfo, plus d’un footballeur sur dix affirme présenter les symptômes d’un état dépressif depuis l’arrêt des compétitions du fait de la pandémie de coronavirus, selon les conclusions d’un sondage dévoilées lundi 20 avril par la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs professionnels.
Quelque 1 600 athlètes (1 134 hommes et 468 femmes) évoluant en Angleterre, France, Suisse, Afrique du Sud ou encore aux Etats-Unis – autant de pays où des « mesures drastiques » ont été mises en place pour contenir la propagation du Covid-19 – ont été interrogés entre le 22 mars et le 14 avril. Résultat : « 22% des joueuses et 13% des joueurs ont fait état de symptômes compatibles avec le diagnostic d’une dépression ».
Cet état des lieux des facteurs déterminants peut en partie expliquer ce phénomène de sinistrose qui touche depuis quelques années le monde du football.
Afin de lutter contre la dégradation de la santé mentale du footballeur, une prise en charge des troubles psychosociaux est prévue par le législateur dont l’effectivité incombe en partie comme dans le droit du travail commun à l’employeur.
Bibliographie :
– « Le Premier Homme » publiée en 1994 aux éditions Gallimard.
-«Temps sportif, santé du champion et logique d’urgence » Staps 2012/2-3 (n°96-97), pages 9 à 27
– l’article du Monde du 07/04/2021 « Particuliers, investisseurs, banques : pourquoi la fièvre spéculative se propage ».
-Article du Monde « Les différences salariales entre footballeurs et footballeuses dépendent de la taille du marché » du 25 juin 2019.
-Intervention à la Confédération générale des travailleurs grecs, (GSEE) à Athènes, en octobre 1996.
-Arrêt de la Cour du 15 décembre 1995 : Union royale belge des sociétés de football association ASBL contre Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contre Jean-Marc Bosman et autres et Union des associations européennes de football (UEFA) contre Jean-Marc Bosman.
-Jurisport : « Entre dérégulation et recherche de nouvelles règles » – Colin Miège – RJES 2000, n°56, p.81
– « Le sport dans l’Union européenne et l’arrêt Bosman » – Massimo Silvestro – Alessandro Silvestro – RMCUE 1996. 489
-Patrick Mignon « L’argent du Football ».Pouvoirs 2002/2 (n° 101), pages 89 à 104
-V. par ex. F. Buy, « Les transferts de joueurs », in M. Maisonneuve et M. Touzeil-Divina (dir.), Droit(s) du football, L’Épitoge-Lextenso, 2014
-Règlement officiel de la Fifa encadrant les transferts des joueurs.
-Bertrand, J. (2012). La fabrique des footballeurs. La Dispute. coll. « Corps Santé Société »
[1] « Le Premier Homme » publiée en 1994 aux éditions Gallimard.
[2] « Temps sportif, santé du champion et logique d’urgence » Staps 2012/2-3 (n°96-97), pages 9 à 27
[3] Définition du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
[4] Etude publié par Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
[5] V. par ex. F. Buy, « Les transferts de joueurs », in M. Maisonneuve et M. Touzeil-Divina (dir.), Droit(s) du football, L’Épitoge-Lextenso, 2014, p. 147
[6] Article du Monde « Les différences salariales entre footballeurs et footballeuses dépendent de la taille du marché » du 25 juin 2019.
[7] Intervention à la Confédération générale des travailleurs grecs, (GSEE) à Athènes, en octobre 1996.
[8] Arrêt de la Cour du 15 décembre 1995.
Union royale belge des sociétés de football association ASBL contre Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contre Jean-Marc Bosman et autres et Union des associations européennes de football (UEFA) contre Jean-Marc Bosman.
[9] Cité par Colin Miège Jurisport : « Entre dérégulation et recherche de nouvelles règles »– RJES 2000, n°56, p.81
[10] Cité par Massimo Silvestro « Le sport dans l’Union européenne et l’arrêt Bosman »– Alessandro Silvestro – RMCUE 1996. 489
[11] Cité par l’économiste Gunther Capelle-Blancard dans l’article du Monde du 07/04/2021 « Particuliers,investisseurs,banques : pourquoi la fièvre spéculative se propage ».
[12] Cité par Patrick Mignon « L’argent du Football ».Pouvoirs 2002/2 (n° 101), pages 89 à 104
[13] V. par ex. F. Buy, « Les transferts de joueurs », in M. Maisonneuve et M. Touzeil-Divina (dir.), Droit(s) du football, L’Épitoge-Lextenso, 2014, p. 147
[14] 2 V. Rapport des membres de la Mission Avenir du Football, « Football et société – Le Livre blanc », 2008, p. 41 ; Livre vert du supportérisme… ; op. cit. ; p. 25 : « En somme, les nouveaux stades doivent proposer différents espaces en fonction des attentes de leurs différents publics. Et il importe de s’assurer qu’aucun type de public ne dissuade d’autres types de publics de fréquenter le stade »
[15] V. par ex. F. Buy, « Les transferts de joueurs », in M. Maisonneuve et M. Touzeil-Divina (dir.), Droit(s) du football, L’Épitoge-Lextenso, 2014, p. 147.
[16] Les jeunes joueurs africains
Des migrants à “forte valeur ajoutée” dans le système productif international des footballeurs professionnels
Bertrand Piraudeau
« Migrations Société » 2011/1 (N° 133), pages 11 à 30
[17] Paris Match « Manchester City pleure la mort tragique d’un ancien jeune joueur de 17 ans »
Publié le 26/10/2020
[18] Règlement officiel de la Fifa encadrant les transferts des joueurs.
[19] Bertrand, J. (2012). La fabrique des footballeurs. La Dispute. coll. « Corps Santé Société »
[20] Article Foot Mercato publié le 24/07/2020
[21]Article So Foot « Le football Chinois lui aussi en Quarantaine » rédigé par Nicolas Jucha le mardi 4 février 2020
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2021 ;
Chronique Droit(s) de la Santé ; Art. 335.